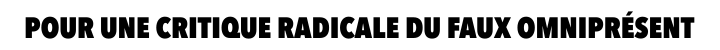L'Entraide Parmi les Sauvages
Extrais du chapitre III de L'Entraide: un Facteur de l'Évolution.

La persistance même de l’organisation du clan montre combien il est faux de représenter l’humanité primitive comme une agglomération désordonnée d’individus obéissant seulement à leurs passions individuelles et tirant avantage de leur force et de leur habileté personnelle contre tous les autres représentants de l’espèce. L’individualisme effréné est une production moderne et non une caractéristique de l’humanité primitive.
[…]
[Nous] savons que, lorsque les Européens arrivèrent, les Bushmen vivaient en petites tribus (ou clans) et que ces clans formaient quelquefois des confédérations ; qu’ils avaient l’habitude de chasser en commun et se partageaient le butin sans se quereller ; qu’ils n’abandonnaient jamais leurs blessés et faisaient preuve d’une forte affection envers leurs camarades. Lichtenstein raconte une histoire des plus touchantes sur un Bushman presque noyé dans une rivière, qui fut sauvé par ses compagnons. Ils se dépouillèrent de leurs fourrures pour le couvrir, et tandis qu’ils demeuraient à grelotter, ils le séchèrent, le frottèrent devant le feu et enduisirent son corps de graisse chaude jusqu’à ce qu’ils l’aient rappelé à la vie. Et quand les Bushmen trouvèrent en Johan van der Walt un homme qui les traitait bien, ils exprimèrent leur reconnaissance par un attachement des plus touchants à cet homme. Burchell et Moffat les représentent tous deux comme des êtres bons, désintéressés, fidèles à leurs promesses et reconnaissants, qualités qui ne peuvent se développer que si elles sont pratiquées dans une société étroitement unie. Quant à leur amour pour leurs enfants, il suffit de dire que quand un Européen désirait s’emparer d’une femme Bushman comme esclave, il volait son enfant : il était sûr que la mère viendrait se faire esclave pour partager le sort de son enfant.
Les mêmes mœurs sociales caractérisent les Hottentots, qui ne sont qu’à peine plus développés que les Bushmen. […] Si l’on donne quelque chose à un Hottentot, il le partage immédiatement avec tous ceux qui sont présents […]. Un Hottentot ne peut manger seul, et quelque affamé qu’il soit, il appelle ceux qui passent près de lui pour partager sa nourriture ; et lorsque Kolben exprima son étonnement à ce sujet, il reçut cette réponse : « C’est la manière hottentote ». Mais ce n’est pas seulement une manière hottentote : c’est une habitude presque universelle parmi les « sauvages ». Kolben qui connaissait bien les Hottentots, et n’a point passé leurs défauts sous silence, ne pouvait assez louer leur moralité tribale.
« Leur parole est sacrée, écrivait-il. Ils ne connaissent rien de la corruption et des artifices trompeurs de l’Europe. Ils vivent dans une grande tranquillité et ne sont que rarement en guerre avec leurs voisins. Ils sont toute bonté et bonne volonté les uns envers les autres… Les cadeaux et les bons offices réciproques sont certainement un de leurs grands plaisirs. L’intégrité des Hottentots, leur exactitude et leur célérité dans l’exercice de la justice, ainsi que leur chasteté, sont choses en lesquelles ils surpassent toutes ou presque toutes les nations du monde. »
[…] Je veux seulement faire remarquer que lorsque Kolben écrivait qu’ils sont « certainement le peuple le plus amical, le plus libéral et le plus bienveillant qu’il y eut jamais sur la terre » (I, 332) il écrivait une phrase qui a continuellement été répétée depuis dans les descriptions de sauvages. Quand des Européens rencontrent une race primitive, ils commencent généralement par faire une caricature de ses mœurs ; mais quand un homme intelligent est resté parmi ces primitifs pendant plus longtemps, il les décrit généralement comme « la meilleure » ou « la plus douce » race de la terre. Ce sont les termes mêmes qui ont été appliqués aux Ostiaks, aux Samoyèdes, aux Esquimaux, aux Dayaks, aux Aléoutes, aux Papous, etc., par les meilleures autorités. Je me rappelle aussi les avoir lus à propos des Toungouses, des Tchoucktchis, des Sioux et de plusieurs autres.1 La fréquence même de ces grands éloges en dit plus que des volumes.
[…]
[Chez les natifs d’Australie, l]es sentiments d’amitié existent chez eux à un haut degré. Ils subviennent d’ordinaire aux besoins des faibles ; les malades sont soignés attentivement et ne sont jamais abandonnés ni tués. Ces peuplades sont cannibales, mais elles ne mangent que très rarement des membres de leur propre tribu (ceux qui sont immolés par principes religieux, je suppose) ; ils mangent seulement les étrangers. Les parents aiment leurs enfants, jouent avec eux et les caressent. […] Les vieillards sont très bien traités, ils ne sont jamais mis à mort. Pas de religion, pas d’idoles, seulement la crainte de la mort. Le mariage est polygame, les querelles qui s’élèvent à l’intérieur de la tribu sont tranchées par des duels à l’aide d’épées et de boucliers en bois. Pas d’esclaves ; pas de culture d’aucune sorte ; pas de poteries, pas de vêtements, excepté quelquefois un tablier porté par les femmes. […]
Quant aux Papous, proches parents de ceux-ci, nous avons le témoignage de G. L. Bink, qui fit un séjour dans la Nouvelle-Guinée, principalement dans la baie de Geelwink, de 1871 à 1883 […] :
[Les papous] sont sociables et gais ; ils rient beaucoup. Plutôt timides que courageux. L’amitié est relativement forte entre des individus appartenant à différentes tribus et encore plus forte à l’intérieur de la tribu. Un ami paie souvent la dette de son ami, en stipulant que ce dernier la repaiera sans intérêt aux enfants du prêteur. Ils ont soin des malades et des vieillards ; les vieillards ne sont jamais abandonnés, et en aucun cas ne sont tués […]. Les enfants sont très choyés et aimés. […] Ils n’ont ni religion, ni dieux, ni idoles, ni autorité d’aucune sorte ; le plus âgé de la famille est le juge. […]
[…] Miklukho-Maclay aborda sur la côte orientale de la Nouvelle-Guinée avec un seul compagnon ; il y resta deux ans parmi les tribus décrites comme cannibales et il les quitta avec regret ; plus tard il revint pour rester encore un an parmi eux, et jamais il n’eut à se plaindre d’un mauvais traitement de leur part. […] Ces pauvres gens, qui ne savent même pas comment faire du feu et en entretiennent soigneusement dans leurs huttes pour ne jamais le laisser s’éteindre, vivent sous le communisme primitif, sans se donner de chefs. A l’intérieur de leurs villages, ils n’ont point de querelles qui vaillent la peine d’en parler. Ils travaillent en commun, juste assez pour avoir la nourriture de chaque jour ; ils élèvent leurs enfants en commun ; et le soir ils s’habillent aussi coquettement qu’ils le peuvent et dansent. Comme tous les sauvages ils aiment beaucoup la danse. Chaque village a sabarla, ou balaï - la « longue maison », ou « grande maison » - pour les hommes non mariés, pour les réunions sociales et pour la discussion des affaires communes - ce qui est encore un trait commun à la plupart des habitants des îles de l’Océan Pacifique, aux Esquimaux, aux Peaux Rouges, etc. Des groupes entiers de villages sont en termes amicaux et se rendent visite les uns aux autres en bloc.
[…]
[…] Quelques missionnaires français qui sont restés parmi [les Fuégiens] « n’ont connu aucun acte de malveillance dont ils puissent se plaindre ». Dans leurs clans, composés de cent vingt à cent cinquante personnes, les Fuégiens pratiquent le même communisme primitif que les Papous ; ils partagent tout en commun, et traitent très bien leurs vieillards : la paix règne parmi ces tribus.
Les Esquimaux et leurs congénères les plus proches, les Thlinkets, les Koloches et les Aléoutes sont les exemples les plus rapprochés de ce que l’homme peut avoir été durant la période glaciaire. […] Ils vivent par familles, mais les liens de la famille sont souvent rompus ; les maris et les femmes sont souvent échangés. Les familles cependant demeurent réunies en clans, et comment pourrait-il en être autrement ? […] [D]ans le Nord-Est du Groenland[, la] « longue maison » est leur demeure habituelle, et plusieurs familles y logent, séparées l’une de l’autre par de petites cloisons de fourrures en loques, avec un passage commun sur le devant. […] L’expédition allemande qui passa un hiver tout près d’une de ces « longues maisons » a pu certifier « qu’aucune querelle ne troubla la paix, aucune dispute ne s’éleva pour l’usage de cet étroit espace » pendant tout le long hiver. Les reproches, ou mêmes les paroles désobligeantes, sont considérés comme une offense s’ils ne sont pas prononcés selon la forme légale habituelle, la chanson moqueuse, chantée par les femmes, le « nith-song ».
Une étroite cohabitation et une étroite dépendance mutuelle suffisent pour maintenir siècle après siècle ce profond respect des intérêts de la communauté qui caractérise la vie des Esquimaux. Même dans leurs plus grandes communautés, « l’opinion publique forme le vrai tribunal, et la punition ordinaire est un blâme du coupable en présence de la communauté ».
La vie des Esquimaux est basée sur le communisme. Ce qu’on capture à la pêche ou à la chasse appartient au clan. Mais dans plusieurs tribus, particulièrement dans l’Ouest, sous l’influence des Danois, la propriété privée pénètre dans les institutions. Cependant ils ont un moyen à eux pour obvier aux inconvénients qui naissent d’une accumulation de richesses personnelles, ce qui détruirait bientôt l’unité de la tribu. Quand un homme est devenu riche, il convoque tous les gens de son clan à une grande fête, et après que tous ont bien mangé, il leur distribue toute sa fortune. Sur la rivière Yukon, Dall a vu une famille aléoute distribuer de cette façon 10 fusils, 10 vêtements complets en fourrures, 200 colliers de perles de verre, de nombreuses couvertures, 10 fourrures de loups, 200 de castors et 500 de zibelines. Après cela, les donateurs enlevèrent leurs habits de fête, les donnèrent aussi, et mettant de vieilles fourrures en loques, ils adressèrent quelques mots à leur clan, disant que, bien qu’ils fussent maintenant plus pauvres qu’aucun d’eux, ils avaient gagné leur amitié. Ces distributions de richesses semblent être une habitude ordinaire chez les Esquimaux et ont lieu en certaines saisons, après une exposition de tout ce que l’on s’est procuré durant l’année. A mon avis ces distributions révèlent une très vieille institution, contemporaine de la première apparition de la richesse personnelle ; elles doivent avoir été un moyen de rétablir l’égalité parmi les membres du clan, quand celle-ci était rompue par l’enrichissement de quelques-uns. […]
L’élévation de la moralité maintenue au sein des clans esquimaux a souvent été mentionnée. Cependant les remarques suivantes sur les mœurs des Aléoutes - proches parents des Esquimaux - donneront mieux une idée de la morale des sauvages dans son ensemble. Elles ont été écrites après un séjour de dix ans chez les Aléoutes, par un homme des plus remarquables, le missionnaire russe Veniaminoff […] :
[…] Durant une disette prolongée l’Aléoute songe d’abord à ses enfants ; il leur donne tout ce qu’il a, et jeûne lui-même. Ils ne sont pas enclins au vol ; cela fut remarqué même par les premiers émigrants russes. Non qu’ils ne volent jamais ; tout Aléoute confessera avoir volé quelque chose, mais ce n’est jamais qu’une bagatelle, un véritable enfantillage. L’attachement des parents à leurs enfants est touchant, quoiqu’il ne s’exprime jamais en mots ou en caresses. On obtient difficilement une promesse d’un Aléoute, mais quand une fois il a promis, il tiendra parole, quoi qu’il puisse arriver. (Un Aléoute avait fait présent à Veniaminoff de poisson salé, qui fut oublié sur le rivage dans la précipitation du départ. Il le rapporta à la maison. Il n’eut l’occasion de l’envoyer au missionnaire qu’au mois de janvier suivant ; et en novembre et décembre il y eut grande disette de nourriture dans le campement. Mais aucun des Aléoutes affamés ne toucha au poisson, et en janvier il fut envoyé à sa destination.) Leur code de moralité est à la fois varié et sévère. Il est considéré comme honteux de craindre une mort inévitable ; de demander grâce à un ennemi ; de mourir sans avoir jamais tué un ennemi ; d’être convaincu de vol ; de faire chavirer un bateau dans le port ; d’être effrayé d’aller en mer par gros temps ; d’être le premier à tomber malade par suite de manque de nourriture dans une expédition ou au cours d’un long voyage ; de montrer de l’avidité quand le butin est partagé - et en ce cas chacun donne sa part à celui qui s’est montré avide, pour lui faire honte ; de divulguer un secret des affaires publiques à sa femme ; lorsqu’on est deux dans une expédition de chasse, de ne pas offrir le meilleur gibier à son compagnon ; de se vanter de ses actions, surtout si elles sont imaginaires ; de faire des reproches à qui que ce soit sur un ton méprisant. Il est également honteux de mendier ; de cajoler sa femme en présence d’autres personnes et de danser avec elle […].
[…] Je veux encore ajouter que, lorsque Veniaminoff écrivait (en 1840), il n’avait été commis qu’un seul meurtre depuis le siècle dernier dans une population de 60.000 habitants, et que parmi 1.800 Aléoutes pas une seule violation de droit commun n’avait été relatée depuis quarante ans. […]
[…] J’ai déjà dit que le père Aléoute se privera pendant des jours et des semaines pour donner tous les vivres qu’il possède à son enfant, et que la mère Bushman se faisait esclave pour suivre son enfant ; et on pourrait remplir des pages entières en décrivant les relations vraiment tendres qui existent entre les sauvages et leurs enfants. Sans cesse les voyageurs ont l’occasion d’en citer des exemples. Ici vous lisez la description du profond amour d’une mère ; là vous voyez un père se livrant à une course folle à travers la forêt, emportant sur ses épaules son enfant mordu par un serpent ; ou bien c’est un missionnaire qui raconte le désespoir des parents à la mort du même enfant que, nouveau-né, il avait sauvé de l’immolation, quelques années auparavant ; ou bien vous apprenez que la « mère sauvage » nourrit généralement ses enfants jusqu’à l’âge de quatre ans, et que, dans les Nouvelles-Hébrides, à la mort d’un enfant particulièrement aimé, sa mère ou sa tante se tue pour prendre soin de lui dans l’autre monde.
[…]
[…] Quand un « sauvage » sent qu’il est un fardeau pour sa tribu ; quand chaque matin sa part de nourriture est autant de moins pour la bouche des enfants qui ne sont pas aussi stoïques que leurs pères et crient lorsqu’ils ont faim ; quand chaque jour il faut qu’il soit porté le long du rivage pierreux ou à travers la forêt vierge sur les épaules de gens plus jeunes[, ]il se retire. […] Le vieillard demande lui-même à mourir ; il insiste sur ce dernier devoir envers la communauté, et obtient le consentement de la tribu ; il creuse sa tombe ; il invite ses parents au dernier repas d’adieu. Son père a fait ainsi ; c’est maintenant son tour ; et il se sépare de son clan avec des marques d’affection. Il est si vrai que le sauvage considère la mort comme une partie de ses devoirs envers la communauté, que non seulement il refuse d’être sauvé (comme le raconte Moffat), mais qu’une femme qui devait être immolée sur le tombeau de son mari et qui fut sauvée par des missionnaires et emmenée dans une île, s’échappa la nuit, traversa un large bras de mer à la nage et rejoignit sa tribu, pour mourir sur le tombeau. […] Mais les sauvages, en général, éprouvent tant de répugnance à ôter la vie autrement que dans un combat, qu’aucun d’eux ne veut prendre sur lui de répandre le sang humain. Ils ont recours alors à toutes sortes de stratagèmes, qui ont été très faussement interprétés. Dans la plupart des cas, ils abandonnent le vieillard dans les bois, après lui avoir donné plus que sa part de nourriture commune. […]
[…] Je me rappelle combien j’ai essayé en vain de faire comprendre à mes amis Toungouses notre civilisation individualiste ; ils n’y arrivaient pas, et ils avaient recours aux suppositions les plus fantastiques. Le fait est qu’un sauvage, élevé dans les idées de solidarité de la tribu,– pour le bien comme pour le mal, – est incapable de comprendre un Européen « moral », qui ne connaît rien de cette solidarité, tout comme la plupart des Européens sont incapables de comprendre le sauvage. […]
[…]
En ce qui regarde la moralité, il me faut assigner aux Dayaks une place élevée dans l’échelle de la civilisation.., le brigandage et le vol sont tout à fait inconnus parmi eux. Ils sont aussi très véridiques… Si je n’obtenais pas toujours d’eux « toute » la vérité, au moins ce que j’obtenais d’eux était toujours la vérité. Je voudrais pouvoir en dire autant des Malais (pp. 209 et 210). […]
Le témoignage de Bock est pleinement corroboré par celui d’Ida Pfeiffer. « Je reconnais pleinement, écrit-elle, que j’aimerais voyager plus longtemps parmi eux. Je les ai trouvés généralement honnêtes, bons et réservés… et même beaucoup plus qu’aucune nation que je connaisse. » Stoltze emploie presque les mêmes mots en parlant d’eux. Les Dayaks n’ont généralement qu’une femme et ils la traitent bien. Ils sont très sociables, et chaque matin le clan entier sort pour pêcher, chasser ou jardiner en bandes nombreuses. Leurs villages consistent en grandes huttes, chacune d’elles est habitée par une douzaine de familles et quelquefois par plusieurs centaines de personnes, vivant pacifiquement ensemble. Ils montrent un grand respect pour leurs femmes et ils aiment beaucoup leurs enfants ; quand l’un d’eux tombe malade, les femmes le soignent chacune à leur tour. En général ils mangent et boivent d’une façon très modérée. Tel est le Dayak dans sa vraie vie de chaque jour.
Ce serait une fatigante répétition que de donner plus d’exemples de la vie sauvage. Partout où nous allons nous trouvons les mêmes habitudes sociables, le même esprit de solidarité. Et quand nous nous efforçons de pénétrer dans la nuit des temps lointains, nous trouvons la même vie du clan, les mêmes associations d’hommes, quelque primitifs qu’ils soient, en vue de l’entraide. Darwin avait donc tout à fait raison lorsqu’il voyait dans les qualités sociales de l’homme le principal facteur de son évolution ultérieure, et les vulgarisateurs de Darwin sont absolument dans l’erreur quand ils soutiennent le contraire.
[…]
Les primitifs, comme nous l’avons déjà dit, identifient tellement leur vie avec celle de leur tribu, que chacun de leurs actes, si insignifiant soit-il, est considéré comme une affaire qui les concerne tous. Leur conduite est réglée par une infinité de règles de bienséance non écrites, qui sont le fruit de l’expérience commune sur ce qui est bien et ce qui est mal, c’est-à-dire avantageux ou nuisible pour leur propre tribu. […] Le droit commun est sa religion ; ce sont ses mœurs mêmes. L’idée du clan est toujours présente à son esprit, et la contrainte de soi-même et le sacrifice de soi-même dans l’intérêt du clan se rencontrent quotidiennement. Si le sauvage a enfreint une des plus petites règles de la tribu, il est poursuivi par les moqueries des femmes. Si l’infraction est grave, il est torturé nuit et jour par la crainte d’avoir attiré une calamité sur sa tribu. S’il a blessé par accident quelqu’un de son clan et a commis ainsi le plus grand de tous les crimes, il devient tout à fait misérable : il s’enfuit dans les bois, prêt à se suicider, à moins que la tribu ne l’absolve en lui infligeant un châtiment physique et en répandant de son sang. À l’intérieur de la tribu tout est mis en commun ; chaque morceau de nourriture est divisé entre tous ceux qui sont présents ; et si le sauvage est seul dans les bois, il ne commence pas à manger avant d’avoir crié bien fort, par trois fois, une invitation à venir partager son repas pour quiconque pourrait l’entendre.
Pierre Kropotkine, L’Entraide: un facteur de l’évolution (1902), Kontre Kulture, 2014.2
Extraits du chap. III, “L’entraide parmi les sauvages”, p. 109-135 ; les emphases sont les nôtres et les notes de bas de pages ont été omises.
-
[NDLR] Les Bushmen et les Hottentots sont des peuplades d’Afrique ; les Ostiaks, les Samoyèdes, les Esquimaux, les Toungouses et les Tchoucktchis vivent en Sibérie et en Arctique ; les Aléoutes vivent en Alaska ; les Dayaks et les Papous sont des peuplades d’Indonésie ; les Sioux sont une peuplade d’indiens d’Amérique (qu’on peut voir dans le film Danse avec les Loups). ↩
-
En vente ici : http://www.kontrekulture.com/produit/l-entraide-un-facteur-de-l-evolution ↩