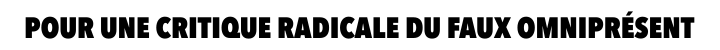La Guerre d'Espagne (partie 2)
Extraits du chapitre VI de Révolution et contre-révolution, (1934-1939).

Le reportage d’un anarchiste à Fraga détaille le fonctionnement concret de l’expérience révolutionnaire dans ce petit village :
Le produit de leur propre travail : blé, fruits, olives, etc., est librement disponible. Pour le reste de ses besoins, chaque famille touche une somme hebdomadaire qui augmente avec le nombre des membres de la famille et avec le nombre des travailleurs adultes. Cette somme n’est pas perçue en billets de la Banque d’Espagne ; d’ailleurs, ceux-ci seraient bien inutiles : ils n’ont aucune valeur dans la circulation fiduciaire de la ville. Des petites fiches imprimées par le syndicat d’une valeur nominale variant entre 10 centimes et 25 pesetas servent de bons d’achat. Ces fiches seules seront acceptées chez le coiffeur, le cordonnier ou à l’office de distribution des produits alimentaires importants dans la ville. Un voyageur qui veut séjourner dans la ville, doit aller au comité pour échanger son argent de la République espagnole contre des bons locaux. De même, si un habitant veut quitter la ville, il doit, lui aussi, s’adresser au comité en indiquant le motif de son voyage et la somme dont il a besoin ; le comité lui change alors ses bons locaux contre des billets espagnols.
Bien qu’il soit impossible de donner ici une image complète de ce qu’était alors la vie dans les villes et les villages libertaires, les descriptions suivantes permettront de s’en faire une idée. Dans Alcora, d’après un témoin, l’argent ne circulait plus :
Chacun reçoit ce dont il a besoin. De qui ? Du comité, naturellement. Il est toutefois impossible d’approvisionner 5 000 personnes au moyen d’un seul centre de distribution. Il y a des magasins à Alcora dans lesquels on peut pourvoir à ses besoins, comme auparavant, mais ces magasins ne sont plus que des centres de distribution. Ils appartiennent au village entier et leurs anciens propriétaires ne font plus de bénéfices. On ne paie surtout plus avec de l’argent, mais avec des bons. Le coiffeur même ne rase qu’en échange d’un bon. Les bons sont distribués par le comité. La théorie d’après laquelle les besoins de chaque habitant seront satisfaits n’est réalisée qu’assez imparfaitement, car on part du principe que tous ont les mêmes besoins. […] Chaque famille et chaque personne vivant seule a reçu une carte. Celle-ci est pointée chaque jour sur le lieu de travail auquel nul ne peut ainsi se soustraire. On se fonde sur ces cartes pour distribuer des bons. Et voici la grande lacune du système : faute jusqu’ici d’autre mode de mesure, on a dû avoir de nouveau recours à l’argent, pour calculer l’équivalent du travail accompli. Tous, ouvriers, commerçants, médecins, touchent pour chaque jour de travail des bons de la valeur de cinq pesetas. Une partie des bons porte la mention « pain » ; chaque bon a la valeur d’un kilo. Mais une autre partie représente explicitement une contre-valeur d’argent. Néanmoins, on ne peut pas considérer ces bons comme des billets de banque. On ne peut échanger contre eux que des biens de consommation et encore dans une mesure restreinte. Même si le montant de ces bons était plus grand, il serait impossible d’acquérir des moyens de production et de devenir ainsi capitaliste, fût-ce sur l’échelle la plus modeste, car seuls les biens de consommation sont en vente. Les moyens de production appartiennent tous à la communauté. La communauté est représentée par le comité. […] En ses mains se trouve tout l’argent d’Alcora, à peu près 100 000 pesetas. Le comité échange les produits du village contre d’autres produits qui font défaut, et ce qu’il ne peut pas se procurer par échange, il l’achète. Mais l’argent n’est tenu que pour un pis-aller, valable tant que le reste du monde n’aura pas encore suivi l’exemple d’Alcora. Le comité est le pater familias. Il possède tout, il dirige tout, il s’occupe de tout.Chaque désir spécial doit lui être soumis. Il juge seul en dernière instance. On peut objecter que les membres du comité risquent de devenir des bureaucrates ou même des dictateurs. Cela n’a pas non plus échappé aux paysans. Aussi ont-ils prévu que le comité serait renouvelé à bref délai, de sorte que chaque habitant en fera partie pendant un certain temps. Toute cette réglementation a dans son ingénuité quelque chose de touchant. Ce serait une erreur d’y voir plus qu’une tentative paysanne pour établir le communisme libertaire et de la critiquer trop sérieusement. n ne faut surtout pas oublier que les ouvriers agricoles et même les petits commerçants d’un tel village ont vécu jusqu’ici à un niveau de vie extrêmement bas. […] Avant la révolution, un morceau de viande était déjà un luxe pour eux, et seuls quelques intellectuels vivant parmi eux ont des désirs qui dépassent les nécessités immédiates.
En rapportant une conversation qu’il eut avec des paysans d’Alcora, cet observateur subtil nous fournit un exemple que l’on peut considérer comme typique du contrôle exercé par le comité sur la vie des habitants dans les villages libertaires :
– Que se passe-t-il si quelqu’un veut partir par exemple, pour aller en ville ?
– C’est très simple, répond-on. Il va au comité et se fait donner de l’argent pour ses bons.
– Alors, on peut échanger autant de bons que l’on veut contre de l’argent ?
– Non pas, évidemment.Ces braves gens sont quelque peu étonnés que je comprenne si difficilement.
– Mais quand alors peut-on avoir besoin de l’argent ?
– Aussi souvent qu’on en a besoin. Il faut seulement le dire au comité.
– Le comité examine donc les raisons ?
– Naturellement.Je suis un peu terrifié. Cette réglementation ne laisse survivre, me semble-t-il, que bien peu de liberté dans le communisme libertaire, et je cherche quelles peuvent être les raisons pour voyager qu’admette le comité d’Alcora. Je ne trouve pas grand chose, mais je continue à questionner.
– Si quelqu’un a une fiancée en dehors du village, reçoit-il de l’argent pour lui rendre visite ?
Les paysans me rassurent : il en reçoit.
– Aussi souvent qu’il veut ?
– Dieu merci, on peut d’Alcora aller voir sa fiancée tous les soirs si on en éprouve le désir.
– Mais si quelqu’un veut aller en ville au cinéma, lui donne-t-on aussi de l’argent ?
– Oui.
– Aussi souvent qu’il veut ?Les paysans commencent à douter de ma raison.
– Les jours de fête, bien entendu. Il n’y a pas d’argent pour le vice.
Un autre témoin évoque le village libertaire de Castro :
Le caractère saillant du régime anarchiste établi à Castro, c’est l’abolition de l’argent. Les échanges sont supprimés ; la production a très peu changé. […] Le comité gère les domaines expropriés : ceux-ci n’ont pas été regroupés et continuent à être exploités séparément par les ouvriers agricoles qui y étaient précédemment employés. Les salaires en argent ont bien sûr été abolis. Il serait inexact de dire qu’ils ont été remplacés par des paiements en nature ; il n’existe aucune sorte de paiement, les paysans reçoivent directement leur subsistance des magasins du village. Dans ces conditions, l’approvisionnement est déplorable. Encore pire, oserais-je dire, qu’il pouvait l’être auparavant, dans les conditions misérables qui sont celles du bracero andalou. Castro a la chance de posséder des champs de blé en plus des olives qui sont la seule ressource des pueblos voisins. Au moins est-on assuré d’avoir du pain. Il y a en outre d’importants troupeaux de moutons, expropriés en même temps que les terres, qui fournissent de la viande de boucherie. Et encore un bureau de tabac. Mais c’est tout. Le bar du village a été fermé, car c’était un lieu de perdition. Je suis allé voir les magasins : à en juger par ce qu’ils offrent, on est au bord de la famine. Mais les habitants semblent tirer fierté de cet état de choses. Ils nous ont même déclaré être contents qu’il n’y ait plus de café à boire. Ils paraissent considérer comme une victoire morale la disparition de tous les biens superflus. Quant aux objets de première nécessité qu’ils devront se procurer à l’extérieur, vêtements surtout, ils comptent les obtenir par voie de troc, en écoulant leur surplus d’olives. […] Leur haine des classes aisées a des fondements beaucoup plus moraux qu’économiques. Ils ne convoitent pas la belle vie de ceux qu’ils ont expropriés, mais veulent supprimer tous les biens superflus, qu’ils considèrent comme autant de vices. Leur conception de l’ordre nouveau qu’ils espèrent instituer est totalement ascétique.
Le puritanisme était une dimension importante du mouvement libertaire1. D’après George Esenwein, une autorité sur l’anarchisme espagnol, c’était même « l’une des dimensions de l’idéologie anarchiste que l’on peut observer dès le début du mouvement en 1868 et jusqu’à la guerre civile. Cette tendance, fondée sur la reconnaissance d’une dichotomie morale entre le prolétariat et les classes moyennes, invoquait avant tout un mode de vie libéré des valeurs matérialistes. Ainsi, les excès de boisson, le tabac et d’autres pratiques considérées comme des attributs de la classe moyenne étaient presque toujours critiqués »2. Dans le village libertaire de Magdalena de Pulpis par exemple, la prohibition de l’alcool et du tabac fut saluée comme un triomphe. Dans le village d’Azuara, les collectivistes firent fermer le café qu’ils considéraient comme une « institution frivole ».
Un anarchiste ne doit pas fumer - pouvait-on lire dans le périodique anarchiste La Revista Blanca. Un anarchiste ne doit rien faire qui puisse nuire à sa santé, surtout si cela coûte de l’argent.
Un anarchiste ne doit pas non plus aller au bordel :
L’homme qui fréquente les maisons mal famées ne peut être un anarchiste. […] Si l’anarchiste n’est pas supérieur aux autres hommes, il ne peut se prétendre anarchiste. […] Celui qui achète un baiser se met au niveau de la femme qui le vend. C’est pourquoi l’anarchiste ne doit pas acheter les baisers, il doit les mériter.
Les anarchistes croyant en l’amour libre, ou “union libre”, il fallait parfois faire des compromis avec les autres habitants du village. Le célèbre écrivain et militant anarchiste français Gaston Leval, qui visita Magdalena de Pulpis pendant la guerre, évoque ce cas :
Nous avons demandé des renseignements sur les mariages. Nos camarades sont, naturellement, partisans de l’union libre. Mais un mariage est un événement dont les villages paisibles ne se passent pas de bon gré. D’autre part, suivre le procédé officiel eût été démentir les principes. Il fallait donc trouver un moyen de marier les gens légalement sans le faire. Et voici le procédé : Quatre couples se sont unis depuis le début de la révolution. Ils se sont présentés, accompagnés de leur famille et de leurs amis, devant le secrétaire du comité. On a inscrit sur un registre leurs noms et prénoms ; leur âge et leur volonté de s’unir. L’habitude était respectée, la fête assurée. Et pour la compléter, en même temps que pour sauver les principes libertaires, le secrétaire arrachait la page où figuraient toutes ces inscriptions, la déchirait en petits morceaux pendant que les mariés descendaient l’escalier, et quand ceux-ci passaient sous le balcon, les lançait sur eux comme des confettis. Tout le monde était content.J’ai expliqué qu’il était nécessaire de conserver la mémoire de ces mariages, des naissances et des décès, ne serait-ce que pour les études sociales que seuls ceux qui n’étudient rien peuvent dédaigner. On m’a compris et on m’a promis de le faire et de reconstituer les registres disparus.
Dans le village anarchiste de Graus, selon le témoignage d’un socialiste, le niveau de vie était plus élevé qu’avant la guerre.
La terre, les moulins, le bétail, le commerce, les transports, les ateliers des artisans, des sandaliers, l’aviculture, les professions libérales sont intégrés au système collectif. Le village est une unité économique au service du bien général et des intérêts collectifs. Il y a du travail pour tous. Il y a du bien-être pour tous. La misère, l’esclavage ont été chassés de ce village. […] Une puissante sirène règle la vie du village, marquant les heures de travail, de rafraîchissement et de repos. […] Les hommes âgés de plus de 6o ans sont exempts de travail. […] C’est une des règles premières de la collectivité. […] Quand un membre de la collectivité décide de se marier, on lui donne une semaine de congé sans rien lui ôter de son salaire. On lui cherche une maison - les logements aussi sont collectivisés - et on lui fournit des meubles […] qu’il paie peu à peu, sans verser aucun intérêt. Tous les services de la collectivité sont prêts à répondre à ses besoins. De sa naissance à sa mort, il est protégé par la collectivité.
Un anarchiste écrivait au sujet du village de Membrilla :
Le 22 juillet, les gros propriétaires étaient expropriés, _la petite propriété dissoute et toute la terre passait à la commune. Les petits propriétaires reconnaissaient toutes ces mesures qui les débarrassaient eux-mêmes de leurs dettes et de leurs soucis concernant les salaires. La caisse communale était vide. Dans la propriété privée, on trouvait en tout et pour tout 30 ooo pesetas qui furent saisies. On distribua équitablement tous les aliments, vêtements, outils, etc., à la population. L’argent fut aboli, le travail collectivisé, les biens passèrent à la communauté, la consommation fut socialisée. Pourtant, ce n’était pas une socialisation des richesses, c’était celle de la pauvreté. […] Il n’y a plus de commerce de détail ; c’est le régime du communisme libertaire. La pharmacie est gérée par son ancien propriétaire, dont les finances sont contrôlées par la commune. […] Trois litres de vin sont distribués par personne et par semaine. Loyer, électricité, eau, soins de médecin et médicaments sont gratuits. La consultation d’un médecin spécialiste hors de la commune est payée par le comité si c’est nécessaire. J’étais assis près du secrétaire quand une femme vint demander à partir pour Ciudad Real consulter un spécialiste pour ses maux d’estomac. Sans tergiversations bureaucratiques, elle toucha immédiatement le prix de son voyage.
Le comité du village libertaire d’Albalate de Cinca, dont le pouvoir de donner ou de refuser l’argent confinait à l’autocratie, était beaucoup moins diligent, comme le rapporte l’influent anarcho-syndicaliste allemand Augustin Sauchy :
Une femme voulait aller à Lérida consulter un spécialiste. Elle arriva à 7 heures du matin. […] Les membres du comité travaillaient aux champs dans leur groupe respectif. lls s’occupaient, pendant leur temps libre, de la commune et de l’organisation [la CNT].
— Pour obtenir l’argent du voyage, tu dois d’abord te procurer un certificat du médecin, expliqua le président à la femme.
Cette réponse ne satisfaisait pas la vieille dame. Elle se plaignait de rhumatismes et essaya d’émouvoir le comité pour obtenir l’argent sans certificat : mais en vain.
— Il y en a – expliqua le président – qui abusent des possibilités que leur offre maintenant la collectivité. Beaucoup n’allaient même jamais à la ville, avant. Certains vieux villageois ne connaissaient de la ville que le collecteur d’impôts. Maintenant qu’ils peuvent voyager gratuitement, ils exagèrent un peu.
L’explication donnée par le président était peut-être partiale. Le médecin aurait pu fournir un avis plus objectif sur le problème.
Dans son histoire orale, Fraser, qui a parlé des années après avec des survivants des collectivités, fait cette intéressante observation :
Avec l’abolition de l’argent, la collectivité avait le contrôle sur ses membres puisque quiconque voulait voyager devait demander de l’argent “républicain” au comité. Cela signifie qu’il devait justifier le voyage. […] À Mas de las Masas, la collectivité se targuait d’envoyer les gens à Barcelone pour consulter des spécialistes. […] Mais d’après un homme de droite, celui qui n’était pas syndiqué, s’il voulait quitter le village, même brièvement, devait obtenir un laissez-passer. […] Dans le village d’Alloza, la mauvaise santé était considérée comme une justification valide et le beau-père du maître d’école partit pour se faire opérer d’une hernie, et il en profita pour ne pas revenir. […] Bien sûr, les conditions étaient différentes dans chaque collectivité et, comme pour beaucoup d’autres aspects, il est impossible de généraliser.
Augustin Souchy a décrit différents aspects de la vie dans les villages libertaires qu’il a pu visiter ; voici ce qu’il dit du village de Calaceite :
Il y avait auparavant dans ce village […] de nombreux cultivateurs, quelques forgerons et quelques menuisiers qui travaillaient seuls dans de petits ateliers ; leur outillage était rudimentaire et leurs méthodes de travail archaïques. Le collectivisme leur a ouvert une nouvelle voie, celle du travail en commun. Il existe maintenant une grande forge : 12 hommes y travaillent ; ils disposent d’un outillage moderne ; les locaux sont salubres et clairs. Tous les ouvriers du bois du village travaillent ensemble dans une vaste menuiserie. […] Les ouvriers (agricoles) valides ont été répartis en 24 groupes de travail. Chaque groupe comprend 20 hommes. Ils travaillent collectivement les terres de la commune selon un programme préétabli. Auparavant, chacun travaillait pour soi ; désormais, chacun travaille pour les autres. […] Il y a au village un médecin et deux pharmaciens. Ils font partie de la collectivité. Non parce qu’on les y a forcés mais parce que c’était leur souhait. ll y a eu un conflit avec les boulangers. Ils ne voulaient ni s’intégrer à la collectivité, ni travailler dans les nouvelles conditions. Ils ont quitté le village. On n’a pas fait appel à d’autres boulangers. On a trouvé une solution provisoire : les femmes font le pain comme autrefois. Mais le village souhaite que de nouveaux boulangers s’installent à Calaceite. Avant, les villageois étaient pauvres. Aujourd’hui, ils sont contents. Avant, beaucoup avaient faim ; aujourd’hui, ils ont de quoi manger.
Un rapport de la CNT sur la zone de Valderrobres, dans la province de Teruel, affirme :
La collectivisation souleva toutefois des oppositions chez nos ennemis à droite et nos adversaires à gauche. Si l’on avait demandé aux éternels oisifs expropriés ce qu’ils pensaient de la collectivité, certains auraient parlé de vol et d’autres de dictature. Mais pour les anciens, les journaliers, les fermiers et les petits propriétaires qui avaient toujours vécu sous la férule des grands propriétaires et des usuriers sans cœur, c’était le salut.
Souchy écrit encore, à propos du village de Calanda :
Ce qui était il y a peu une église est devenu un entrepôt de nourriture. […] La boucherie refaite à neuf, salubre et d’aspect engageant, se trouve dans une annexe de l’église ; le village n’en a jamais connu de semblable. On n’obtient rien contre de l’argent. Les femmes reçoivent la viande en échange de bons. Elles ne doivent rien payer, ni rendre aucun service ; elles appartiennent à la collectivité et cela suffit pour qu’on leur donne les aliments. […] Collectivistes et individualistes cohabitent en paix. Le village possède deux cafés. L’un réservé aux individualistes, l’autre aux collectivistes. Ils peuvent se permettre le luxe de servir du café tous les soirs. […] La salle commune de la boutique du barbier offre un magnifique exemple d’esprit collectif. Avant les paysans ne se rasaient pas. On peut voir maintenant dans le village presque tous les visages bien rasés. Le barbier est gratuit. Tout le monde peut se faire raser deux fois par semaine. […] Chaque villageois reçoit cinq litres de vin par semaine. La nourriture ne manque pas. [ ..] Ici tout est collectivisé, à l’exception des petits commerces dont les propriétaires ont préféré rester indépendants. La pharmacie appartient à la collectivité, le médecin aussi. ll ne reçoit pas d’argent. Les autres membres de la collectivité pourvoient à ses besoins.
Un article de Tierra y Libertad déclarait à propos du village de Maella :
L’argent, camarades, a disparu. Dans ce village, les médecins ne se font pas payer, pas plus que les maîtres d’école. lis ont volontairement renoncé à cet absurde privilège ; absolument personne ne se fait payer.
À Muniesa, rapporte Souchy, le pain, la viande et l’huile étaient distribués gratuitement, mais à la différence de la plupart des villages libertaires, il y restait encore un peu d’argent en circulation :
Chaque travailleur homme reçoit une peseta par jour. Les enfants de moins de 10 ans 50 centimes. Les jeunes-filles et les femmes : 75 centimes3. Il ne faut pas considérer cet argent comme un salaire ; on le distribue en même temps que les aliments les plus nécessaires pour que les villageois achètent eux-mêmes les marchandises accessoires.
Les mouvements ouvriers espagnols, et plus particulièrement les anarchistes, avaient toujours professé des opinions farouchement antireligieuses et anticléricales. Dès les années 1870, l’Alianza de la Democracia Socialista, précurseur de la FAI, avait réclamé « l’abolition des cultes, la substitution de la foi par la science et celle de la justice divine par la justice humaine ». L’anarchiste russe Bakounine, qui était l’un des maîtres à penser des libertaires espagnols, avait déclaré que « l’existence d’un dieu est incompatible avec le bonheur, la dignité, l’intelligence, la morale et la liberté des hommes ; car s’il y a un dieu, mon intelligence, aussi grande soit-elle, ma volonté, aussi forte soit-elle, ne sont rien comparées à la volonté et à l’intelligence divines ». Il affirmait dans Dieu et l’État que le peuple avait trois moyens d’échapper à sa condition : deux qui relevaient de l’imagination et un de l’intelligence.
Les premiers sont la taverne et l’église, la débauche du corps et celle de l’esprit, la troisième est la révolution sociale.
L’opinion des anarchistes espagnols sur la religion n’avait pas changé depuis l’époque de Bakounine et de l’Alianza :
« L’humanité n’entrera pas dans cette ère nouvelle de justice et de liberté tant qu’elle continuera à s’agenouiller devant Dieu ou à se soumettre humblement à l’État », pouvait-on lire dans Tierra y Libertad le 5 juin, peu de temps avant le début de la guerre civile. Et au tout début de la révolution, CNT, le principal organe libertaire de Madrid, publiait l’éditorial suivant :
Il faut balayer implacablement le catholicisme ; nous ne demandons pas la destruction de toutes les églises, mais nous voulons qu’il ne demeure de vestiges du culte religieux dans aucune d’entre elles, et que la noire araignée du fanatisme ne puisse à nouveau tisser la toile poussiéreuse et visqueuse dans laquelle nos valeurs morales et matérielles ont été emprisonnées jusqu’à aujourd’hui comme des mouches. En Espagne, plus que partout ailleurs, l’église catholique a été l’instigatrice de toutes les mesures rétrogrades, de toutes les actions menées contre le peuple, de toutes les attaques contre la liberté.
Selon Souchy, dans le village de Mazaleòn, « le mysticisme catholique n’existe plus. Les prêtres ont disparu. Le culte chrétien a pris fin. Mais les paysans ne voulaient pas détruire l’édifice gothique qui couronne majestueusement le sommet de la montagne. Ils ont agrandi les fenêtres de l’église et démoli l’autel afin de disposer d’une longue galerie. De là, on embrasse du regard le contrefort méridional des montagnes aragonaises. C’est un lieu paisible, propice à la réflexion. Les villageois y viennent le dimanche goûter le calme des fins d’après-midi en prenant un café. » Il y avait dans presque toutes les régions aux mains des antifranquistes d’ardents révolutionnaires qui, exaltés par les progrès initiaux du mouvement de collectivisation dans les villages - se traduisant aussi bien sous la forme d’un communisme libertaire englobant effectivement tous les domaines que sous une forme plus restreinte limitée à l’agriculture -, continuaient à le faire progresser avec une énergie violente. Ils avaient foi en la grandeur et en l’équité de leur mission et étaient décidés à l’accomplir partout où ils le pourraient et sans différer :
Nous sommes en pleine révolution - déclarait un farouche libertaire - et nous devons briser toutes les chaînes qui nous assujettissent. Quand le ferons- nous, si ce n’est maintenant ? Il faut aller vers la révolution totale et l’expropriation totale. Ce n’est pas le moment de dormir, mais de reconstruire. Quand nos camarades reviendront du front, que diront-ils si nous avons dormi ? Si l’ouvrier espagnol n’est pas capable d’édifier sa propre liberté, l’État reviendra pour rétablir l’autorité du gouvernement et détruire peu à peu les conquêtes obtenues au prix de tant de sacrifices et de tant d’actions héroïques. L’arrière doit agir avec force et fermeté afin que le sang du prolétariat espagnol ne soit pas versé pour rien. Nous ne pouvons pas être un instrument de la bourgeoisie. Nous devons accomplir notre révolution, notre propre révolution, en expropriant, en expropriant encore et encore les propriétaires fonciers et tous ceux qui sabotent nos aspirations.
Au cours d’un congrès réunissant les délégués des fermes collectives d’Aragon, l’un d’eux déclara que la collectivisation devait être introduite dans tous les domaines et qu’il ne fallait pas suivre l’exemple des villages qui ne l’avaient que partiellement adoptée. Cette déclaration est caractéristique de l’état d’esprit de milliers de fervents partisans de la collectivisation de la terre qui ne craignaient nullement de s’attirer l’intimité des propriétaires et des métayers, pour qui le droit d’exploiter individuellement la terre était inaliénable. Ils avaient le pouvoir entre leurs mains et ne prêtaient aucune attention aux mises en garde réitérées de leurs dirigeants, comme, par exemple, celle qui leur fut adressée au congrès des syndicats de paysans de la CNT de Catalogne, les avertissant que la mise en place de la collectivisation intégrale risquait de s’exposer à « un échec car elle se heurte à l’amour, à l’attachement profond que les paysans éprouvent pour cette terre, qui leur a coûté tant de sacrifices », comme le dit Ramon porté délégué de la province de Tarragone et membre du comité régional de la CNT de Catalogne, dans un discours où il rappelle que d’autres orateurs ont formulé des avertissements semblables.
Même si les publications de la CNT-FAI citent de nombreux cas de propriétaires exploitants et de métayers volontairement ralliés au collectivisme, il ne fait aucun doute que dans leur immense majorité, ils y étaient farouchement opposés ou ne l’acceptaient que sous de violentes contraintes. Les anarcho-syndicalistes reconnurent parfois la profonde hostilité que les petits propriétaires et les métayers éprouvaient à l’égard de la collectivisation de la terre, bien qu’ils aient parfois déclaré en être venus à bout.
[Ce] contre quoi nous avons le plus lutté - affirmait le secrétaire général de la Fédération de paysans (CNT) de Castille - c’est la mentalité rétrograde de la plupart des petits propriétaires. Essaie d’imaginer ce que suppose pour le petit propriétaire, habitué à sa petite propriété, à sa petite parcelle, à son âne, à sa misérable maison, à son insignifiante récolte annuelle à laquelle il est plus attaché qu’à ses enfants, à son épouse et à sa mère, le fait de devoir se défaire de ce fardeau qu’il traîne depuis des temps immémoriaux, et de dire : “Prenez, camarades. Mes pauvres biens sont pour tous. Les uns ne sont pas supérieurs aux autres. Une vie nouvelle s’ouvre devant nous. Nous devons travailler tous en commun. Nous sommes tous égaux.” Et c’est pourtant ce que nous avons obtenu du paysan castillan ! On n’entend plus à la campagne, quand meurt un enfant, ce déchirant dicton si répandu : “Les petits anges vont au ciel !” Sous le régime capitaliste, le paysan était bouleversé quand sa mule ou son âne mourait alors qu’il demeurait impassible quand il perdait un enfant. C’était naturel. Sa petite propriété lui coûtait d’immenses sacrifices, pas son enfant. Souvent, la mort des enfants en bas âge apportait une solution aux problèmes pécuniaires du foyer.
Même en Aragon, où les paysans écrasés de dettes étaient volontiers influencés par les idées de la CNT et de la FAI, facteur qui poussait à la collectivisation spontanée des terres, les libertaires eux-mêmes ont souvent reconnu les difficultés qu’ils avaient à la faire accepter. « Ce fut une tâche ardue et compliquée et qui le demeure - affirma l’un d’eux au sujet du village de Lécera. Nous voulons parvenir à convaincre les hommes du désintéressement et de la supériorité de nos idées. »
S’il est vrai que la collectivisation rurale concernait en Aragon plus de 70 % de la population dans la zone contrôlée par la gauche 4 , et que parmi les 450 collectivités 422 de la région, beaucoup s’étaient librement créées, il ne faut pas oublier que ce singulier développement de la collectivisation était dû dans une certaine mesure à la présence de miliciens originaires de la région voisine de Catalogne, dont l’immense majorité faisait partie de la CNT et de la FAI. il ne pouvait pas en être autrement car après la défaite de l’insurrection militaire à Barcelone ; ils étaient venus en Aragon, non seulement pour continuer la lutte contre les forces du général Franco qui occupaient une partie importante de la région, mais également pour diffuser la révolution.
Nous faisons la guerre et la révolution en même temps - déclarait Buenaventura Durruti, un des principaux dirigeants du mouvement libertaire5 , qui commandait une colonne de miliciens de la CNT-FAI sur le front aragonais. Ce n’est pas uniquement à Barcelone que l’on prend des mesures révolutionnaires destinées à l’arrière, car de là, elles s’étendent jusqu’au front. Chaque village que nous conquérons commence à se développer de manière révolutionnaire.
Notre devoir à nous miliciens est de réveiller chez ces gens un esprit engourdi par la tyrannie séculaire, de leur montrer le chemin de la vie authentique, et cette mission exige de nous plus qu’un acte de présence dans ce village - déclarait un journal de la CNT à propos du village de Farlete. Il nous faut entreprendre la conversion idéologique de ces humbles villageois.
À propos du village de Bujaraloz, on pouvait lire dans un autre journal de la CNT :
Le changement est radical. Ce sont les paysans qui en ont pris l’initiative, et ils ont été affermis dans leur résolution quelques jours plus tard par la première colonne de volontaires catalans, la “Durruti”, qui se rendant à Saragosse, est passée dans le village ; l’exemple de ces hommes qui allaient au combat donna une nouvelle impulsion à leur ardeur révolutionnaire.
C’est pourquoi, dans les communautés occupées par les miliciens de la CNT-FAI, le sort des propriétaires exploitants et des métayers était fixé d’avance ; car bien que l’on réunît généralement la population pour qu’elle décidât de l’établissement du système collectif, on votait toujours par acclamation et la présence de miliciens en armes ne manquait jamais d’inspirer le respect et la crainte à tous les opposants. Même s’ils n’étaient pas obligés d’adhérer au système collectiviste, la vie était plus difficile pour les récalcitrants ; il leur était interdit d’employer de la main-d’ œuvre salariée et de disposer librement de leur récolte, comme nous l’avons déjà dit6, mais on leur refusait aussi tous les avantages réservés aux membres de la communauté. Cela se traduisait dans la pratique par une interdiction de se rendre à la boutique collectivisée du coiffeur, d’utiliser les fours de la boulangerie communale et l’outillage des fermes collectivisées, d’emprunter les moyens de transport et de se procurer des denrées alimentaires dans les magasins communaux ou dans les boutiques collectivisées. En outre, le métayer qui, après l’exécution ou la fuite du propriétaire ou de l’intendant des terres qu’il cultivait, s’était cru libéré de l’obligation d’en payer le loyer, était bien souvent contraint de continuer à le verser au comité du village. Toutes ces mesures se révélèrent presque aussi convaincantes que la crosse d’un fusil et obligèrent finalement, dans de nombreux villages, les petits propriétaires et les métayers à se dessaisir de leurs terres et de leurs autres biens au profit de la collectivité. Voici le témoignage de l’anarcho-syndicaliste allemand Augustin Souchy :
Les petits propriétaires qui renoncèrent à leurs terres, à leur entreprise, etc., pour obéir à un idéal, étaient peu nombreux, mais le cas n’était cependant pas exceptionnel. La crainte de la réquisition par la force était parfois la cause de l’abandon de leurs biens aux collectivités7. Cependant, le plus souvent ils s’en dessaisissaient pour des motifs économiques. _Isolé, abandonné à son sort, le petit propriétaire se sentait perdu. Il n’avait ni moyen de transport ni outillage. Par contre, les collectivités disposaient d’un équipement qu’il n’aurait jamais pu s’offrir. Les petits paysans ne le comprirent pas tous immédiatement. La plupart du temps, ils s’intégrèrent peu à peu aux collectivités et seulement après qu’elles eurent fait leurs preuves.
Dans de rares cas, selon l’auteur anarchiste français Gaston Leval, le petit propriétaire recevait une meilleure terre en échange de sa parcelle intégrée à une zone collectivisée. À propos de Carcagente, dans la région de Valence, il écrit :
Après la fuite des grands propriétaires, la culture de la terre fut entièrement réorganisée […] sans qu’il n’y ait nul besoin de recourir à la force. Ces paysans qui avaient insisté pour conserver leur parcelle individuelle et dont les terres se trouvaient au milieu d’une zone collectivisée se virent offrir de meilleures terres ailleurs et reçurent également de l’aide pour leur nouvelle installation, à condition qu’ils n’exploitent personne. Mais ces cas furent rares.
De fait, de nombreux petits propriétaires et métayers furent en réalité contraints d’entrer dans les collectivités avant d’avoir eu le temps de prendre librement une décision. Bien qu’il y eût au sein du mouvement libertaire une tendance à minimiser l’importance de la coercition et même à nier son existence, elle était parfois reconnue en toute franchise. « Dans les premières semaines de la révolution, les partisans de la collectivisation agissaient selon leur opinion révolutionnaire ; ils ne respectaient ni les intérêts ni les personnes. Dans quelques villages, la collectivisation n’était possible qu’en s’imposant à la minorité. C’est une nécessité qui surgit dans chaque révolution. […] Le système, certes, est bon, et on a fait de bonnes besognes en beaucoup d’endroits ; mais il est navrant de voir dans certains autres se créer des antipathies qui sont dues au manque de tact des collectivités », écrivait un membre influent de la CNT, Higinio Noja Ruiz.
On pouvait lire dans l’organe de la CNT, Solidaridad Obrera ( 10 septembre 1936), à propos de la riche Catalogne, région où la masse des paysans était composée de petits propriétaires ou de métayers :
On a commis dans la campagne catalane certains abus qui, selon nous, ont été contre-productifs. Nous savons que certains éléments irresponsables ont effrayé les petits cultivateurs qui, jusqu’ici, manifestent une certaine apathie dans leur travail quotidien.
Peu de temps après, Joan Peiro, une des grandes figures de la CNT, écrivait a propos de cette région :
Peut-on croire […] qu’en commettant des actes de violence, on éveillera chez nos paysans un intérêt ou une attirance pour la socialisation, ou qu’en les terrorisant de cette façon, ils acquerront cet esprit révolutionnaire qui règne dans les villes ? La gravité de l’erreur que l’on est en train de commettre m’enjoint de parler sans détours. De nombreux révolutionnaires originaires de différents endroits de la Catalogne, […] après avoir conquis leur ville respective, ont voulu conquérir la campagne, la paysannerie. Ont-ils tenté d’y parvenir en faisant comprendre aux paysans que l’heure était venue pour eux de se libérer de l’exploitation dont ils étaient victimes depuis des siècles ? Eh bien, non ! Ont-ils alors tenté d’introduire à la campagne l’esprit et la morale révolutionnaires et d’en faire prendre conscience au paysan et au petit propriétaire ? Non plus. Quand ils sont arrivés à la campagne, apportant avec eux la torche de la révolution, ils ont commencé par enlever au paysan tout moyen de défense […] et après cela, ils lui ont volé jusqu’à sa chemise. Si vous allez aujourd’hui dans certains lieux de Catalogne pour parler au paysan de la révolution, il vous dira qu’il n’a pas confiance en vous, il vous dira que les émissaires de la révolution ont déjà parcouru la campagne. Pour la libérer ? Pour l’aider à se libérer ? Non. Ils sont venus pour voler ceux qui au fil des ans, au cours des siècles ont été volés par ceux-là mêmes que la révolution vient de vaincre.
Obliger un individu à s’intégrer à une collectivité par quelque moyen que ce soit était bien sûr contraire à l’esprit de l’anarchisme. L’Italien Errico Malatesta, dont les écrits ont fortement influencé le mouvement libertaire espagnol, déclarait en 1929 :
Certains peuvent opter pour le communisme, l’individualisme, le collectivisme ou pour tout autre système imaginable et par la propagande et l’exemple travailler au triomphe de leurs idées, mais il est indispensable de se garder d’affirmer, sous peine d’un désastre inévitable, qu’il n’est d’autre système que le sien, qu’il est le seul à être infaillible et valable pour tous les hommes, indépendamment de l’endroit et de l’époque, et qu’on doit le faire triompher par d’autres moyens que la persuasion découlant des leçons de l’expérience.
Et il écrivait dans Umanità Nuova :
La révolution a un but. Elle est nécessaire pour détruire la violence des gouvernements et des privilégiés ; mais une société libre ne peut se former qu’en évoluant librement. Et les anarchistes doivent veiller sur cette évolution qui sera constamment menacée tant qu’il y aura des hommes avides de pouvoir et de privilèges.
Cependant, même cette surveillance impliquait, si elle se voulait opérante, l’existence de forces armées, d’éléments d’autorité et de coercition. De fait, au cours de la révolution espagnole, qui fut la première grande révolution sociale à se produire après que ces lignes eurent été écrites, la CNT et la FAI créèrent une force armée qui protégea les collectivités et servit à étendre le système collectif. Le fait que ces méthodes répugnaient à certains dirigeants anarchistes fait ressortir le profond écart qui sépare la doctrine de la pratique. Quarante ans après les faits, la dirigeante de la CNT-FAI Federica Montseny répondait aux questions d’ Agusti Pons sur les patrullas de control, les patrouilles de police révolutionnaires formées par les anarcho-syndicalistes et d’autres organisations de gauche à Barcelone :
— Pons : Rétrospectivement, quelle est votre opinion sur les patrullas de control ?
— Montseny [Anarchiste qui finira ministre] : Le problème concernait toutes les organisations, pas seulement la nôtre. […] Ce qui s’est passé, c’est que les hommes les plus compétents sont restés dans les collectivités. Ce sont eux qui ont maintenu les usines en marche. Les plus audacieux et les plus idéalistes sont allés se battre au front. […] Ceux qui restaient n’étaient ni courageux ni compétents. […] La majorité de nos camarades étaient idéalistes. Ils étaient dégoûtés par le travail de la police et ils ne voulaient pas le faire. […] Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu des personnes de valeur qui ont fait ce travail parce qu’ils jugeaient qu’un « nettoyage » était nécessaire. […] Mais c’était une minorité.
— Pons : L’activité des patrullas de control ne fut-elle pas un facteur déterminant dans le revirement d’une partie importante des artisans et de la petite bourgeoisie qui avait d’abord soutenu la République et qui finit par être plus ou moins favorable à l’entrée des troupes de Frànco ? Montseny : En fait, les patrullas de control sont devenues corrompues. Ceux qui y entraient se transformaient en policiers professionnels et devinrent obsédés par les conspirations, l’espionnage et l’ennemi. […] Je suis arrivé à la conclusion suivante : que vous les appeliez patrullas de control GPU ou autre, vous êtes perdus dès lors que vous leur donnez des pouvoirs de police, même si elles sont un produit de la révolution, car vous avez créé une mentalité policière. C’est arrivé dans notre cas, mais aussi en Russie et pendant la Révolution française. Et cela arrivera dans toutes les révolutions […] et il y aura toujours des excès que l’on regrette tous par la suite.
[…]
[…] Malgré les écarts entre la doctrine et la pratique qui apparurent dès que les anarchistes espagnols ont été confrontés aux réalités du pouvoir, on ne soulignera jamais assez qu’en dépit des nombreux cas de violence, la révolution de juillet 1936 s’est distinguée de toutes les autres par l’ampleur et la relative spontanéité de son mouvement collectiviste et par sa promesse de renouveau moral et spirituel. Aucun mouvement spontané de ce type ne s’était encore jamais produit. « Comme nul autre mouvement social dans l’histoire moderne de l’Europe - écrit George Esenwein - le mouvement collectiviste a tenté, à une très large échelle, de triompher de l’appauvrissement non seulement matériel, mais aussi spirituel, qui touchait des millions de vies. Ainsi, l’un des traits essentiels de la plupart des collectivités était un très fort sens de la solidarité sociale : pour la première fois, des programmes furent mis en place pour apporter aide et soins médicaux aux orphelins, aux veuves, aux infirmes et de manière générale, à toutes les personnes dans le besoin. […] À ce stade, il est essentiel de souligner que pour comprendre les complexités des luttes intestines qui ont déchiré [le prolétariat] pendant la guerre civile, il faut avant tout reconnaître l’ampleur et la profondeur de la révolution sociale et le fait que la République de 1931 cessa d’exister non pas en avril 1939, avec la victoire du général Franco, mais en juillet 1936, lorsque la rébellion militaire et la révolution sociale ont réduit le régime en cendres.
Burnett Bolloten, La Guerre d’Espagne. Révolution et contre-révolution (1934-1939)8, Agone, coll. « Mémoires sociales », 2014. Extraits du chap. VI, p. 107-114 (l’appareil de référence, très fourni, a été réduit à son plus strict minimum). Traduit de l’anglais par Étienne Dobenesque.
-
Je me souviens que la classe moyenne espagnole se moquait de ces anarchistes qui fermaient les bordels dans les villes et confiaient aux prostituées des travaux utiles. Mais pour les puristes anarchistes, le nettoyage de la société était un article de foi. Dans son histoire orale, Ronald Fraser cite le jeune Eduardo Pons Prades qui, au siège du Syndicat des travailleurs du bois (CNT) à Barcelone, situé tout près du Paralelo, avec ses bars, ses boîtes de nuit et ses cabarets, avait entendu la conversation suivante :
— Que faire de tous ces gens qui travaillent dans ces lieux de perdition ?
— Nous devons les sauver, les éduquer, pour qu’il aient une chance d’avoir une activité plus digne.
— Leur avez-vous demandé s’ils veulent être sauvés ?
— Êtes-vous si idiot ? Voudriez-vous être exploité dans un de ces lieux de perdition ?
— Non, bien sûr que non. Mais quand on fait la même chose depuis des années, il est difficile de changer.
— Eh bien, ils devront changer. La première tâche de la révolution est de nettoyer les lieux, nettoyer la conscience des gens.À propos du village de Mas de las Matas, en Aragon, Fraser écrit : Toutes les tavernes furent fermées. “Nous autres libertaires, avons toujours été hostiles aux cafés parce qu’ils poussent au vice, aux querelles et aux bagarres”, expliquait Sevilla Pastor. […] Seule la grande salle du siège de la CNT resta ouverte et là, on pouvait boire du café ou des boissons sans alcool. Le vin était distribué avec les autres denrées rationnées pour être consommé à la maison. Les jeux d’argent furent interdits. ↩
-
Esenwein ajoute qu’on trouve des exemples de cette tendance [puritaine dans] El Productor (Barcelone, 1887-1893) ; El Socialismo (cadix, 1886-1891) ; et La Solidaridad (Séville, 1888-1889). Par la suite, le puritanisme fut défendu par des journaux anarchistes aussi prestigieux et importants que La Revista Blanca (Madrid, 1898-1905 et 1923-1936). On trouvera un portrait coloré de cette figure du révolutionnaire plein d’abnégation dans Vicente Blasco lbafiez, La Bodega, où le personnage de Fermin Salvatierra est inspiré de l’anarchiste légendaire Fennln Salvochea. ↩
-
George Esenwein relève que la différence de salaire entre les hommes et les femmes signalée par Souchy souligne l’une des divergences importantes entre la théorie et la pratique anarchistes qui sont apparues au cours de l’expérience collectiviste. Depuis des années, les anarchistes affirmaient que les hommes et les femmes étaient égaux à tout point de vue. Ils réaffirmèrent cette position au congrès de Saragosse de 1936, à la veille de la guerre civile, où ils assurèrent que les différences de statut économique entre les hommes et les femmes qui existaient sous le régime capitaliste disparaîtraient à l’avènement de la révolution, qui établirait l’égalité de droits et de devoirs entre les sexes. Mais des travaux récents ont démontré que, même s’il y eut de grandes avancées dans cette direction dans certaines collectivités anarchistes, dans l’ensemble, le bilan de ces expériences du point de vue des droits des femmes n’est pas à la hauteur des principes libertaires. ↩
-
Ce chiffre fut avancé par le leader anarcho-syndicaliste Abad de Santillân et il m’a été confirmé par José Duque et José Almudì, les deux communistes qui faisaient partie du Conseil de défense d’Aragon, principal organe administratif de la région au cours des premiers mois de la révolution. Le socialiste Prats affirme de son côté dans son livre que 70% des terres furent collectivisées. ↩
-
Il faut signaler que les anarchistes ne désignaient pas les personnages les plus influents de leur mouvement par le terme de « dirigeant » qui implique des notions d’autorité et de contrôle ; ils parlaient de « représentant », de « délégué » ou de « militant ». Cependant, dans la mesure où ces hommes possédaient les qualités nécessaires pour’ diriger et orienter les membres de la CNT et de la FAI et où, bien sur, ils s’étaient révélés des dirigeants par tous les aspects qui distinguent la direction d’un mouvement politique, quel qu’il soit, de sa base, je préfère employer ce terme. ↩
-
Ainsi, dans le village de Gelsa, dès que le régime révolutionnaire fut institué, on fit la proclamation suivante : Ceux qui ne remettent pas au dépôt communal toutes les denrées alimentaires et tous les vêtements qu’ils possèdent mais les conservent pour en tirer profit encourent la peine maximale. ↩
-
La collectivité de Prat de Uobregat nous fournit un exemple intéressant. D’après un compte rendu publié le 2 juillet 1938 dans l’organe de la FAI, Tierra y Libertad, cette collectivité fut fondée en octobre 1936 par un millier d’ouvriers agricoles, de métayers et de paysans propriétaires qui décidèrent « presque à l’unanimité » de cultiver la terre en commun. Mais à peine la situation politique eut-elle changé au désavantage de la CNT et de la FAI que les métayers et les propriétaires exploitants réclamèrent la restitution de leurs terres, ce qui réduisit d’un quart, toujours selon cet article, la surface des terres collectives. ↩
-
En vente ici : https://agone.org/memoiressociales/laguerredespagne/ ↩