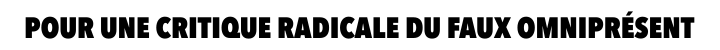A bas le prolétariat, Vive le communisme !
Les révolutionnaires ne proposent pas l’amélioration de la condition prolétarienne mais sa suppression. Prolétaires, encore un effort pour cesser de l’être...
A BAS LE PROLÉTARIAT.
La servitude acceptée
Le plus grand obstacle à l’émancipation du prolétaire est en lui-même. Le vrai désastre pour l’ouvrier, c’est sa complaisance à l’égard de sa misère, sa façon de s’accommoder et se consoler de son impuissance. Et pourtant l’expérience lui a appris qu’il n’a pas de recours auprès du système qui l’opprime et qu’il ne saurait s’en sortir sans lutter. Mais il préfère se défouler dans le vide et habiller de fausse colère sa passivité.
Le fatalisme et la résignation règnent dans les rangs ouvriers. C’est clair, il y aura toujours des patrons, d’ailleurs il y en a toujours eu ; il n’y a pas grand chose à espérer quand on est né du mauvais côté de la barrière. Certes, il arrive que le prolétaire se fâche et n’accepte plus une situation qu’il juge insupportable. Mais est-ce pour mettre au point un plan d’action ? Non ! à défaut de pouvoir atteindre ceux qui prospèrent sur son dos, il décharge son ressentiment sur ceux qu’il rencontre au coin de la rue : petits chefs, bicots et autres métèques. Il a le sentiment de les entretenir. Pour les mêmes raisons il en veut à sa femme et à ses enfants, s’ils ne lui donnent pas les satisfactions qu’il en escompte et ne compensent pas, par un ménage impeccablement tenu ou les résultats scolaires appropriés, son sentiment d’infériorité sociale. L’employé se démarquera fièrement de l’ouvrier parce que celui-ci se salit les mains et en retour sera méprisé comme gratte-papier parasite. Celui qui est syndiqué se sentira supérieur a celui qui ne l’est pas encore mais qu’il convient de rendre conscient. A son tour, il fournira un sujet de plaisanterie, à vrai dire facile.
Même quand il n’est pas aigri, incapable de reconnaître ce qu’il y a de bon dans la vie et sa propre part de chance le prolétaire reste prisonnier de son mode de vie borné. Il accepte sa servitude jusqu au point de reconnaître, à un certain âge, que les choses s’améliorent progressivement, que la jeunesse mécontente devrait savoir reconnaître les « acquis ».
Il y a un sentiment très communément partagé par les prolétaires de tous les pays. Ce n’est pas l’internationalisme, mais le sentiment que ça pourrait être pire ailleurs… Mieux vaut s’accrocher à sa place, car à côté, et pour le même boulot… Le travailleur a la consolation d’avoir trouvé, au milieu du malheur général, la planque.
Le travail reste la meilleure des polices. Il tient chacun en bride et entrave puissamment le développement de la raison, des désirs, du goût de l’indépendance car il consume une extraordinaire quantité de force nerveuse et la soustrait à la réflexion, à la rêverie, à l’amour ; il présente constamment à la vue un but mesquin et assure des satisfactions médiocres mais régulières. Ainsi une société où l’on travaille dur en permanence aura davantage de sécurité : et l’on adore aujourd’hui la sécurité comme la divinité suprême.
Il existe encore des imbéciles pour honorer la répugnante activité et ne point la fuir spontanément. Celui-là qui se démolit jour après jour la santé sera fier de ses biceps et se réjouira de ne plus avoir besoin de faire du sport pour être en forme. Dans certains ateliers il règne une véritable mentalité olympique. Le salaire aux pièces et les bonus ne sont même pas nécessaires pour que chacun y aille de son petit record. Mépris ouvert ou paternalisme pour celui qui n’est pas capable ou qui s’en fout. Il est cependant de plus en plus difficile de croire à l’utilité réelle de ce que l’on fait, et l’indifférence, le dégoût même à l’égard du travail gagnent du terrain.
Pourtant celui qui cesse de travailler a souvent mauvaise conscience. Malades ou chômeurs, beaucoup ont peur de ne pas être à la hauteur, honte de se laisser aller. Celui qui se mesure au travail croit se prouver qu’il n’est pas une loque et qu’il a une utilité sociale. On touche là le caractère fondamental de la misère prolétarienne : sans le travail la vie n’a plus de consistance, plus de sens, plus de réalité.
Ce n’est pas l’intérêt de la tâche qui ramène au turbin, mais l’ennui autant que le besoin du salaire. La routine de la vie quotidienne peut faire croire que l’accès à l’après-travail ou même le chômage sont une libération. Il faut devenir chômeur ou retraité pour constater le contraire. La retraite ou le chômage, c’est le travail au degré zéro.
La misère moderne ne s’exprime pas par le manque de loisirs ou la pénurie de biens de consommation, mais par la séparation de toutes les activités, le morcellement du temps, l’isolement des hommes. D’un côté, une activité productive souvent forcenée, émiettée où les nécessités de la production de capital font de l’homme la carcasse du temps, un instrument parmi les instruments. De l’autre, le temps libre où il est censé s’appartenir mais où, domestiqué par l’éducation et abruti par le travail, il est coupé de tout par la nécessité de payer.
La consommation et surtout les rêves qu’elle permet restent la consolation ultime. L’ouvrière, la vendeuse ou la secrétaire, outre le temps consacré au lèche-vitrines et à la lecture de romans-photos, met sa vitalité à rehausser son rang social par de visibles efforts de toilette. La « féminité » peut s’en donner à coeur joie grâce aux miracles de toutes les marchandises accessibles. Désir d’être prise en considération et adhésion soumise aux représentations serviles de la femme s’entremêlent pour mieux la leurrer sur la réalité de son sort. Le « ménage » ouvrier chérit l’idée de ce petit pavillon de banlieue qui lui appartiendra un jour et où « l’on sera enfin chez soi ». Mais avant tout il y a l’automobile. On rêve de l’acheter, d’en changer. Elle est la mesure de la richesse et du savoir-vivre, elle fournit un inépuisable sujet de conversation. Même si l’ouvrier préfère parler des déboires qu’il a avec son épouse au patron de bistrot et lui montrer les photos de ses gosses, c’est le garagiste qui reste son véritable confident.
Souvent l’ouvrier se montre méfiant à l’égard de la politique, mais il ne s’élève que fort rarement à la critique de la politique et des politiciens. Gonflé par l’importance momentanée que cela lui confère et excité par le côté sportif de l’affaire, il ne se refuse pas à aller déposer à la queue leu leu son bulletin de vote. Il suffit que le vent de l’« Union », recommence à souffler pour que toutes ses illusions apparemment éteintes se ravivent. Peu importe que la gauche ait régulièrement trahi les espoirs que les masses mettaient en elle, que les sociaux-démocrates aient envoyé au casse-pipes en 14, participé aux pires combines bourgeoises, appuyé la répression coloniale. Quant aux prétendus communistes, dès qu’ils touchent au pouvoir, ils font plus que délaisser la défense des intérêts ouvriers : ils appellent à retrousser les manches et n’hésitent pas à réprimer physiquement le prolétariat comme à Cronstadt, Barcelone ou Budapest. Mais que sait l’ouvrier de l’histoire des luttes prolétariennes ? De la Commune de Paris, de la révolution russe, des grèves sous le Front populaire, il ne connaît que des images d’Épinal que les appareils politiques et les instituteurs de gauche ont concoctées à son usage.
S’il est adhérent d’un parti stalinien, le « travailleur » dénoncera les profits abusifs des monopoles et les spéculations honteuses des promoteurs immobiliers. Mais il se met en tête de ne pas saisir ce que sont réellement le profit et la fonction du patron. Il n’y verra que vols, parasitisme, abus des « deux cents familles », et non point d’abord des fonctions économiques que l’on a à liquider en sapant leur base : capital et salariat. Dès qu’il sera question d’un pays modèle et socialiste la Suède ou Cuba, ça dépend des goûts, ces profits, ces fastes, ces bureaux somptueux, ces datchas au service du peuple lui sembleront de suite plus honnêtes. Que n’importe quel gras bureaucrate soit un « dirigeant ouvrier » et son train de vie deviendra une question de dignité ouvrière. Dans les pays où le prolétariat exerce sa dictature, quelle ne doit pas être la satisfaction de l’ouvrier, le matin à l’usine quand il pointe et lève sa casquette devant le contremaître, de savoir qu’en fait il est propriétaire de son entreprise, et en dernière instance le supérieur de ses supérieurs ?…
L’ennemi du prolétariat ce n’est pas tant le pouvoir des capitalistes ou des bureaucrates que la dictature des lois de l’économie sur les besoins, l’activité et la vie des hommes. La contre-révolution moderne est centrée sur la défense de la condition prolétarienne et non sur le maintien des privilèges bourgeois. C’est au nom du prolétariat et des nécessités économiques, avec l’aide de ses représentants politiques et syndicaux, que l’on tente de sauver la société capitaliste.
L’aménagement de la servitude
Protester et revendiquer font aussi partie du rôle de l’ouvrier et de son impuissance. Impuissance, découplage de la réalité et absence de perspective auxquels le conditionne d’abord son travail. Passif et isolé, il accepte de s’en remettre aux appareils bureaucratiques croyant y trouver la cohésion qui lui manque.
Le travailleur, quand il revendique au sein de ses « organisations responsables » entérine ce qui est à la base de sa misère. Que réclame-t-il ? du pain ? de l’espace ? des machines ? les moyens nécessaires pour jouir de sa vie, rencontrer des amis, agir et produire pour eux et avec eux ? Non. Ce qu’il réclame avec obstination, c’est la garantie de pouvoir travailler, se faire exploiter dans les bagnes du salariat, et en contrepartie l’avancement de l’âge de la retraite, pour que les jeunes puissent profiter de leur droit au travail et les vieux préparer leur enterrement. Que l’ouvrier en arrive contraint et forcé par l’environnement économique à aller se vendre pour obtenir de quoi subsister, soit ; qu’une fois au travail il fasse tout son possible pour ne point s’y abîmer la santé, pour poursuivre des activités qui lui soient plus profitables et pour réduire le temps pendant lequel il est exploité, évidemment. Ces attitudes, qui doivent de fait tenir compte de l’environnement capitaliste, n’ont rien à voir avec l’exigence du droit au travail et du droit à la retraite.
Les réformes ne sont pas des conquêtes du prolétariat, mais les aménagements que le système est obligé d’opérer pour assurer sa survie et sa progression. Il ne fait généralement — parfois sous la pression des masses — que liquider ses archaïsmes. Le réformisme ouvrier n’arrive qu’à couvrir les nécessités du développement du capital, en particulier celle de traiter relativement bien la force de travail pour pouvoir l’exploiter avec plus d’intensité.
La crise et les troubles qu’elle entraîne, voilà un moment d’espoir pour les arrivistes et les bureaucrates. Ils tentent alors de se glisser vers les bonnes places devenues libres, par l’action du prolétariat. Cela s’est vu notamment pendant la révolution russe où le parti bolchévique a fait reculer, parfois militairement, les forces vives de la révolution pour restaurer l’ordre capitaliste et la discipline dans les usines : mais aussi lors des révolutions allemande (1918/1923), espagnole (1936/1937)…
Ceux qui fondent leur pouvoir de négociateurs de la force de travail sur l’impuissance et l’atomisation des prolétaires, sont les défenseurs de la société d’exploitation. Ils ont pour programme la gestion de la condition prolétarienne. Ils peuvent bien crier « Vive le prolétariat », puisque, précisément, du prolétariat ils en vivent ! Et s’ils s’affichent sans vergogne, ces héritiers de l’échec des insurrections prolétariennes, c’est qu’ils ont prospéré sur leur fossoyement.
Une grande illusion, l’autogestion
Le capital a mercantilisé tous les rapports sociaux. Mais ce mouvement même a rendu fragiles les mécanismes de régulation du système et tous les équilibres instables de l’accumulation sur lesquels il repose, qu’ils soient monétaires, sociaux, démographiques ou écologiques. La crise de 29 était venue après l’écrasement du prolétariat (échec de période révolutionnaire des années 20), par contre, celle que nous vivons survient à une époque où, le prolétariat redécouvrant sa force, un affrontement décisif se prépare.
L’univers capitaliste repose sur le prolétariat comme aucune autre société de classes ne s’était fondée sur ses esclaves. La classe fondamentale du capitalisme, c’est le prolétariat et non la bourgeoisie. Tant qu’il y a prolétariat, il y a capitalisme et c’est d’ailleurs le caractère révolutionnaire du capitalisme d’étendre le prolétariat, la classe qui exprime la dissolution de toutes les classes, la classe qui ne peut plus reconquérir son humanité et s’approprier son monde qu’en bouleversant sa condition et en détruisant le capital.
Le prolétariat est d’autant plus poussé à l’action qu’avec la crise le mouvement ouvrier devient incapable d’aménager le travail salarié. Par rapport à leurs ancêtres et aux misérables du tiers-monde, les exploités des pays développés sont relativement gâtés. Pourtant la transformation révolutionnaire à venir reposera sur eux, parce que l’écart entre ce qui est et ce qui serait possible est plus grand que jamais. Cet écart, qu’ils en soient plus ou moins conscients, est de toute façon une contradiction qui les incite et les incitera d’autant plus à agir pour dénouer la situation.
A défaut de pouvoir opposer aux dépossédés une idéologie bourgeoise, propriétaire, morale ou religieuse, on leur oppose une idéologie prolétarienne : le socialisme, l’autogestion. La généralisation du salariat a détruit les vieilles valeurs de la propriété et oblige le capital à mettre en avant l’accès aux responsabilités, l’enrichissement des tâches, la démocratisation du pouvoir dans l’entreprise, la participation. Davantage lorsque les difficultés économiques rendent plus douloureuses les compensations en espèces sonnantes et trébuchantes.
Le problème de la gestion ne devient central que dans un univers morcelé et atomisé, où les hommes restent impuissants devant la nécessité économique. Les autogestionnaires et autres apôtres du contrôle ouvrier veulent attacher les travailleurs à « leur » entreprise. Cela se présente concrètement comme l’action de comités dans chaque entreprise, épluchant les comptes, contrôlant le patron ou la direction, surveillant à la fois la production et les activités commerciales. On suppose donc une sorte d’économie éternelle dont les lois seraient à peu près identiques sous le capitalisme et sous le communisme : les travailleurs auraient donc à apprendre les règles de l’administration et du commerce. La logique de la marchandise s’impose et détermine tout : ce qui sera fabriqué, comment, etc… Mais le problème pour le prolétariat n’est pas de revendiquer la « conception » de ce dont il n’assurerait aujourd’hui que la « fabrication ».
Dans le meilleur des cas sa solution serait synonyme d’autogestion du capital. L’exemple de Lip est frappant : les tâches auparavant assurées par le patron deviennent les tâches des ouvriers. En plus du processus matériel ils se chargent de la commercialisation. Mais tous les problèmes que peut poser la « gestion » sont complètement différents dans une, société non marchande. C’est pour cela que le contrôle ouvrier est une absurdité : il ne peut apprendre aux travailleurs que la gestion capitaliste, quelles que soient les intentions de ceux qui l’exercent.
Vantée par les idéologues nouvelle vague, l’autogestion se pare de l’attrait de l’utopie. Mais quel triste rêve que celui où la confusion d’un capitalisme sans capitaliste s’ajouterait au ridicule de travailleurs s’enthousiasmant demain pour ce qui les indiffère aujourd’hui : le maintien du salariat… Face à de futurs débordements, la gauche démocratique voit dans l’autogestion un discours lui permettant de se renforcer, d’être plus achevée, de résorber un mouvement qui s’annonce menaçant.
VIVE LE COMMUNISME
Le communisme balbutié
Ce que la presse et la télévision présentent comme « lutte de classe », combat des travailleurs, n’est bien souvent qu’un spectacle politico-syndical préfabriqué. La force réelle de la classe ouvrière et la peur qu’elle peut inspirer s’expriment de façon plus efficace et plus souterraine. Les attitudes d’indocilité, de refus du travail jouent plus, même sur le niveau des salaires que les défilés rituels du 1er mai. Il existe une complicité entre les différents pouvoirs qui se partagent la société pour dissimuler la guerre sociale qui les menace tous.
De par leur situation, de par les énormes masses de capitaux qu’ils sont chargés d’animer, de par le niveau d’intégration de tous les actes productifs et économiques, les ouvriers disposent de formidables moyens d’action et de pression. Incomparables à ceux dont disposaient les opprimés à d’autres époques, et pourtant la conscience de cette force leur est le plus souvent absente. il ne s’agit pas d’un pouvoir abstrait que posséderait la classe ouvrière dans son ensemble, mais bien de moyens que détiennent concrètement même des groupes restreinte en vertu de leur situation de classe. Par la grève, le sabotage, des désobéissances de toutes sortes, les travailleurs peuvent menacer la mise en valeur du capital. Ils sont à même de bloquer la production de tel bien ou tel service indispensable, de cesser de faire tourner de grands ensembles, de détourner la production pour leur propre compte.
Cette puissance peut être utilisée à un niveau supérieur pour éviter des désagréments à d’autres. Une grève des transports fait perdre des journées de travail. Tant pis pour les acharnés du boulot. Il existe d’autres moyens de pression pour faire que ces journées soient tout de même payées. Certaines grèves des transports se sont déjà traduites par un simple arrêt du contrôle des paiements. Que dirait-on de la distribution gratuite de certains produits, de postiers qui n’oblitéreraient plus les lettres, de caissières qui arrêteraient le travail et permettraient aux clients de partir sans payer, d’employés qui détruiraient des papiers importants ? Des possibilités d’action extraordinaires existent pratiquement partout. Ce qui manque, c’est l’audace, l’accord, le goût réel de l’efficacité et du jeu.
Il est déjà significatif que régulièrement les émeutes de notre temps, qu’elles aient lieu aux États-Unis, en Pologne, à Londres ou au Caire, débouchent sur l’assaut des magasins. Une panne d’électricité en juillet 77 à New York et des pères de famille respectables participent au pillage en compagnie des « voyous ».
Défendre en toutes circonstances l’outil de travail cher aux syndicalistes, prévenir avant de faire grève, faire des grèves d’avertissement, protéger la propriété patronale ou étatique, c’est céder au fétichisme du capital et rester son prisonnier, ne point utiliser ce qu’il a lui-même concentré entre les mains des prolétaires. Les ouvriers pour qui l’outil de travail n’est plus une chose sacrée qu’il ne faut surtout pas détourner de sa fonction première, ceux qui n’acceptent plus de sacrifier leur vie devant des fétiches, sauront le moment venu utiliser au mieux les instruments que leur aura légués le capital. Ils sauront remettre en marche tout ce qui sera nécessaire pour assurer les tâches révolutionnaires : se vêtir, se nourrir, s’associer, s’armer…vivre.
Dans la perruque, lorsque les ouvriers utilisent les machines pour leur compte, se dessinent une activité et une communauté qui échappent au salariat. L’ordre « Il faut faire ça est » remplacé par une question « Qu’est-ce qu’il est possible de faire ? ». Ce travail, s’il est un but en soi, n’est pas pour autant dépourvu de but. Les possibilités ne sont pas illimitées, mais l’ouvrier qui s’adonne à la perruque fait marcher sa tête, s’informe. Il passe en revue le matériel qu’il a autour de lui, examine les possibilités non utilisées autres que celles offertes par sa machine : celles des petites machines auxiliaires, de la machine à cisailler les plaques dans le coin de l’atelier, de la meule, des outils qui sont à sa disposition ; et il décide. Ce travail en perruque, humble, exécuté en cachette, est le germe d’un travail libre et créatif : tel est le secret de cette passion.
Lorsque les travailleurs agissent contre le capital, leur action n’est pas simplement un moyen mais aussi l’esquisse d’autre chose, d’un monde où l’activité humaine ne sera plus enchaînée mais libérée, non plus soumise à la production de richesses, mais enrichie et expression de la richesse même. Dans la lutte, l’ouvrier redevient maître de lui-même et reprend le contrôle de ses propres gestes. Le caractère sacré de l’outil de travail, le sérieux oppressant de la réalité de l’usine s’effondrent. Avec le sabotage, mais plus généralement avec tout ce qui s’en prend directement à l’organisation du travail, la joie réapparaît.
Dans l’initiative qui ressurgit, les liens qui se nouent, les racismes de toute nature qui s’effacent, la gratuité des gestes et des sentiments, c’est la communauté qui renaît. Les prolétaires en révolte, produisent un usage infiniment plus riche de leur vie, du temps et de l’espace dont ils deviennent fugitivement les maîtres. L’affirmation de leur vie humaine et non plus vie du capital est immédiatement communiste.
L’aspiration au communisme
Le besoin de la communauté humaine, voilà le cœur du communisme. Les descriptions des Utopistes manifestaient déjà le besoin historique du communisme et en faisaient une exigence immédiate, conformément à sa nature profonde. Mais le communisme n’a pas été inventé par des penseurs. C’est la vieille aspiration à l’abondance et à la communauté qui était présente dans les révoltes d’esclaves de l’antiquité comme dans celles des paysans du moyen-âge.
Le capitalisme tente de faire disparaître toute trace de communisme. Mais l’activité la plus intégrée et la plus servile se nourrit de participation, de création, de communication, d’initiative, même si ces facultés ne peuvent s’épanouir. Le besoin du salaire ne suffit pas à faire fonctionner l’ouvrier. Il faut qu’il y mette du sien.
Le communisme n’est pas une forme d’organisation sociale figée. On ne le construit pas comme le prétendent ceux qui tirent des plans sur la comète. Il surgit sans cesse au sein de l’activité humaine même s’il ne peut se développer qu’à certains moments. Plus l’activité se dresse contre le capital, plus elle tend à dessiner le communisme. Lorsque les hommes recommencent à avoir des expériences à se communiquer, des choses à se dire et à faire, la conscience cesse d’être le reflet passif de représentations et de situations gelées. Plus la lutte s’approfondit, plus ceux qui y participent se trouvent nettoyés des préjugés et mesquineries qui les habitaient. Leur conscience se dénoue et c’est un regard neuf et étonné qu’ils jettent sur la réalité et l’existence qu’ils mènent.
Les prolétaires ne peuvent se réapproprier par morceaux les moyens de production et une activité totalement émiettée, il leur faut s’associer et mettre en commun. Mais, par delà le mouvement de réappropriation et de mise en commun, une nouvelle activité se développe, de nouveaux rapports naissent, des passions enterrées se réveillent, la relation de domination des objets sur les hommes est renversée.
Le système capitaliste est fondé sur l’opposition production/consommation. L’existence du prolétaire n’est-elle pas double ? Pressuré, chronométré, ahanant quand il gratte ; et sollicité, flatté, joué quand il consomme. Avec le communisme, ce n’est pas tant la réduction maximum du temps de travail qui importe, mais le dévoilement du caractère bidon de l’opposition travail/loisirs. Des sociétés primitives employaient le même mot pour désigner le travail et le jeu. Dès maintenant, on peut concevoir la chasse, la cueillette, le jardinage comme autre chose que du travail tout en étant des activités productives. Il en va de même pour les activités liées à l’industrie, mais le métal froid du machinisme pèse sur notre imagination d’autant que ces tâches ne peuvent devenir elles-mêmes des sources de plaisir qu’avec l’émancipation de l’ensemble de l’humanité.
Par d’incessantes innovations technologiques, par la rationalisation de l’usage de la force de travail, le capitalisme a multiplié l’efficacité productive. La réduction du temps de travail : la standardisation des pièces, l’interchangeabilité des tâches… c’est ce qui fait courir l’humanité. Certains commentent en disant que le progrès entraîne une qualification meilleure. Et de citer à l’appui l’augmentation du nombre des ingénieurs tout au long du XXe siècle. Mais ils oublient de préciser qu’aux USA celui des portiers s’est accru d’autant dans le même temps… La course à la productivité a en fait approfondi la dégradation, la dévalorisation du travail.
Les réalisations scientifiques et techniques montrent que la pénurie naît de l’abondance même. Alors que l’encombrement automobile se dresse contre l’automobile, la consommation pharmaceutique contre la santé, la destruction de la nature contre son humanisation, la faille porte sur l’usage de la marchandise en tant que telle. Pourquoi se déplacer quand, dans le système des objets, il n’y a plus personne à rencontrer ? La consommation, malgré toutes les fausses promesses de la publicité ne peut plus se révéler un remède contre la misère. La colonisation par la marchandise et le fric de toute la vie sociale a sapé les valeurs traditionnelles et le respect des institutions. La misère la plus intime se révèle elle-même façonnée par le capital. Mais cette destruction est aussi une libération et une multiplication des désirs.
Le communisme n’est possible que grâce au déblayage effectué par le capitalisme. Il est non pas la défense des prolétaires, mais l’abolition de la condition prolétarienne. Il ne porte pas les ouvriers au pouvoir et ne nivelle pas l’ensemble de la population au même revenu. Il en finit avec l’esclavage salarié, le productivisme, l’opposition travail/loisirs. Il permet la réunification de l’activité humaine sur la base de tous les acquis techniques et humains. L’ouvrier n’est plus enchaîné à l’usine, le cadre n’est plus rivé à son attaché-case. Le besoin d’agir n’est plus soumis au besoin d’argent.
Abolition du travail et de l’échange
La communauté humaine et la fin de l’entreprise comme unité de la vie productive provoquent la fin de l’échange. Supprimer l’argent qui sert à l’échange, ce n’est pas revenir à cette forme primitive de l’échange qu’est le troc. Les objets ne circulent pas dans un sens avec pour compensation une circulation d’autres objets dans Ie sens inverse. Ils sont répartis directement en fonction des besoins, conçus et produits pour développer les possibilités d’activités les plus productives de sens social.
Évidemment pour les banquiers et certains idéologues on ne pourra jamais se passer d’argent : il est au corps social ce que le sang est au corps humain. Pourtant il ne faut pas remonter loin pour trouver une époque où l’immense majorité d’une humanité paysanne produisait essentiellement pour satisfaire ses besoins familiaux et ne pratiquait presque pas l’échange monétaire.
Aujourd’hui la contrainte de vendre sa force de travail ne résulte pas d’une force directe et personnelle, mais économique et anonyme. A travers le besoin d’argent, il semble que ce soit la dictature de ses propres besoins qui impose au travailleur de se rendre au chagrin, que ce soit là un fait naturel.
La séparation entre les hommes est si profonde que l’argent, ce lien social abstrait, apparaît comme la seule denrée qui soit véritablement communautaire, passant indifférente et inodore de main en main. L’humanité ne peut se passer du fric, cette relation abstraite, impersonnelle, qu’en s’unissant concrètement dans l’association communiste. Actuellement, l’on ne mesure mon apport personnel qu’en fonction d’une rétribution personnelle : avec l’association, la notion même de contrepartie disparaît, puisque ma satisfaction c’est d’enrichir le développement de la communauté.
Le communisme, ce n’est pas simplement la généralisation de la gratuité, le monde tel qu’il est moins l’argent, un gigantesque libre-service. Il ne supprime ni les choix douloureux, ni les efforts. Son instauration ne se fera pas sans difficulté : et la croire facile est aussi chimérique que la prétendre impossible. La persistance à travers les âges de la lutte des classes et des soulèvements prolétariens montre sa nécessité. Et ce n’est pas tant la force des maîtres que l’immensité de la tâche qui les a fait échouer. Il y a un saut énorme à accomplir et seul ce saut assure la victoire de la classe prolétarienne, en même temps qu’il signifie sa négation.
Fournir gratuitement les biens nécessaires à la satisfaction des besoins essentiels, voilà ce que permettent les techniques qui soutiennent l’invasion de tous les aspects de la vie par la marchandise. Mettre à la disposition de chacun la nourriture, l’habillement, le logement, des moyens de transport et toute une série de produits élaborés est immédiatement possible pour les pays industrialisés mais pourrait être étendu assez rapidement au reste de la planète. De plus, si la fin de la marchandise suppose une gigantesque transformation du contenu de la production et de l’usage des biens, elle entraîne la fin de la séparation luxe/nécessité.
Si l’emploi de l’automation est actuellement limité à quelques industries (acier, pétrochimie, etc …), la communisation entraînera une utilisation plus étendue des automatismes qui sont, sinon assez simples dans leurs principes, du moins aisément applicables à de nombreuses activités. Le machinisme moderne (cf. la commande électronique) , ne permet pas simplement d’augmenter la productivité, de limiter les interventions humaines, mais aussi de généraliser l’accès aux machines-outils. Fabriquer massivement, de la façon la plus automatisée possible, des biens utilitaires et standardisés, n’empêche pas la mise en circulation des matériaux, outils et machines servant à les transformer. Il faut en finir avec le règne du prédigéré, pour que chacun puisse s’activer selon ses goûts, le besoin de la quantité ne s’opposant plus à l’exigence de la qualité.
Ainsi la spécialisation à outrance cède la place à la polyvalence. On est à la fois ouvrier, paysan, artiste et scientifique ; en fait au-delà de toutes ces catégories étroites et primitives. La production n’exclut plus l’expérimentation, les contacts et les « pertes de temps », et l’apprentissage sort des ghettos scolaires et universitaires pour se fondre dans le mouvement même de l’activité productive.
Vers l’insurrection
La communisation passe par la résurgence des conseils révolutionnaires que les insurrections prolétariennes de ce siècle ont fait apparaître à l’état embryonnaire. Si des conseils se développent dans les quartiers, les unités de production, ce mode d’association émanant directement des masses vagissantes, réglera l’organisation pratique et le contrôle des tâches nécessaires, et de ce fait devra court-circuiter les organes de représentation politique.
Les conseils du passé, malgré leurs défauts et leur timidité ont montré la capacité des travailleurs à s’occuper de leurs affaires. Les meilleures manifestations des conseils ont eu lieu lorsqu’ils ont dû répondre rapidement, clairement et durement à leurs ennemis. Ils se sont directement forgés comme l’organisation de la lutte. Mais souvent ils se sont enlisés dans l’administration et dans l’attente. On a vu alors se construire de magnifiques organisations, mais dans le vide, en dehors des impératifs de lutte et des tâches à réaliser. Ces organes ne sont ni la recette miracle, ni le but de la révolution. Le communisme n’est pas le remplacement du pouvoir de la bourgeoisie par le pouvoir des conseils, de la gestion capitaliste par la gestion ouvrière. Le risque pour ceux-ci est de devenir un prétexte pour continuer à enchaîner les travailleurs à l’entreprise, au lieu d’être le levier qui fait sauter les cloisonnements de la vie sociale, le moyen de s’associer et de communiser.
Prendre des décisions entraîne des divergences. Le communisme ne signifie pas la fin de toute opposition, au contraire il les féconde en changeant leur contenu. Les conflits ne viennent plus d’intérêts personnels à préserver, mais des solutions que chacun propose pour satisfaire l’intérêt commun. Ce sont ces divergences mêmes qui permettront de comparer les possibilités d’activités impulsées par les conseils, sans pour autant retomber dans des débats de style parlementaire.
Le but de la révolution communiste n’est pas de fonder un système d’autorité démocratique ou dictatorial, mais une activité différente. Le problème du pouvoir apparaît quand les hommes perdent le pouvoir de se transformer eux-mêmes et leur environnement, lorsqu’ils sont contraints d’agir dans un autre but que le contenu de leur activité.
La révolution communiste ne recherche pas le pouvoir, mais elle a besoin de pouvoir réaliser ses mesures. Elle résout cette question parce qu’elle s’attaque à sa cause : elle est appropriation de toutes les conditions matérielles de la vie. C’est en rompant les liens de dépendance et d’isolement que la révolution détruira l’État et la politique. Cette destruction n’est pas automatique. Il ne disparaîtra pas peu à peu, au fur et à mesure que grandirait la sphère des activités non marchandes et non salariales. Ou plutôt cette sphère serait très fragile si elle laissait subsister à côté d’elle l’État, comme les gauchistes et écologistes voudraient le faire. Une des tâches des révolutionnaires est de mettre en avant des mesures qui tendront à saper la force de l’État et à créer une situation irréversible. Par exemple détruire tous les fichiers d’État-civil et autres mises en cartes de la population par les diverses administrations attaquerait à la fois des fonctions économiques et répressives. Les procédés de centralisation par ordinateur et micro-film rendent la machine étatique finalement plus vulnérable.
Le communisme est l’enjeu et l’arme de l’insurrection. De la capacité du prolétariat à révolutionner l’économie et sa condition dépend sa victoire. Dans la guerre sociale le rapport des forces militaires à l’origine n’est pas décisif. La révolution doit priver l’armée d’un enjeu à défendre et miner sa base matérielle. Ainsi briser le casernement des soldats par des manifestations de fraternisation peut se révéler parfois bien plus efficace que des attaques désordonnées. Disposant d’une puissance destructive pire que jamais, l’armée voit pourtant ses valeurs traditionnelles se décomposer car elles deviennent étrangères au monde moderne. Par la nature de ses armes et de son appareil technique, elle est dépendante de sa base économique comme elle ne l’a jamais été. Si les producteurs de façon cohérente et déterminée utilisent leur force, alors ils auront de quoi affamer, décourager, diviser, paralyser, rallier, écraser leurs adversaires. S’ils ne tirent pas avantage de leur position, du désarroi initial de l’ennemi, pour attaquer le capital là où il est vulnérable, alors ce sont eux qui deviendront une cible facile pour la contre-révolution idéologique et politique d’abord, et militaire ensuite.
La violence révolutionnaire est un rapport social qui bouleverse les êtres, qui fait des hommes les sujets de leur propre histoire. Mais les insurgés glisseraient sur le terrain de l’ennemi s’ils se livraient à un affrontement camp contre camp, s’ils cherchaient à stabiliser un rapport de forces, à préserver des « acquis ». L’insurrection dégénérerait alors en guerre civile, glissement fatal qui ne ferait que reproduire la cause de l’échec du passé révolutionnaire (communards-versaillais, anarchistes-franquistes…). Face à un adversaire englué dans une conception militariste de l’affrontement les insurgés ont aussi pour atouts la souplesse et la mobilité. Ne craignant pas de mettre en jeu les passions, l’imagination, l’audace, l’insurrection doit sans cesse se fonder sur sa propre dynamique : la communisation.
Beaucoup savent confusément que nous vivons la fin d’un monde, même s’ils ne savent pas encore ce qui va advenir : le mouvement n’a pas encore eu la force de rendre visible son contenu et d’affirmer ses perspectives. Ceux qui supportent de moins en moins la barbarie capitaliste doivent découvrir ce à quoi ils aspirent : le monde dont leur révolte est porteur, le communisme.
Prolétaires, encore un effort pour cesser de l’être…