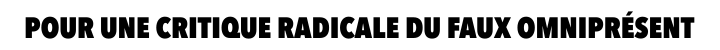La dictature anti-étatique du prolétariat
La dictature du prolétariat - fin de l'économie et de la politique

Les longues décennies de misère théorique et politique traversées par le mouvement ouvrier n’ont pas seulement égaré son action ; elles ont aussi perverti la compréhension de ses tâches et de ses objectifs historiques. De ce fait, les concepts et les notions sur lesquels se fondaient ses analyses et ses perspectives se sont trouvés corrompus. Ainsi en est-il de la « dictature du prolétariat ». Dans un article de ce même numéro de Spartacus, Louis Rigal montre la déformation que le contenu de cette expression de Marx a subie, la faisant chuter de notion sociale en notion politique, et ouvrant la voie à l’identification du prolétariat au parti, forme politique d’exercice du pouvoir d’État. Je ne reviendrai pas sur cette question. Cependant il ne suffit pas de « dire par une étude textuelle que la pensée originelle de Marx a été trahie ; encore faut-il démontrer que cette trahison conduit, pratiquement, à une forme inadéquate. C’est ce que j’essaierai de mettre en évidence en esquissant la démarche suivant laquelle la production et la distribution des biens, c’est-à-dire ce qu’il est convenu d’appeler l’économie, seront organisées par la classe ouvrière dans le procès de transformation révolutionnaire de la société.
I. La fin du capitalisme
Comme mode historique de production le capitalisme ne se définit pas par la propriété privée des moyens de production, par la recherche du profit ou le règne des deux cents famines. Il se caractérise par le salariat comme mode déterminant d’exploitation et par la généralisation des rapports marchands. D’une certaine façon ces deux caractères font pléonasme : en effet, la condition nécessaire à l’empire incontesté de la marchandise est de reconstituer comme telle, au travers du salariat, la force de travail. Dès lors que cette dernière acquiert une valeur d’échange, le capitalisme peut conquérir la sphère de la production et assurer sa complète domination sociale.
Il en résulte que la destruction du capitalisme ne saunait consister en une simple modification de ses formes juridiques (nationalisation, étatisation) ou de ses règles de gestion. Elle ne peut être que la ruine de ses fondements, le salariat et la marchandise. Elle ne peut donc, a fortiori, se confondre avec leur extension, quel que soit le discours idéologique justificatif, a des sociétés largement précapitalistes, ainsi qu’on le vit en Russie, en Chine et dans divers pays du Tiers-Monde. Pourtant s’il est aisé de poser les principes, il l’est moins de fixer les modalités pratiques.
II. La période de transition
La destruction révolutionnaire du capitalisme doit conduire au communisme. Mais comment ? Il est généralement entendu que le passage de l’un à l’autre des deux modes de production ne sera pas instantané et s’étendra sur une durée historique indéterminée : la période de transition. Cette notion s’enveloppe également d’un nuage d’ambiguïté. Entre, disons, le féodalisme et le capitalisme, les choses sont assez claires : la transition recouvre les trois ou quatre siècles pendant lesquels le capital s’est développé dans les interstices de la société féodale, affirmant peu à peu sa suprématie d’abord économique puis politique. La transition c’est la coexistence, l’imbrication de deux modes de production de plus en plus conflictuels. Les structures sociales anciennes se désagrègent tandis que l’expansion des forces productions engendrées par le mode de production progressif suscite l’apparition de nouvelles institutions et configurations idéologiques adaptées, ainsi que le renforcement d’une nouvelle classe dirigeante. Certes cette mutation peut ne pas aboutir et les forces neuves et anciennes s’équilibrer entraînant une stagnation puis éventuellement une décomposition. Dans un tel cas on ne peut valablement parler de transition : celle-ci implique un jugement a posteriori, du point de vue de l’organisation sociale triomphante. Cela illustre aussi la difficulté qu’il y a à saisir de l’intérieur un tel procès, dont la négativité est toujours mieux perceptible que la positivité.
Plus compliqué est le cas du passage au communisme. S’il est possible de concevoir une telle transition d’un système d’exploitation vers un autre, il ne l’est plus guère vers une société qui abolit l’exploitation. Une longue période d’enchevêtrement du communisme et du capitalisme durant laquelle le premier se consoliderait aux dépens du second est impensable. La transition au communisme commande la sortie hors du capitalisme. D’où une contradiction où s’enlisent le plus souvent les tentatives de caractérisation de cette période. La réponse la plus couramment proposée est celle du « socialisme », sorte de mode de production intermédiaire, distinct, mais dont personne n’a jamais pu exposer sur quels rapports de production il se fondait. Le fond de la confusion est atteint quand est présumée une « transition vers le socialisme ». C’est- à-dire une transition vers la transition ! Marx était plus rigoureux, et je pense qu’il faut en revenir là, quand il parlait de communisme inférieur et supérieur. Quels que soient les « stigmates du vieux monde » qui le rendent imparfait, il s’agit bien d’emblée du communisme, système nécessairement en progression permanente. Il en résulte que cette fameuse transition n’existe pas - ou bien qu’elle n’est rien d’autre que le capitalisme lui-même !
Reste certes entière la question de la destruction violente du capital et donc la guerre civile. Nul n’en peut prévoir les formes. Ce qui toutefois est assuré, c’est que cette guerre civile devra très rapidement atteindre une échelle mondiale et que toute stabilisation serait signe de défaite. Sa violence sera extrême ou au contraire modérée, mais elle sera - relativement - courte. Son but sera d’annihiler les instruments de répression et de coercition dont la bourgeoisie dispose principalement à travers l’État (armée, police), secondairement à travers des appareils privés (milices…). Toutefois l’éclatement même de la guerre civile ne saurait survenir sans un profond délabrement préalable du corps social et donc de ses capacités de résistance. La guerre civile n’est pas un coup d’État : elle s’appuie sur une impérieuse nécessité surgie des masses elles-mêmes. Elle est intervention brutale dans le politique. Mais est-elle un acte politique ?
III. La révolution contre la politique
« La politique au poste de commandement », disent les Chinois. D’autres, et non seulement les maoïstes, vont répétant que si la classe ouvrière perd le pouvoir politique elle perd tout. Ces formulations reflètent d’abord, bien sûr, la réalité des capitalismes d’Etat : dès lors que l’accumulation est accomplie par un Etat, lui-même entre les mains d’un parti identifié à la classe ouvrière, alors en effet tout paraît se condenser en politique.
Mais elles traduisent aussi une autre vérité, encore que défectueusement : la révolution prolétarienne est une révolution consciente d’elle-même et de ses buts ; elle est rupture avec les mécanismes aveugles qui distinguent le capitalisme. La politique étant généralement perçue comme le lieu de la libre décision, il s’ensuit que la classe ouvrière devrait être l’agent du triomphe de la politique, en laquelle toute vie sociale se résorberait. Mais il s’agit d’un contresens.
Le communisme n’est pas une politique. Il n’est pas un programme qu’il s’agirait d’opposer à d’autres programmes et de faire triompher par la force de son argumentation ou par la violence des armes. Les révolutionnaires n’ambitionnent pas la conquête de l’État et la substitution de leur pouvoir juste et raisonnable à celui de la bourgeoise injuste et scélérat. Le triomphe de la politique, avec celui de l’État, omniprésent, omniscient et sacralisé, c’est la bourgeoisie qui le réalise sous nos yeux. Cette forme supérieure du contrôle et de la contrainte renvoie au dérèglement du jeu spontané du capital et à la menace toujours renaissante de la classe ouvrière. La révolution, si elle advient, sera le renversement et non l’aboutissement de cette tendance. Loin de se lancer à la conquête de l’État, fût-il élevé à la dignité « d’ouvrier », la classe ouvrière affirmera à chaque pas plus radicalement son autonomie et son auto-organisation. Ce faisant elle ruinera la base de la distinction du politique comme activité séparée.
Ainsi les notions de démocratie et de dictature, référant aux formes juridiques du pouvoir étatique, tel qu’il fut formalisé par la philosophie des Lumières, cessent d’être adéquates. L’organisation que se donnera la classe ouvrière aura les apparences de la dictature, en ce sens qu’elle n’aura d’autre légitimité qu’elle-même, et de la démocratie, en ce sens que ses décisions seront le résultat du débat de l’ensemble des producteurs. Nulle institution ne viendra ni arbitrer, ni décider en dernier recours ; la politique en tant que lutte pour le pouvoir disparait, non en raison d’un « décret », mais faute d’objet. La dictature comme la démocratie proviennent de l’exigence de maintenir la cohésion sociale, soit par la coercition, soit par l’idéalisation, dans une société dont le mouvement même rompt les liens traditionnels et personnels existant entre les groupes et les individus. Ces liens assujettissaient les hommes à des institutions qui les divisaient (villages, corporations, familles, etc.), et les avoir brisés restera un des bienfaits du capitalisme. Mais ce bienfait ne se révélera tel que par la construction d’une communauté humaine élargie ; dans le temps de déclin du capitalisme il n’offre que l’image d’une profonde crise sociale. La révolution prolétarienne ne peut être que l’acte fondateur de cette communauté retrouvée. Elle ira dans cette voie dès ses premiers pas ; croire qu’elle devra reconstituer, despotiquement ou démocratiquement, une communauté fictive, c’est la fonder dès son origine sur la fausse conscience, donc la nier dans sa nature. Toutes les contorsions prétendument dialectiques n’y changent rien : les hymnes à la Politique, le culte de l’État (et de ses Hauts Dignitaires !) ne sont ni le socialisme, ni un chemin (détourné) y pouvant mener. Non point en raison d’un fétichisme anti-étatique mais parce qu’une telle perspective, contredisant absolument les objectifs sociaux et économiques de la révolution, se pose en obstacle à son essor et se révèle comme recours du capital face à ses propres contradictions. Du même coup elle retire toute nécessité objective à la révolution et apparait, au moins dans les pays capitalistes développés, comme largement utopique, plus utopique sûrement que la révolution elle-même. C’est cette incompatibilité qui s’éclairera dans la considération des transformations économiques engagées dans le cours révolutionnaire.
IV. La fin de l’économie
Sauf à fournir une nouvelle et convaincante analyse scientifique du mode capitaliste de production, il faut admettre que se crises et contradictions naissent de ses caractères originaux, le salariat et les rapports marchands, dont les normes de fonctionnement s’expriment principalement dans les lois de l’accumulation et de la valeur. Une révolution n’a de signification historique que si elle tend à résoudre ces contradictions ; elle ne peut le faire qu’en s’attaquant à leur noyau. Les révolutionnaires entreprendront d’emblée cette tâche en raison à la fois de la conscience qu’ils ont des buts à atteindre et de la nécessité contraignante d’assurer la continuité de la production et de la distribution des biens. La suppression de l’argent, du salaire, de l’échange monétaire sera engagée, et pour détruire les mécanismes du capitalisme, et en raison de cette destruction. En effet l’usage de ces formes sociales n’apparaitra pas seulement néfaste, mais dans la confusion de la lutte, impraticable ou au moins inutilement compliqué. La gratuité des biens élémentaires devra être sur le champ pratiquée et la production réorganisée en fonction des besoins immédiats — lesquels dans un premier temps pourraient être des armes !
Mais dira-t-on, si l’argent, le salaire, etc. disparaissent, comment la distribution sera-t-elle contrôlée ? Comment se fera la répartition ? Dans sa célèbre « Critique du programme de Gotha » Marx s’était déjà posé le problème et avait suggéré un système de bons, attribués en fonction du temps de travail et ouvrant droit à un prélèvement équivalent dans les biens de consommation. Cette formule semble à rejeter pour quatre ordres de raisons : la première, de principe, est que s’agissant d’un salaire déguisé il est trop aisément reconvertible en salaire réel ; la seconde est l’impossibilité technique de mesurer exactement et équitablement aussi bien le temps de travail accompli par le producteur que le temps de travail incorporé dans les marchandises ; la troisième est que si toutefois on le tentait cela engendrerait, pour fixer imparfaitement des critères objectifs puis pour en contrôler l’application, une bureaucratie aux dimensions et aux pouvoirs sans précédent ; enfin avec la division du travail et la diversification des produits le temps comme mesure n’a plus de signification ailleurs que dans la problématique de la valeur ; il est inutile et inutilisable hors de la logique capitaliste.
Dans ces conditions la gratuité, fût-elle accompagnée dans une première phase d’un rationnement quantitatif fondé sur l’application des besoins est préférable. La participation au travail de chacun devant, avant d’être volontaire et naturelle, être assurée par une coercition non pas policière, mais sociale et collective. On voit déjà que ce fonctionnement ne peut être effectif que si la classe révolutionnaire s’organise afin de pouvoir maîtriser cette forme de distribution sans médiation centralisatrice : l’auto organisation des producteurs conditionne l’accomplissement de ces tâches.
Soit, dira-t-on encore, admettons que la distribution soit effectuée. Mais qu’en sera-t-il de la production, du choix des investissements ? Il faudra bien déterminer des coûts comparatifs et donc choisir un étalon. Où l’on retrouverait le temps de travail. Là encore on reste dans la logique de l’échange, seule justification non seulement d’un étalon universel, mais du simple besoin de cet étalon. L’unique bon sens permet de saisir à quel point l’appréciation des coûts par le temps est insuffisant. Construire massivement des automobiles à essence, en l’état actuel des moyens de production disponibles, représenterait probablement un coût inférieur à la production massive de voitures électriques ; Mais comment chiffrer le coût de la pollution ? Faudrait-il imaginer le coût de la construction d’usines de régénération de l’air vicié ? De tels exemples pourraient être multipliés et à un degré de sophistication bien plus élevé. Ce qui doit être clair c’est qu’une société qui voudrait étayer ses choix en fonction des besoins sociaux réels devrait prendre en compte un ensemble de critères hétérogènes et non quantifiables. Ce n’est que dans des cas particuliers, quand s’offriraient des choix entre des solutions très proches, que le temps de travail nécessaire pourrait emporter la décision.
L’unique contrainte à cet égard proviendrait du temps de travail globalement disponible et de son affectation. Mais il s’agit là d’un problème d’organisation et non de valeurs comparées. La révolution dès ses débuts devra s’engager dans ce procès de dissolution des critères quantitatifs d’orientation de la production et des investissements. Elle pourra utiliser les moyens techniques hérités du capitalisme, mais non ses instruments de gestion. Ainsi que le pressentit Gramsci, l’objectif n’est rien que l’universel subjectif.
La socialisation de la consommation et des principales activités productives, leur réorientation et la disparition des secteurs parasitaires liés à la réalisation et à la répartition de la plus- value, aux circuits du capital-argent (banques, assurances, publicité, sécurité sociale, etc.) d’une part permettra un fort désinvestissement et d’autre part libérera une main d’œuvre aussitôt affectée à la production et provoquant une rapide diminution du temps de travail. De même qu’il est contre la politique le communisme est contre l’économie : sa fin s’illustre en ce rapide survol des « mesures économiques ». Ou encore : la « science » économique se montre dans sa misérable nudité, une formalisation de despotisme du capital. Elle s’effondre si le libre choix des producteurs associés s’impose.
V. Quelle dictature
Mais où et comment ce libre choix peut-il s’exercer ? N’implique-t-il point une dictature violente, justement la dictature du prolétariat ? Sans doute, mais encore faut-il précisé. La dictature du prolétariat, la dictature des producteurs associés, dans la mesure où elle ne peut accomplir ses tâches que par la conscience collective du prolétariat, ne saurait déléguer ses pouvoirs de discussion et de décision. Elle doit donc créer des formes organisationnelles adéquates à une réelle immanence des producteurs associés à la société. L’expérience historique a montré que cette forme est celle du conseil ouvrier. Sans doute ne sera-t-il point une forme définitive. Peut-être les conseils qui se créeront dans les futures poussées révolutionnaires étonner ont-ils ceux-là même qui les attendent.
Mais ils sont jusqu’alors notre seul exemple. La dictature du prolétariat c’est le pouvoir des conseils. Elle s’exercera non point, sauf durant la guerre civile et dans des situations limites, par la coercition policière ou juridique ainsi que dans les sociétés actuelles, mais par l’exclusion des non-producteurs de la délibération sociale.
Les conseils organisés sur les lieux de production auront le monopole des armes et le contrôle de la presse. Mais de même que chaque membre d’un conseil sera armé, il pourra s’exprimer librement par l’écrit et la parole. Le contrôle de la presse ne signifiera pas la centralisation et l’unicité de l’expression mais sa diversité illimitée. Les conseils effaceront la division des pouvoirs. Les sphères juridiques du public et du privé ne se distingueront plus, bien que le privé ne se confonde point au public.
La dictature sera de fait, non de droit. Elle n’a point besoin d’institutions originales. Elle est la dictature sociale d’une classe. La seule façon de s’y soustraire sera d’en partager l’exercice en partageant l’effort productif.