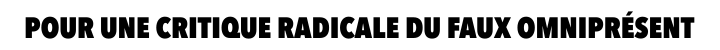La notion de « capital monopoliste d’État » ne va pas, en fin de compte, au-delà d’une description correcte de l’état actuel de la société. Le système capitaliste est taraudé en tous sens par des monopoles et se trouve dans une large mesure déterminé par eux. L’État, qui a pour fonction de protéger la structure sociale, est ainsi l’État du capital monopoliste. Il ne s’agit nullement, toutefois, d’un phénomène social nouveau, mais d’un caractère de tout temps inhérent au capitalisme, bien que sous une forme moins développée jadis.
Selon Marx, qui nous a laissé la meilleure analyse du capitalisme, la concurrence capitaliste présuppose le monopole — à savoir, le monopole capitaliste des moyens de production. Les rapports de classe antagoniques qui s’ensuivent rendent indispensable le pouvoir d’État, celui-ci veillant également aux intérêts capitalistes nationaux sur le plan de la concurrence internationale.
Le capitalisme purement concurrentiel n’a jamais existé que dans l’imagination et les modèles de la théorie économique bourgeoise. Même là on parlait de monopoles naturels et de prix de monopole. Tout en étant censés échapper aux lois du marché, les monopoles — selon la théorie — étaient foncièrement incapables d’y contrevenir. Ce n’est qu’avec la monopolisation de secteurs industriels entiers que les économistes bourgeois se sont vus obligés d’affronter la réalité — à savoir, la prédominance de la concurrence imparfaite ou monopoliste — et de discuter des modifications monopolistes du marché.
Pour l’économie politique bourgeoise, il s’agissait donc d’une complète volte-face théorique. Mais il y avait longtemps déjà que Marx avait vu dans ce phénomène une tendance de développement inhérente, depuis ses débuts, à l’accumulation du capital. Selon lui, la concurrence entraîne la concentration et la centralisation des capitaux. Le monopole est issu de la concurrence, tout comme la concurrence monopoliste est issue du monopole. L’État lui aussi joue dans la théorie de Marx un rôle plus grand que le monde bourgeois n’était disposé à l’admettre — l’État pris non seulement en tant qu’appareil d’oppression, mais aussi en tant qu’instrument pour préparer et pour protéger l’expansion capitaliste.
Le concept de « capital monopoliste d’État » va donc de soi, puisqu’il renvoie à rien d’autre que le capitalisme lui-même. On peut certes distinguer différentes étapes dans la monopolisation de l’économie comme dans les interventions de l’État. Le développement du capitalisme devient ainsi synonyme d’essor du capital monopoliste d’État. Dès lors se pose la question de savoir ce que cela signifie pour le présent et pour le proche avenir. C’est dans ce contexte que l’accent particulier mis sur le caractère monopoliste d’État du capitalisme moderne prend toute son importance.
L’accumulation capitaliste tend non seulement à réduire progressivement la structure de classe à la division entre capital et travail, mais aussi à concentrer et centraliser de plus en plus le pouvoir de décision sur le capital en expansion. « Un capital en tue beaucoup d’autres », et ce que la concentration à travers la concurrence ne réaliserait pas, la centralisation consciente au moyen des trusts, des cartels, de la monopolisation, réussit à le faire. Ainsi, le capitalisme se transforme constamment, bien que ce soit toujours sur la base de rapports d’exploitation immuables.
Pour Marx, le déclin du système était inscrit dès l’origine. Les mêmes rapports sociaux qui permettent l’expansion du capitalisme déterminent aussi son effondrement. L’accumulation du capital est un processus qui va de crise en crise, et dans les conditions d’un capitalisme développé, dans lequel les ouvriers forment la classe décisive, chaque grande crise offre la possibilité d’une révolution sociale. Cependant, si l’on fait abstraction de cette possibilité, le développement capitaliste — à travers ses reculs en périodes de crise et malgré eux — tend à renforcer la monopolisation de l’économie de chaque pays et la concurrence monopoliste internationale.
Ce développement a souvent été conçu comme une préparation objective au socialisme, indépendamment des mouvements d’inspiration socialiste. Le passage de la concurrence au monopole et à la production d’unités de capital énormes à travers l’accumulation, la concentration et la centralisation, a eu pour effet de transformer la propriété privée capitaliste des moyens de production en propriété collective de sociétés par actions et de grands monopoles, dont les directeurs cessent d’être les propriétaires. Pour Marx, il s’agissait de « la suppression du mode de production capitaliste à l’intérieur du mode de production capitaliste lui-même, donc une contradiction qui se détruit elle-même et qui, apparemment, se présente comme simple phase transitoire vers une nouvelle forme de production. C’est aussi comme une semblable contradiction que cette phase de transition se présente. Dans certaines sphères, elle établit le monopole, provoquant ainsi l’immixtion de l’État. Elle fait renaître une nouvelle aristocratie financière, une nouvelle espèce de parasites, sous forme de faiseurs de projets, de spéculateurs et de directeurs purement nominaux ; tout un système de filouterie et de fraude au sujet de fondation, d’émission et de trafic d’actions. C’est là de la production privée sans le contrôle de la propriété privée »1.
Alors que cette situation était, aux yeux de Marx, une expression de la décadence du capitalisme déjà en cours, Friedrich Engels lui a aussi trouvé un côté positif, à savoir que la production non-planifiée du capitalisme était en train de céder la place à la production planifiée d’une société socialiste. Selon lui, « les forces productives elles-mêmes poussent […] à leur affranchissement de leur qualité de capital », d’où la « nécessité grandissante où l’on est de reconnaître leur nature sociale, nécessité obligeant la classe capitaliste elle-même à les traiter de plus en plus comme forces productives sociales, dans la mesure du moins où c’est possible à l’intérieur des rapports capitalistes » 2.
Bien entendu, il est évident aux yeux d’Engels que « ni la transformation en sociétés par actions, ni la transformation en propriété d’État, ne supprime la qualité de capital des forces productives ». C’est là chose manifeste en ce qui concerne les sociétés par actions ; quant à l’État, « plus il fait passer de forces productives dans sa propriété, plus il devient en fait le capitaliste collectif, plus c’est lui qui exploite les citoyens. Les ouvriers restent des salariés, des prolétaires. Le rapport capitaliste n’est pas supprimé, il est au contraire poussé à son comble. Mais arrivé à ce comble, il se renverse. La propriété de l’État sur les forces productives n’est pas la solution du conflit, mais elle renferme en elle le moyen formel, la façon d’accoucher la solution ». Le mode de production capitaliste, « en poussant de plus en plus à la transformation des grands moyens de production socialisés en propriété d’État, montre lui-même la voie à suivre pour accomplir ce bouleversement »3.
Si Engels voit encore la monopolisation et l’étatisation de l’économie comme un processus accompagné de crises, pour Hiferding, elles sont le moyen d’éliminer les crises économiques, le problème du socialisme devenant ainsi une question purement politique. Bien que le développement de la monopolisation charge d’un fardeau toujours plus lourd toutes les classes non-capitalistes, ce processus aboutit finalement à une production cartelisée et régie consciemment, avec le résultat que l’antagonisme social qui continue à exister est limité à la sphère de la distribution. Tout ce qu’il reste à réaliser, c’est la « régulation consciente de l’économie, non par les magnats du capital et à leur profit, mais par la société globale et à son profit ». La fonction, déjà socialisée, du capital financier — fusion du capital industriel et du capital bancaire — « est facilitée considérablement par la suppression du capitalisme. Dès que le capital financier a mis la main sur les principales branches de la production, il suffit que la société — au moyen de son organe conscient d’exécution, l’État hérité par le prolétariat — prenne le contrôle du capital financier pour maintenir le contrôle sur ces branches de la production » 4.
Pour Hilferding, comme le capital financier a déjà réalisé l’indispensable expropriation du capital privé, l’étatisation signifie seulement l’étape finale de la socialisation des moyens de production, entreprise par le capital lui-même. Cette idée a été reprise également par Lénine. Dans ses écrits sur l’impérialisme, il qualifie la position atteinte par le capitalisme au tournant du siècle de monopoliste, parasitaire, stagnante et mourante. On pouvait caractériser cette étape du développement par la « dissolution de la concurrence libre par le capitalisme monopoliste et par le développement d’un appareil de gestion sociale du processus de production et de division du produit par les banques et les cartels capitalistes »5. Nous nous bornerons ici à noter que, pour Lénine, l’impérialisme va de pair avec le règne du capital financier, et que celui-ci constitue le préalable organisationnel du socialisme. Le pouvoir de décision sur le capital social, centralisé par le capital financier monopoliste, ne nécessite rien de plus que sa prise en main par l’État prolétarien et sa mise en œuvre au service du peuple tout entier.
Cette conception, qui remonte à Engels et que partagent Hilferding et Lénine, malgré leurs divergences, — selon lequel le capital monopoliste est le précurseur de la société socialiste — repose sur l’idée fausse que les formes d’organisation sociale accompagnant la concentration du capital et la socialisation de la production sont une seule et même chose. Face à l’organisation rationnelle et planifiée de chaque usine, la gestion de l’économie globale se révèle irrationnelle et non-planifiée, ce qui amenait Lénine à concevoir l’économie socialiste comme une gigantesque usine dirigée par l’État. En réalité, l’usine est aussi irrationnelle que l’économie globale, sauf si l’on admet que la recherche capitaliste du profit est un principe de production économiquement rationnel. Toute usine est soumise, aux exigences expansionnistes du capital exactement comme l’est la société dans son ensemble, et elle ne fonctionne que dans le cadre de la concurrence générale ou monopoliste qui détermine sa forme organisationnelle.
D’ailleurs, poussés par la recherche du profit, les monopoles eux aussi n’organisent que leur propre activité. Et s’ils étaient tous amenés sous le contrôle centralisé de l’État, celui-ci ne pourrait que reproduire le nouveau rapport capitaliste qui aurait été créé entre lui-même et les producteurs — à moins que ceux-ci n’abolissent l’État. Ceci ne nécessite pas de démonstration théorique supplémentaire, les États dits « socialistes » ayant depuis longtemps fait la preuve pratique qu’en l’occurrence le concept de socialisme recouvre la réalité du capitalisme d’État.
En fait, le capitalisme d’État peut, serait-ce au moyen d’une révolution, se développer à partir du capital monopoliste et, pour ainsi dire, porter la monopolisation à sa conclusion logique. Or, le monopole total des moyens de production n’élimine pas pour autant le rapport capitaliste ; il ne fait que le libérer de la concurrence du marché, sans abolir par là la concurrence elle-même. En dehors du fait que la concurrence continue en tout cas au niveau international, à l’intérieur de chaque pays capitaliste d’État elle ne fait que passer d’un mode d’expression économique à un mode politique.
Certes, le capitalisme d’État s’est trouvé jusqu’à présent restreint aux pays de capitalisme sous-développé, ou encore aux pays auxquels il a été imposé par des moyens impérialistes, comme en Europe de l’Est. Les pays correspondant au critère léniniste de capital monopoliste sont restés à ce stade, bien que le rôle de l’État y ait augmenté. Les territoires sous-développés du point de vue capitaliste n’ont aucune possibilité de se développer par le biais de la concurrence à l’intérieur d’un marché mondial contrôlé par les monopoles.
Ces pays, qui ressemblent plus ou moins à la Russie pré-révolutionnaire, c’est-à-dire qu’ils comptent une bourgeoisie faible, une minorité de prolétaires, et une majorité écrasante de paysans, ne peuvent contrebalancer les avantages acquis par les États monopolistes que par un contrôle monopoliste encore plus rigoureux de la vie économique. Le capitalisme monopoliste a engendré le capitalisme d’État, non pas à l’intérieur de l’économie monopolisée, mais dans la lutte contre elle.
L’exemple de la Russie a démontré qu’une économie dirigée par l’État est effectivement capable, au moins pour de grands pays, d’accélérer le processus d’ industrialisation, bien qu’aux frais de la population travailleuse et au profit de la nouvelle classe dominante, issue du capitalisme d’État.
Puisant son inspiration dans le rôle considérable joué par l’État dans le cadre des économies de guerre de 1914-1918, Lénine considérait le capitalisme monopoliste, qui lie l’État au sort des entreprises impérialistes dans lesquelles il est contraint de se lancer, comme identique au « capitalisme monopoliste d’État », par la prise en charge par l’État des intérêts des monopoles.
Soustraire l’État à l’emprise de ces derniers et le consacrer exclusivement au service du peuple, telle devrait être — à ses yeux — la prochaine étape en direction du socialisme. Il fallait donc faire voler en éclats l’État des monopoles pour laisser le champ libre au nouvel État, seul apte à réaliser effectivement l’abolition de l’exploitation. Le capitalisme d’État céderait ainsi la place à l’État socialiste, sans que disparaisse pour autant le contrôle centralisé de l’économie globale. Pour les léninistes, ce programme n’a rien perdu de sa vitalité aujourd’hui encore, bien qu’il revienne à rejouer la même pièce avec d’autres acteurs.
Assimiler ainsi le capitalisme d’État au socialisme — conçu comme une étape de transition à un communisme sans État, renvoyé à un avenir — conduit tout naturellement à assimiler la lutte pour le socialisme à une lutte contre le capitalisme monopoliste d’État moderne. Seule la voie révolutionnaire convient à cette lutte, car le capitalisme monopoliste d’État n’abdiquera pas de bon gré. Et le capitalisme d’État présupposant lui aussi l’exploitation des ouvriers, il lui faut liquider la domination actuelle de la classe bourgeoise.
Mais les partis communistes des pays occidentaux, qui en apparence sont aujourd’hui en lutte contre le capitalisme monopoliste d’État, ont cessé depuis 1920 d’être des mouvements révolutionnaires. Ne songeant plus à imposer leur programme révolutionnaire propre, ils livrent une petite guerre contre le capitalisme d’État afin de s’y ménager une place et d’y gagner de l’influence.
Cela ne signifie nullement que ces partis ont rompu avec leurs buts ultimes. Qu’un mouvement anticapitaliste prenne son essor, et il est certain qu’ils feront tout pour le dévoyer dans un sens capitaliste d’État. Mais comme il n’est pas question encore de tels mouvements, ces partis cherchent uniquement à s’emparer de positions de pouvoir au sein de l’ordre établi. Leur “lutte” contre le capitalisme monopoliste d’État reste donc purement verbale, simple rhétorique visant à leur rallier les “masses” qui, en un premier temps, se dressent non pas contre le capitalisme lui-même, mais seulement contre ses “mauvais côtés”.
Ainsi les partis communistes, qui ne sont ni contre le capitalisme, ni contre l’État, ne s’opposent qu’à un État placé au service exclusif des monopoles et se prononcent pour un État et un capitalisme capables de servir l’intérêt général.
Toutefois, l’intérêt général ne peut exister que dans une société sans classes. Au sein du capitalisme, il n’existe que des intérêts de classes incompatibles entre eux. Les catégories sociales de mentalité capitaliste qui sont victimes de la monopolisation ne sauraient par conséquent être gagnées au socialisme, qui détruirait leur position sociale spécifique encore plus rapidement et profondément que le capitalisme monopoliste. Elles peuvent au mieux être gagnées sur une base capitaliste à une politique qui promet de protéger leurs intérêts particuliers, c’est-à-dire une politique antisocialiste. Et, en effet, les mots d’ordre de lutte contre le capital monopoliste d’État dissimulent les signes avant-coureurs d’une politique antisocialiste et contre-révolutionnaire.
Il est certes concevable que la monopolisation toujours accrue de l’économie, qui a pour effet de prolétariser les couches petites-bourgeoises, puisse convaincre une partie de leurs membres que le capitalisme d’État est leur dernière chance, dans la mesure où il pourrait leur rouvrir l’accès à des carrières que le capitalisme monopoliste leur interdit désormais. Croyance justifiée d’ailleurs, comme un simple coup d’œil sur les pays “socialistes” suffit à le démontrer.
Mais s’agissant des ouvriers cette fois, le même coup d’œil révélera tout autre chose. Les ouvriers ne tiennent pas du tout à ce genre de “socialisme”. Dans les pays comme la France et l’Italie où ils ne sont pas sans avoir une certaine importance, les partis communistes n’ont d’attrait à leurs yeux que dans la mesure où ils incarnent non pas une volonté de transformation révolutionnaire du capitalisme monopoliste en capitalisme d’État, mais seulement une forme de représentation politique de leurs intérêts au sein du système social existant. En l’occurrence, les partis communistes ont des fonctions réformistes, et non pas révolutionnaires, et, par là même, ils servent en dernière analyse à maintenir en place le capitalisme monopoliste d’État.
Dès lors, la lutte prétendue contre le capital monopoliste d’État ne fait que camoufler un méli-mélo politique. Il y a beau temps que les partis communistes ont perdu la volonté d’attaquer le capitalisme lui-même, à l’échelle internationale comme à l’échelon national, ainsi qu’il s’ensuit tant du programme de “coexistence pacifique” que des rapports commerciaux entre systèmes sociaux différents. Il est bon de faire ressortir que, sur le plan national, la gauche s’oppose uniquement à la dictature égoïste des monopoles, non à l’État ou au capitalisme eux-mêmes, et que ses luttes visent uniquement à participer au gouvernement afin de placer les monopoles sous l’autorité de l’État.
Sur le plan international, la petite guerre contre le capital monopoliste d’État se plie aux besoins immédiats de la politique impérialiste. La gauche combat à cet égard non le capital impérialiste lui-même, mais les politiques impérialistes, opposées à ses propres options nationales ou impérialistes, que les gouvernements en place poursuivent au profit des monopoles. La distinction entre capitalisme et “capitalisme monopoliste d’État” sert à justifier à la fois les alliances et les antagonismes entre pays capitalistes et pays “socialistes” et, par-dessus le marché, les litiges entre les pays “socialistes” eux-mêmes. Autrement dit, les partis communistes cachent leur propre politique capitaliste et, partant, impérialiste sous le mot d’ordre de lutte contre le capitalisme monopoliste d’État, destiné à gagner les ouvriers à leur cause à eux.
Ainsi, la “théorie” du capital monopoliste d’État sert d’une part à justifier l’activité purement réformiste des partis communistes des pays capitalistes et, d’autre part, à faire face aux exigences de politiques impérialistes. Elle exprime ainsi le fait que, malgré leurs différences, les pays capitalistes et “socialistes” ont les uns et les autres le même objectif, la défense de rapports de production capitalistes contre toute transformation socialiste.
C’est là chose implicite dans la théorie actuellement à la mode de la “convergence” qui, censée refléter le processus d’industrialisation, prétend surmonter les différences entre les deux systèmes sociaux. Comme le processus d’industrialisation des pays capitalistes d’État est semblable à celui des pays monopolistes, d’après cette théorie, les formations sociales ne diffèrent qu’en fonction du degré atteint par la centralisation du contrôle de la production et de la distribution sociale. Ce processus ayant déjà, dans les pays de capitalisme monopoliste d’État, abouti à la séparation de la propriété et du contrôle, il ne reste qu’un pas à faire pour transformer complètement le capitalisme privé en capitalisme d’État et, ce pas, on peut le franchir à l’aide de moyens politiques. Cela fait, le socialisme sortira de son cocon capitaliste et la lutte des classes sociales prendra fin.
Ainsi donc, les théoriciens du capitalisme monopoliste d’État envisagent uniquement l’élimination des monopoles, seule transformation à apporter, selon eux, au système de production actuel, conforme par ailleurs aux exigences du socialisme. D’où leur manque relatif d’intérêt pour le cycle des crises inhérent au capitalisme moderne. Quant aux difficultés et aux injustices qui vont toujours de pair avec ce système, ils en voient la cause dans l’État, lequel confondrait les intérêts des monopoles avec les siens propres. Ce qu’il faut, c’est un autre État, ou un autre gouvernement, pas un autre système économique.
À cet égard encore, les idées du capitalisme moderne coïncident avec celles du capitalisme d’État. Le capitalisme monopoliste d’État lui aussi se targue d’avoir mis un terme à la propension du système aux crises grâce aux interventions de l’État dans les mécanismes économiques. Mais cette illusion vient buter sur des réalités têtues, elle est déjà en train de perdre sa crédibilité. Et c’est pourquoi l’“opposition” au capitalisme monopoliste d’État se présente sous la forme d’une revendication de mainmise très étendue — et finalement totale — de l’État sur l’économie en vue de liquider toute possibilité de soulèvements sociaux.
Comme la bourgeoisie elle-même, les critiques “de gauche” du capitalisme monopoliste d’État recherchent une solution capitaliste aux contradictions du capitalisme. La bourgeoisie a depuis longtemps cessé de croire à une régulation automatique de l’économie par le marché. Avec le déclin de la concurrence, les prix et les profits ne sont plus déterminés par le marché, mais au contraire établis librement par les monopoles. Faute de pouvoir transformer la structure monopoliste de l’économie, l’État est obligé d’intervenir non seulement pour assurer le plein emploi par le biais d’une politique monétaire et fiscale, mais aussi pour plier salaires et prix aux exigences de la stabilité économique.
Il incombe à l’État d’accomplir par des moyens politiques ce que le marché capitaliste seul n’arrive plus à réaliser. En fait, les interventions de l’État dans l’économie sont allées en augmentant continuellement. Ces manipulations ont donc permis d’atténuer les crises, d’où l’idée qu’une régulation consciente du capitalisme est bel et bien possible.
Les théories socialistes avaient déjà anticipé ces développements. Hilferding, par exemple, écrivait : « Si les groupes monopolistes suppriment la concurrence, ils suppriment du même coup le seul moyen par lequel peut se manifester une loi objective des prix. Le prix cesse d’être une grandeur objectivement déterminée, il peut être fixé consciemment. […] Le groupe monopoliste, expression concrète de la théorie marxienne de la concentration du capital, paraît ainsi impliquer l’élimination de la théorie marxienne de la valeur 6. »
Ce qui passait l’entendement de Hilferding, c’était que, suivant la théorie de Marx, la loi de la valeur détermine seulement le niveau général des prix et ses fluctuations, non les prix eux-mêmes. Dans les conditions de la libre concurrence, il existe une tendance à l’établissement d’un taux de profit moyen par le biais d’un décrochage des prix d’avec la valeur. Telle est aussi la manière dont les surprofits, ou prix de monopole, se sont formés tout au long de l’histoire du capitalisme, fournissant en fait l’une des bases de l’accumulation accélérée du capital. À mesure que la monopolisation de l’économie progresse, les prix de monopole ont pour effet de réduire le taux de profit moyen réalisé par les capitaux concurrentiels, les profits de ce secteur se trouvant transférés à celui des monopoles. Mais le déclin de la concurrence fait à son tour disparaître la possibilité de ces transferts de profits ; le taux de profit monopoliste tend au taux de profit moyen déterminé par la loi de la valeur.
L’économie monopoliste n’abolit nullement la loi de la valeur : elle en confirme au contraire la validité, comme le montrent et la baisse du taux de profit et du taux d’accumulation qui lui est lié — lequel baisse lui aussi en ce qui concerne le capital monopoliste —, et les interventions étatiques dans l’économie que cette situation rend indispensables. Mais ces dernières se heurtent à des butoirs, les limites bien déterminées que leur imposent les rapports de production capitalistes, et ne constituent donc que des palliatifs temporaires. Ces voies de recours une fois fermées, la tendance du capitalisme aux crises réapparaît, offrant de nouveau une possibilité de transformation révolutionnaire du système capitaliste. Le caractère monopoliste d’État du capitalisme d’aujourd’hui place ainsi le prolétariat devant la même tâche qui lui incombe sous n’importe quelle forme de capitalisme : abolir les rapports capitalistes par l’élimination du travail salarié au sein d’une société sans classes.