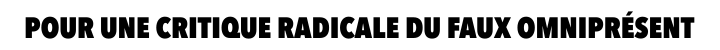J’ai rencontré Guy Debord pour la première fois le 27 octobre 1960. Nous nous étions téléphoné deux jours auparavant pour convenir d’une rencontre. Une manifestation contre la guerre d’Algérie qui s’annonçait comme devant revêtir une importance particulière était prévue pour le surlendemain. Elle devait débuter à la “Mutualité”. J’habitais chez mes parents, à proximité du Panthéon, donc à proximité de la “Mutualité”. Nous avions donc convenu de nous rencontrer chez moi, et de nous rendre ensemble à la manifestation. Nous avons discuté une heure environ, avant de rejoindre la foule, où nous nous sommes trouvés très vite séparés par les bagarres et les charges de police. Cette première rencontre devait être suivie de beaucoup d’autres.
J’avais dix-neuf ans. Je venais d’adhérer à Socialisme ou Barbarie grâce à Jean-François Lyotard. J’arrivais, très ignorant, de ma province, et je m’étais lancé corps et âme dans l’activité “révolutionnaire” avec la fougue et les naïvetés de la jeunesse. Socialisme ou Barbarie m’ouvrait la perspective d’une critique radicale du monde capitaliste, tant dans sa version occidentale que dans sa version “soviétique”. L’idée même que l’on pût faire de la politique, en deçà de ce programme minimum, m’était inconcevable, et le parti “communiste” m’apparaissait comme un parti d’extrême-droite, au même titre que tous les autres.
Daniel Blanchard, alias Canjuers, qui m’avait précédé à S. ou B., était parti effectuer son service militaire comme coopérant en Guinée. Il avait, avant son départ, entretenu des relations avec Guy Debord. De leur rencontre était né un texte commun intitulé “Préliminaires pour la définition de l’unité du programme révolutionnaire”. Canjuers avait fait circuler ce texte, mais S. ou B. n’y avait accordé qu’une attention distante, pour ne pas dire condescendante. J’avais cependant été désigné et très officiellement chargé, sur les instances de Canjuers, de maintenir le contact avec Guy Debord, qui lui-même en avait été averti…
À quelque temps de cette première rencontre et de cette manifestation mémorable, par un hasard qui n’en était pas un, je rencontrai Guy Debord, en compagnie de Michèle Bernstein à la terrasse d’un petit café maintenant disparu du boulevard St Germain, près de la rue St-Guillaume. Ils venaient de visiter l’exposition d’un artiste qui se tenait rue du Pré-aux-Clercs, dans la cave sommairement aménagée d’un immeuble. Cet immeuble se trouvait appartenir à la famille d’un ami d’enfance que j’avais perdu de vue pendant plusieurs années. Je venais de le retrouver avec plaisir. Il venait, comme moi, de “monter à Paris” pour faire ses études. J’avais reçu une invitation à cette exposition, et j’avais cru, en lisant l’adresse, qu’elle m’avait été adressée par cet ami. En fait, elle m’avait été envoyée par Debord et les situationnistes. Lorsque je rencontrai Guy Debord et Michèle Bernstein à la terrasse de ce café, j’avais visité cette exposition la veille, mais j’ignorais qu’ils avaient entretenu ou entretenaient une relation quelconque avec cet artiste, en dehors du fait qu’ils sortaient eux-mêmes de cette exposition, comme ils me le dirent pour expliquer leur présence en ce lieu.
C’est donc en toute liberté que je leur déclarai toute l’indifférence que j’attachais à cette activité et mon mépris pour un art décomposé, dans une société dont j’ignorais encore qu’elle était en décomposition. Cette exposition, dont je n’exclus pas qu’elle ait pu révéler un certain talent plastique et pictural, ne m’a laissé aucun souvenir, en dehors du fait qu’elle comportait, dans un endroit retiré auquel tout le monde n’accédait pas, et que mon ami m’avait montré avec gêne, un Christ en croix blasphématoire, en ce qu’il était peint nu et qu’un petit moteur électrique dissimulé derrière la toile, lui faisait alternativement replier des bras en carton en gonflant les biceps, et glisser le cache-sexe saint-sulpicien convenu, en carton également.
Je disais à Guy Debord et à Michèle Bernstein que cette volonté blasphématoire me paraissait être tout le contraire d’une activité critique révolutionnaire. Outre qu’elle était contre-productive, elle dénotait une obsession chrétienne jusque dans son apparente contestation. Je me souviens que j’évoquais les peuples italien et espagnol, chez qui le blasphème cohabite avec l’imprégnation chrétienne, dont il est, et n’est que… la rançon, ou plutôt l’autre face de la même médaille. Guy Debord et Michèle Bernstein en convinrent immédiatement, avec, peut-être, un peu de réticence de la part de Michèle Bernstein, autant qu’il m’en souvienne.
Dans les nombreuses rencontres qui suivirent, il ne fut non plus question ni d’art, ni d’artiste. On peut d’ailleurs vérifier, à la simple lecture des numéros d’Internationale Situationniste, le changement d’attitude à l’égard de l’art comme activité séparée et de son dépassement, qui se manifeste à partir du n° 5 (décembre 1960), où est, précisément, annoncée la publication du texte commun Debord-Canjuers (page 11). Je ne sais pas si mes propres positions à ce sujet ont eu quelque influence sur Debord, mais j’en doute. Et si tel était le cas, ce ne serait de toute façon qu’au terme d’un processus déjà bien engagé, sinon complètement achevé, avant notre rencontre.
A partir de ce moment, mes rencontres avec Debord se multiplièrent. On peut aisément suivre la trace de leur influence dans les numéros 5, 6 et 7 d’Internationale Situationniste. C’est ainsi que j’amenais Debord à adhérer formellement à S. ou B.
Lorsque j’évoquai ces souvenirs en réponse aux questions d’un ami qui se trouve avoir été un grand connaisseur de l’histoire, des publications et des polémiques autour de l’Internationale Situationniste, il a manifesté une véritable stupéfaction. Il croyait à peu près tout connaître sur le sujet, mais il ignorait cet épisode. Il pensait donc que Debord avait cherché à cacher ou à gommer ce fait. C’est son étonnement qui m’a fait prendre conscience qu’il n’existe aucun texte, ni rien qui fasse allusion à l’adhésion formelle de Debord à S. ou B., alors que les numéros d’Internationale Situationniste constituent une chronique assez complète et assez fidèle de tout ce qui méritait d’être retenu de la vie et des pensées des situationnistes. Cet ami me soutenait même qu’à sa connaissance, la plupart des situationnistes l’auraient ignoré. Pourtant, c’est cette adhésion qui est à l’origine d’une véritable mue de l’I. S., qu’il est aisé de constater à la lecture de la revue, et qui explique seule l’audience qu’elle acquerra.
Toujours est-il, je suis catégorique, que Debord a adhéré à S. ou B. Il a participé aux réunions du groupe, la plupart du temps au café “Le Tambour”, à la Bastille, et aux comités de rédaction de la revue, ainsi qu’à ceux du bulletin Pouvoir Ouvrier.
Je suis incapable de préciser à quelle date s’est concrétisée cette adhésion. Mais le 20 décembre 1960 se déclenchaient de puissantes grèves en Belgique. Après les grèves d’Allemagne de l’Est en 1953, dont j’avais appris la réalité en lisant les anciens numéros de S. ou B., et surtout la formidable insurrection hongroise de 1956, où les conseils ouvriers avaient joué un rôle dirigeant (voir S. ou B. n° 20 et 21), nous ne doutions plus de l’effondrement inéluctable du régime stalinien et nous attendions le réveil de la classe ouvrière européenne, qui permettrait, pour commencer, « de pendre Maurice Thorez à un réverbère avec les tripes de Benoît Frachon ». Le groupe s’était réuni le samedi 31 décembre avec un camarade anglais de Solidarity qui revenait de Belgique, et le groupe avait décidé de m’y envoyer, pour “couvrir” les événements et prendre un maximum de contacts. Guy Debord participait à cette réunion. Il venait lui-même de recevoir une lettre d’un Belge adressée à la revue Internationale Situationniste. Debord m’avait confié cette lettre en me chargeant de rencontrer l’auteur, à la fois pour le compte de l’I.S. et de S. ou B.
Il s’agissait de Raoul Vaneigem. (D’ailleurs, beaucoup plus tard, alors que Vaneigem s’était enfui précipitamment de Belgique avec une de ses élèves parce que la Gendarmerie lui cherchait des noises pour « détournement de mineure », mon épouse a prêté des vêtements à cette “mineure” fort adulte. Mais si j’ai parfois apprécié ses articles dans l’I.S., je n’ai pas souvenir de conversations intéressantes – je veux dire : qui m’aient intéressé – avec Vaneigem, et je n’ai jamais lu son livre). Un peu plus tard, Debord participa à un voyage collectif du groupe où nous avions essayé de structurer en “organisation” nos contacts en Belgique et rencontré Robert Dehoux. L’équipée avait été assez loufoque, et décevante, mais cela sort du sujet.
La date de la démission de Debord, par contre, est certaine : le 22 mai 1961 au soir, au terme d’une “Conférence internationale” (un bien grand nom pour peu de chose) de trois jours qui s’était tenue à Paris avec trois ou quatre camarades de Solidarity (voir S. ou B. n° 33, page 95. Les prétendues délégations italienne et belge relevant de l’ectoplasmie). Debord y participa tout à fait normalement, intervenant peu mais avec bon sens. Puis, à la fin, il annonça calmement et fermement à Chaulieu (alias Cardan, alias Castoriadis), puis à Lyotard, puis à tous, son intention de démissionner. Toutes les tentatives de Chaulieu pour le faire revenir sur sa décision, le soir même et le lendemain, restèrent vaines. Chaulieu déploya tous les trésors de séduction dont il était capable, traça des perspectives grandioses, si seulement on transformait les tares bureaucratiques et passéistes du groupe, etc., etc. Debord écoutait…sans dire un mot. Quand Chaulieu eut terminé, il se borna à dire : « Oui…, mais…, je ne me sens pas à la hauteur de la tâche » et aussi : « Ca doit être très fatigant ! [de construire l’organisation révolutionnaire] ». Et Debord est venu à la réunion suivante, au café “Le Tambour” donner officiellement sa démission, en payant sa cotisation du mois précédent et du mois en cours, et en disant en quelques mots qu’il trouvait fort bien que le groupe existât, mais que lui-même n’avait plus envie d’y participer ! Il remercia pour ce qu’il avait appris. Et il s’éclipsa.
C’était un formidable pavé dans la mare. A peine était-il parti que les attaques fusèrent. Les sarcasmes, les suspicions les plus incroyables se donnaient libre cours. Pour ma part, je déclarais que Debord me paraissait absolument irréprochable. Point final !
Mais c’est là que je devais découvrir qu’il n’est rien de pire que d’être irréprochable !
Dans les groupuscules (et Socialisme ou Barbarie était un groupuscule, bien que l’Esprit y soufflât encore, à cette époque), les démissions et les scissions sont de véritables divorces, où chaque camp a besoin de constituer l’autre en “mal absolu”. Les deux fractions scissionnistes, ou le démissionnaire et l’organisation, s’accusent mutuellement de tous les péchés du monde. A moins que le démissionnaire ne parte, la tête basse. Et dans ce cas, on lui accordera, à la rigueur, indulgence et commisération. « Un homme à la mer…, la lutte continue ! » À condition qu’il soit bien entendu que le démissionnaire s’achemine vers un destin déplorable. Sinon la rupture, donc la bouc-émissarisation de l’autre, est le processus nécessaire par lequel chacune des parties reconstitue son image de soi, en mettant tout le mal sur le dos de l’autre. L’attitude de Debord, qui n’avait pas du tout la tête basse, et ne manifestait pas non plus la moindre agressivité, frustrait le groupe de cette thérapeutique. Il partait en laissant des virus dans la programmation des révolutionnaires. Son comportement faisait surgir la question des illusions que nous entretenions peut-être sur nous-mêmes, et la question du moralisme révolutionnaire, donc la question du rapport du militant, avec le prolétariat d’une part, avec les ouvriers d’autre part. Le groupe réagit par une censure de plus en plus complète et un refoulement total. Après quelques soubresauts et la tentative de Richard Dabrowsky de susciter une “tendance situationniste” dans le groupe, totalement désavouée par Debord, tout rentra dans l’ordre. Bientôt Debord et l’Internationale Situationniste avaient cessé d’exister, d’avoir existé, et de pouvoir exister. On n’en trouve d’ailleurs aucune trace ni aucune mention dans la revue ! Clôture de la représentation.
Ce “point aveugle” et l’incapacité structurelle et congénitale de le voir, donc de l’analyser, allaient entraîner la dégénérescence de Socialisme ou Barbarie, prévue, annoncée, puis constatée par l’I.S. (n° 9 page 18) qui procédera à l’exécution finale (“Socialisme ou Planète”, I.S. n° 10 page 77) tout en devenant l’héritière de ce que Socialisme ou Barbarie avait produit de mieux. Ces événements et cette situation allaient en tout cas alimenter ma réflexion. Debord avait déclenché une gangrène qui allait emporter le groupe, en ne faisant absolument rien ! Mais les torts qu’il n’avait pas, on les lui inventait.
Tout au contraire, dès 1960, l’influence des thèses et des connaissances “sociale-barbares” plus ou moins recomposées n’avait cessé de se développer dans les publications situationnistes, comme référence du mouvement ouvrier. Cette incorporation allait constituer, à mon avis, le principal intérêt de l’I.S. et déterminer l’élargissement de son audience. Mais j’avais été profondément troublé par le comportement du groupe, en ce qu’il révélait ce “point aveugle”, cet “angle mort”, dans lequel nos facultés collectives d’analyse étaient soudain anéanties. Cela posait en germe la question de la nature du lien social qui nous réunissait, comme j’allais l’apercevoir peu à peu… Dans l’immédiat, je m’ouvrais à Debord de ma perplexité, d’autant plus que l’écho d’invraisemblables calomnies à son égard me parvenait, bien que mon attitude les décourageait, et mes relations amicales continuées avec lui me faisaient suspecter moi-même des pires intentions, alors que j’étais indiscutablement un pilier, et l’activiste de la nouvelle génération dans le groupe, et que ma fidélité était absolue. Je lui disais ma détermination à rester à Socialisme ou Barbarie parce que, contrairement à l’Internationale Situationniste, c’était le cadre qui convenait à mon activité, et que « j’avais encore beaucoup à y apprendre ». Comme nous passions notre temps à brocarder l’Université, les étudiants et les études, il m’avait répondu : « Oui…, évidemment…, à toi, on ne pourra pas reprocher de faire des études, si tu choisis Socialisme ou Barbarie comme Université ! » Ca m’avait frappé parce que quelque temps avant, Lyotard, qui était aussi prof à la Sorbonne, en constatant que j’étais toujours disponible pour tout et à n’importe quelle heure, et donc que je me fichais allégrement des cours, conférences, travaux pratiques, m’avait dit : « T’as une bourse d’étudiant à Sciences Po, mais ton université c’est S.ou B. »
Mes relations avec Debord se sont espacées. Mais elles se sont spontanément renouées, tout simplement parce que, fin 1962, je suis venu habiter rue Rollin, près de la Contrescarpe, et je le rencontrais régulièrement dans le quartier et aux “Cinq Billards”. Les années 1963-1964 ont été dominées, en ce qui me concerne, par la clarification, puis l’affrontement et la scission à l’intérieur de Socialisme ou Barbarie, entre, d’un côté, “La tendance” animée par Chaulieu-Cardan-Castoriadis, et de l’autre, Pouvoir Ouvrier, les “traditionalistes” ou “paléomarxistes”, disait Castoriadis, avec Lyotard, Brune (alias Souyri), Véga, et la majorité du groupe. De plus, ma première fille était née le 15 février 1963, et le pionnicat ne suffisant plus pour survivre, je travaillais comme employé de bureau chez un syndic d’immeubles. Je militais toujours à Pouvoir Ouvrier, qui allait suivre, à quelques années d’intervalle, le même destin que S.ou B. ; les mêmes causes produisant les mêmes effets. C’est à cette époque que nous nous sommes le plus souvent rencontrés. Les numéros 8, 9 et 10 me semblent d’ailleurs refléter et rendre compte exactement de la réalité de l’Internationale Situationniste, c’est-à-dire, pour l’essentiel, j’en demeure persuadé, de Guy Debord, et de l’évolution qui nous était commune. Le bouillonnement théorique était assez extraordinaire. Mais il ne m’est pas encore possible d’apprécier cette époque : la part de nos intuitions, de nos erreurs et de nos illusions ne pouvant elle-même se penser qu’à la lumière de Mai 1968 et de ses suites. Mais la partie n’étant pas complètement terminée, et plusieurs fins, qui ne diffèrent que par la nature et l’ampleur de la déception qu’elles nous infligeront, étant encore possibles, plusieurs critères décisifs d’appréciation restent en suspens…
En anticipant, je peux dire que la pratique de la Vieille Taupe en 1968 différa de celle des situationnistes, qui restait imprégnée d’illusions “conseillistes”, qui leur venaient précisément de Socialisme ou Barbarie et que j’avais partagées avec eux, mais que j’avais commencé à critiquer en 1967, en découvrant l’oeuvre de Bordiga et la “Gauche communiste italienne”, que je ne connaissais jusqu’alors, comme Debord, qu’à travers la présentation grossièrement falsificatrice qu’en avait donnée S.ou B. et ce qu’avaient bien voulu nous en dire Chaulieu-Cardan-Castoriadis et Véga, lui-même ancien “bordiguiste”. Non pas que la Vieille Taupe se soit ralliée aux analyses de Bordiga, loin de là, mais la connaissance réelle des analyses de la “Gauche communiste” nous avait ouvert les yeux sur certaines réalités du mouvement social, qui nous échappaient auparavant. Mustafa Khayati, le seul situationniste qui ait été partiellement témoin de l’activité de la Vieille Taupe en 1968, avait estimé que nous avions été plus réalistes et plus profonds que les situationnistes. C’est cette différence dans l’analyse et dans la pratique qui évitera à la Vieille Taupe l’opprobre d’être assimilée aux étudiants soixante-huitards et post-soixante-huitards, assimilation qui, pour l’I.S. elle-même, n’est que partiellement injustifiée. Il ne faudrait d’ailleurs pas s’exagérer notre lucidité, qui fut grande à maints égards, mais en 1972, quand j’ai décidé de fermer la première librairie “La Vieille Taupe”, j’étais encore persuadé que notre propre dépassement annonçait un réveil prolétarien à bref délai, comme en témoigne l’affiche « Bail à céder pour cause de transfert urbi et orbi », par laquelle j’avais mis fin à l’existence de la librairie.
En tout cas, lorsque j’échafaudais le projet de créer une librairie, fin 1964 - début 1965, alors que j’étais déjà submergé de problèmes et évidemment sans un sou, Debord avait été a peu près le seul à approuver, à comprendre et à soutenir mon projet. C’est ensemble que nous avons décidé du nom “La Vieille Taupe”, sur ma proposition, et décidé du choix des livres. Nous avons discuté certains “détails” de présentation et décidé de ne vendre ni Sartre, ni Althusser, ni Sicone du Bavoir, sinon comme “documents”, dans une poubelle. C’est encore avec Debord que nous avons décidé de l’édition en affiche des Thèses sur Feuerbach.. Ce sont d’ailleurs les situationnistes qui ont assuré l’essentiel du collage, lors de l’ouverture de la librairie. Ils étaient évidemment présents à l’inauguration, et rencontrèrent les membres de Pouvoir Ouvrier, qui venait de se séparer de Socialisme ou Barbarie. Une critique commune de ce qu’était devenu Socialisme ou Barbarie nous rapprochait. Véga avait salué Debord en lui demandant avec un grand sourire : « Je ne parviens pas à me souvenir si nous sommes fâchés ou non, … ou si nous devrions l’être. » Debord avait fait une réponse également pleine de finesse en lui serrant la main, et il s’étaient attablés ensemble dans l’arrière-boutique. Mais je n’ai pas souvenir que Véga soit jamais repassé à la librairie, et il n’allait pas tarder à me chercher des poux dans la tête, ce qui allait déclencher l’implosion définitive du groupe Pouvoir Ouvrier.
Lorsque ma vitrine a été étrennée par un premier cocktail Molotov, c’est encore avec Debord et Michèle Bernstein que nous avons défini l’attitude à adopter, loin de toute pleurnicherie démocratique et par un maximum de publicité pour les livres qui déplaisaient le plus aux staliniens, nos probables agresseurs. Le commissaire de police du quartier m’avait convoqué : – « Vous cherchez les ennuis ! » J’ai eu le plus grand mal à le convaincre que montrer que nos agresseurs ne nous intimidaient pas constituait le meilleur moyen de les dissuader de recommencer. Cette symbiose totale entre Debord et La Vieille Taupe dura plus d’un an, à cheval sur 1965 - 1966. Je voyais aussi Alice Becker-Ho et René Viénet, bien que leurs contributions situationnistes ne me parussent guère identifiables à l’époque. Viénet surtout me paraissait accorder une vertu en soi à la “qualité” de situationniste, ce qui me semblait aller à l’encontre des idées dont nous avions discuté avec Debord, et introduisait dans les rapports une dimension “m’as-tu vu” tout à fait regrettable. Toujours est-il que cette symbiose s’est matérialisée dans le n° 10 de la revue, celui-là même qui contenait la critique définitive de Socialisme ou Barbarie, par l’annonce :
On peut trouver ou commander les publications de l’I.S. à la librairie “LA VIEILLE TAUPE” 1, rue des Fossés Jacques, Paris 5, ODEon 39-46.
La suppression du mot “Saint” dans l’adresse, sur tous les documents émanant de La Vieille Taupe, était une idée de Debord qui m’avait fait remarquer l’inscription gravée dans la pierre à l’angle de la rue. Le mot avait été cassé à coups de marteau pendant la Révolution française. J’en étais tombé d’accord, en évoquant moi-même Lénine qui déambulait dans Paris en discutant, et présentait à son interlocuteur en pénétrant sur l’île de la Cité : « Leur-Dame de Paris » (raconté par Trotsky, dans Ma Vie, je crois1).
Il s’agissait là d’un “détail”, apparemment insignifiant, mais qui exprime assez bien l’exigence éthique dont Debord était porteur : mettre la théorie en pratique, et la pratique en théorie, jusque dans les détails, et sans compromis.
J’ai maintenant renoncé à cette graphie. Délibérément. Je pense aujourd’hui qu’une “révolution” n’est profonde, durable, et populaire, que si elle s’inscrit dans une tradition. Et la Révolution française a été une révolution bourgeoise. Et il y avait plus de communisme sous l’Ancien Régime que sous Robespierre. Le règne de l’idéologie exprime une aliénation plus profonde et plus meurtrière que la religion. La “révolution” qui reste à faire n’a pas de précédent. Les traditions issues des révolutions bourgeoises et bolcheviques ne véhiculent que les techniques de dévoiement de l’énergie prolétarienne.
Mais si cette symbiose existait quant à l’orientation et à la perspective, j’avais seul la responsabilité et la charge matérielle de la librairie, qui était écrasante. La simple tenue de la librairie était un problème qui m’imposait une vie dévorée de soucis et aux antipodes des principes quelque peu “hédonistes” des situationnistes. J’étais d’ailleurs le seul à avoir un enfant, et je ne sache pas qu’aucun situationniste ait jamais eu d’enfant. Debord possédait le talent de se tenir à l’écart des embarras de toute nature, et d’observer avec ironie. Je l’enviais pour ce talent. Mais je n’admettais pas qu’on l’érige en norme et en critère, ce que Debord ne faisait pas, mais que faisaient, me semblait-il, certains situationnistes. Un jour, à l’angle de la rue Clotaire, alors que je poussais, fort débonnaire, le landau de ma fille, il m’avait dit : « Voilà une photo pour le prochain numéro de la revue, à coté du boucher du Jutland et du vampire de Dusseldorf. Avec comme légende : Le Satyre de l’Estrapade ! »
Mon accord avec Debord sur les sujets que nous abordions était total, mais je ressentais avec les situationnistes une différence que j’étais incapable d’expliciter. Debord faisait preuve dans son appréciation des gens, d’une perspicacité extraordinaire. Il savait tirer d’un détail infime des implications qui lui permettaient d’assigner aux uns et aux autres leur destin inéluctable. Pourtant je lui avais soutenu que mes critères étaient plus sensibles ! A ceci près que je n’érigeais pas mes critères en norme. Je considérais que les gens sont comme ils sont, et qu’il fallait faire avec. Je lui avais donné plusieurs exemples de cas où je n’avais pas placé en tel ou tel les mêmes espoirs que lui. Les frères George avaient été les exemples les plus manifestes. Dès ma deuxième rencontre avec eux, aux “Cinq Billards”, quand il me les avait présentés, je lui avais dit ce que j’en pensais : « grands bourgeois intellectuels fin de race qui jettent leur gourme et cherchent à se reconvertir dans une idéologie prometteuse. On verrait bien… » L’article qu’il leur avait consacré (“Sur deux livres et leurs auteurs”, I.S. n° 10, page 70-71) de même que l’article immédiatement précédent (“L’idéologie du dialogue”) reflètent des conversations que nous avions eues. Je lui avais donné d’autres exemples dans le passé où j’avais été plus perspicace que lui (Kotànyi, Jorn), et des exemples dans le présent, de gens qui tournaient autour de l’I S. avec sa bienveillance, et auxquels, pour ma part, je n’accordais que le bénéfice du principe pas de condamnation sans loi préalable (Frey, Garnault, et alii…).
J’ai tu par contre une interrogation qui me taraudait l’esprit, parce qu’elle n’était pas encore suffisamment élaborée, concernant les membres mêmes de l’I.S., en dehors de Debord. Ils me paraissaient porter un costume trop grand pour eux, taillé aux seules mesures de Debord. Michèle Bernstein, par exemple, que je trouvais charmante, pleine de finesse et d’intuition, beaucoup plus cultivée que moi, ne me paraissait nullement être “révolutionnaire” comme je l’entendais. De même pour Alice, et d’une manière différente pour Viénet. Ils me semblaient surtout prendre plaisir à s’affirmer. Et ils le faisaient avec un certain talent. Mais je ne parvenais pas à me persuader que leur engagement perdurerait si cette activité cessait d’être gratifiante. Et la personnalité de Debord ne me paraissait pas étrangère à cette situation. Ni l’éthique situationniste. Mais je n’avais alors aucun moyen d’élaborer et de formuler mes critiques qui relevaient tout au plus de l’intuition. D’autant plus que dans leurs propres critiques à mon égard, les situationnistes, et Viénet, étaient loin d’avoir tort, selon nos propres critères de l’époque.
Parallèlement à ces interrogations, je me débattais dans des soucis financiers et familiaux inextricables. Je ne les évoque que parce qu’ils constituent le contexte de mes relations avec Debord et les situationnistes pendant la courte période de temps où ces relations se sont dégradées, puis terminées. Car nos relations ont cessé, sans que jamais n’apparaisse entre nous le moindre désaccord théorique, politique, ou existentiel, sur lequel Debord ou aucun situationniste se soit jamais exprimé. Ma dernière rencontre avec Guy Debord et René Viénet s’est déroulée, en présence d’Anne Vanderlove, à la librairie, à 10 heures du soir, dans des conditions pirandelliennes provoquées par un hâbleur mythomane, escroc, menteur et kleptomane, et sans aucun rapport avec les activités et les préoccupations qui nous avaient auparavant réunis.
Sans prétendre me livrer à la reconstitution totale de la situation, et décrire l’intervention des différents personnages dans ce court intervalle de temps, et sans être convaincu, si la chose s’avérait possible, qu’elle conduise à des conclusions univoques, la situation, quelques mois après l’ouverture de la librairie, en ce qui me concerne, se présentait ainsi. Je n’avais plus un sou de l’argent que j’avais emprunté, grâce à l’hypothèque en deuxième rang de l’appartement de mes parents ! J’avais cru trouver un répit en passant un accord avec un “libraire” de la rue Gay-Lussac, qui disposait d’un énorme stock de livres anciens, et devait quitter son local. Il me proposait d’héberger son stock dans mon arrière-boutique et dans ma cave. Cet accord allait à l’encontre des projets de Viénet, et moi-même j’étais loin d’en mesurer les inconvénients. Le “libraire” s’avéra vite incapable de faire quoi que ce soit et enfin, il se révéla être un mythomane et un escroc. Le stock ne lui appartenait tout simplement pas. Le véritable propriétaire, un vrai libraire celui-là, avec lequel je devais finalement travailler, était venu se faire connaître par l’intermédiaire d’un huissier ! Et pour clore le tout, le “libraire”, en imitant ma signature et en rajoutant avec ma propre machine à écrire des phrases sur une lettre que j’avais effectivement écrite et signée, avait monté un dossier tendant à établir que nous étions associés et qu’il était copropriétaire du bail de La Vieille Taupe ! Toutes choses qui ne me permettaient pas de jouir, dans mes discussions avec Viénet et les situationnistes, d’une parfaite sérénité. Le véritable propriétaire des livres se trouvait être un certain Roujitch, sixième adhérent du parti communiste yougoslave, dans les années 20, donc vingt ans avant Tito. Il avait été pendant la guerre agent clandestin de la Troisième internationale, et chargé à ce titre de missions ultra-secrètes envers les dirigeants clandestins du Parti communiste français. Il avait été l’œil de Moscou, et de ce fait détenteur de secrets qui l’avaient contraint à vivre dans la clandestinité par rapport au parti et aux services soviétiques plusieurs années après la guerre. Et il restait très prudent. Son silence sur certains épisodes de la “résistance” du parti était la garantie de sa tranquillité. Il était complètement revenu de tout, et aimait à lire les éditoriaux de Raymond Aron dans Le Figaro… En Mai 68, il avait observé en rigolant « la première révolution prolétarienne faite par les fils de bourgeois »… Et je passe sur d’autres éléments du contexte de mes relations avec Debord, puisqu’il faudrait faire aussi intervenir la personnalité d’un autre personnage haut en couleur, hâbleur, mythomane et voleur, le sculpteur Carloti, dont je n’ai appris que plus tard par le véritable titulaire, qu’il s’agissait d’une identité usurpée ! Sans compter une classique situation vaudevillesque, et quelques personnages de moindre importance.
Au début de 1966, s’est tenue à Paris, dans un café de la rue Quincampoix, une conférence de l’Internationale Situationniste (I.S. n° 10). La nature de nos relations était telle que j’y avais été formellement invité. Ce qui signifiait non pas adhérer, terme dénué de sens en ce qui concerne l’I.S., mais faire partie de l’Internationale Situationniste. Viénet était venu me l’annoncer et Alice était passée en coup de vent me rappeler « qu’on se voyait ce soir », d’une manière qui m’avait fait penser qu’elle voulait s’assurer que Viénet avait bien fait la commission. J’en déduisais que l’invitation avait été discutée, que Viénet y avait fait des objections, puis que la décision avait été prise collectivement. Mais j’avais déjà décliné l’invitation auprès de Viénet. Je pense d’ailleurs que si Alice était passée la première, ou Debord, j’aurais accepté. Je n’ai jamais regretté cette décision, mais je me suis toujours interrogé sur le futur désormais antérieur qu’une décision différente aurait comporté. L’invitation impliquait probablement (mais seul un situationniste pourrait le confirmer) que Debord les avait convaincus de s’impliquer davantage dans la librairie. Ce qui comblait mes vœux. Mais Viénet me l’avait transmise comme on annonce à un candidat qu’il n’a pas obtenu la moyenne mais bénéficie de l’indulgence du jury.
J’avais quelque temps auparavant déclaré à Debord que, même idéalement réalisé, et j’en était loin, mon projet n’était pas de faire une “librairie révolutionnaire”, ni, à plus forte raison, une “librairie situationniste”. Je lui avais fait remarquer, en retournant les décisions que l’I.S. avait appliquées aux productions artistiques de ses membres (I.S. n° 7 page 27) que, même dans le cas où je réussirais à en faire ce que je voulais, la librairie (ma production artistique, qui était déjà le principal point de diffusion de l’I.S.) devrait être déclarée “anti-situationniste”. Mais plusieurs situationnistes s’étaient montrés perplexes, et Debord avait dû expliquer le sens “hégélien” du propos : la matérialisation de l’idée en est aussi l’aliénation. Elle aspire à être dépassée. Cela eût été d’ailleurs un excellent moyen d’avoir à expliquer au public la nature de notre anti-situationnisme ! et aurait placé les adversaires de l’I.S. dans un pataquès linguistique plutôt réjouissant.
Pour ma part, j’avais besoin d’aide, de compréhension. Je n’admettais pas qu’on ne le comprît point et je n’admettais pas l’éthique qui exigeait que l’on fût fort et vainqueur. Mais je me suis sorti tout seul de mes problèmes. De plus, je percevais dans leur adhésion à la “révolution” une exigence éthique, et même esthétique, plus qu’une nécessité. Ce qui ne débouchait pas sur une réelle liaison organique avec la classe ouvrière. Mais mes idées, à l’époque, n’étaient elles-mêmes probablement pas exemptes d’une certaine métaphysique “ouvriériste”…
Mes relations avec les situationnistes et avec Debord se sont poursuivies plusieurs mois après cette fameuse conférence, rue Quincampoix. La librairie diffusait les publications situationnistes. Le fait en lui-même d’avoir décliné l’invitation des situationnistes ne pouvait en aucun cas être porté à mon débit, puisqu’il témoignait en tout cas de mon autonomie. Mais j’ai eu l’impression de faire l’objet d’une mise en observation suspicieuse, en attendant de voir comment je me dépatouillerais de ce qu’ils connaissaient de mes problèmes. C’est pendant cette période qu’intervint l’enchaînement nécessaire des hasards et que se dénoua la situation, d’une manière apparemment absurde, mais qui m’a toujours paru la manifestation d’une nécessité. Fin mai ou début juin 1966 Viénet vint retirer de La Vieille Taupe, sans aucun commentaire de ma part ni du sien, le stock des publications situationnistes, bien entamé par la diffusion que j’avais effectuée, et sans me réclamer le montant des ventes. Ce stock a été mis en dépôt à la Librairie du Savoir – 5, rue Malebranche, Paris 5. – chez un libraire qui était plus un coursier qu’un libraire, et faisait du “discount”, à moins de cinquante mètres de La Vieille Taupe. Ce qui était évidemment une manière de me narguer. Aujourd’hui cette librairie existe toujours. Elle est devenue la librairie roumaine de Paris, après avoir été, bien avant la chute de Ceaucescu, la librairie des dissidents roumains. A ce titre, elle est dépositaire d’une riche expérience de lutte contre la censure et le totalitarisme
Par la suite, j’ai toujours éconduit toutes les tentatives hostiles à l’I.S., qui furent nombreuses, parce que je n’en ai jamais rencontrées qui fussent fondées. Et j’ai continué à dire tout le bien que je pensais de l’Internationale Situationniste et de ses publications, et que j’en pense toujours, nonobstant la rupture des relations entre l’I.S. et la Vieille Taupe, et nonobstant les critiques plus générales qui portent sur la compréhension de la période historique, et constitueraient, pour moi aussi, des autocritiques.
C’est donc dans le n° 11, paru en octobre 1967 que figure la brève :
MISÈRES DE LA LIBRAIRIE
Nous avons cru devoir retirer nos publications de la librairie “La Vieille Taupe”. Son propriétaire avait trop de prétentions révolutionnaires pour être considéré comme un libraire neutre vis-à-vis des écrits qu’il affiche ; et trop peu de rigueur dans son activité pour être considéré comme un libraire révolutionnaire (souffrant la présence prolongée et les discours d’imbéciles, et même de pro-chinois).
… que j’ai immédiatement affichée sur la porte et à l’intérieur de la librairie.
J’observe que, si on a « cru devoir », c’est qu’on n’est pas tout à fait certain d’avoir bien fait ; et que la brève suivante commence par les mots : « Chose plus sérieuse ». J’observe ensuite que cette brève ne contient rigoureusement rien que je n’ai dit moi-même, à un moment ou à un autre, à Debord. J’ajoute qu’aucun libraire, en aucune circonstance, même sans les soucis qui m’assaillaient et la lassitude psychologique qu’ils induisaient, n’aurait pu éviter la présence épisodique d’imbéciles. Quant au prétendu pro-chinois qui se trouvait présent lors d’un passage de Viénet, il s’agissait d’Americo…, qui débarquait du Mozambique et découvrait la librairie. Il cessa si bien d’être prochinois qu’il devint un ami, avant de devenir un universitaire alimentaire, ce qui montre une fois de plus que, comme le disait Trotsky, la révolution est une grande dévoreuse d’hommes et de caractères. J’observe enfin que dans la liste des personnes et des organismes ou institutions injuriés dans l’I.S. publiée plus tard par Raspaud2 aux éditions Champ Libre, ne figurent ni La Vieille Taupe, ni Pierre Guillaume. A ma connaissance, il n’existe aucun texte où Debord, ou un situationniste, aient jamais critiqué la Vieille Taupe, ni avant, ni pendant, ni après Mai 68. Quant aux circonstances qui provoquèrent la cessation de mes relations avec Debord, je ne sache pas que lui-même, ni aucun situationniste, se soient jamais exprimés publiquement là-dessus. Je n’en dirai donc rien de plus que ce que j’en viens de dire. L’Internationale Situationniste n’existe plus. Je pense être l’une des rares personnes à avoir été invité formellement à faire partie de l’Internationale Situationniste et à avoir décliné l’invitation.
Pour être absolument complet, en 1970 ou 1971, Gérard Lebovici s’est présenté à la librairie La Vieille Taupe, 1, rue des Fossés Jacques, accompagné de Gérard Guéguan. Celui-ci voulait convaincre celui-là de créer, c’est-à-dire de financer, une maison d’édition sur une ligne éditoriale nouvelle. Je ne sais pas ce que Guéguan lui avait dit. Mais Lebovici voulait me rencontrer, évaluer avec moi la faisabilité de la chose et la réalité de l’existence d’un marché pour le type de publications qu’il envisageait. Il passa près d’une heure à la librairie, et c’est, semble-t-il, notre conversation qui le décida à passer à l’acte et à réaliser les Éditions Champ Libre. A quelque temps de là, je décidai de fermer La Vieille Taupe (1972) et j’envisageai de publier un livre aux Éditions Champ Libre sur l’histoire de la librairie et du groupe qui y avait fonctionné. Puis la rumeur m’apprenait que Debord entretenait des relations avec Champ Libre. Ce sont ces circonstances qui m’ont conduit à lui écrire une courte lettre, qui est restée sans réponse, suggérant de nous rencontrer.
Lorsque j’ai décidé de lancer une souscription auprès des amis de la Vieille Taupe pour la publication de la présente revue, en citant la date de la note de l’éditeur en postface au Mémoire en défense contre ceux qui m’accusent de falsifier l’histoire, le 27 octobre 1980, j’ai noté, dans ma circulaire : « (vingt ans jour pour jour après ma rencontre avec Guy Debord) ». Cette mention n’était venue sous ma plume que parce que, pour la première fois depuis près de trente ans, j’envisageais précisément « de faire sortir le loup du bois » en écrivant dans le premier numéro de La Vieille Taupe une critique de son dernier livre, Cette mauvaise réputation… Trois jours après, j’apprenais qu’il s’était suicidé. Je n’ai rien lu de ce qu’en ont écrit les médiats3, sauf un article découpé dans Le Figaro qui m’a été envoyé par une amie : le témoignage de son ami Ricardo Paseyro qui m’a paru honnête et bien intentionné. Il confirmait ce que j’avais pensé :
Prévu de longue main, son suicide ne recèle nul secret : Debord refusa à la maladie le droit de lui ravir son indépendance. Il n’était pas un homme “mystérieux” : il était un être rare, impossible à dompter, contraindre ou manipuler. Il n’aliénait sa liberté à personne – ni à la vie, qu’il aimait, ni à la mort, qu’il domina.
Je n’avais pas imaginé qu’il puisse s’agir d’un suicide de désespoir. Mais un suicide stoïcien, dès lors que sa santé s’était délabrée, me paraissait dans la logique de la vie telle qu’il entendait la conduire.
Je me suis remémoré nos rencontres, à la Contrescarpe. Et la manière inimitable et peut-être caractéristique, qu’il avait de quitter la table quand l’intérêt de la conversation déclinait, ou plutôt…, menaçait de décliner. Il saluait soudain la compagnie. Payait généralement toutes les consommations, et s’éclipsait brusquement. Et c’étaient tous les convives qui se sentaient congédiés. Au banquet de la vie infortunés convives !
Le marxisme ne connaît ni “immortels” ni morts. Avec ceux que l’art oratoire vulgaire désigne ainsi, la vie dialogue.4
La violence des passions qu’a suscitées Debord, et la hargne des écrits vains qui s’en sont pris à lui, m’ont toujours stupéfait. Pour ma part, de toutes les polémiques auxquelles j’ai assisté, et de toutes celles dont les échos me soient parvenus, je ne connais pas d’exemple où Debord n’ait pas eu entièrement raison ! Je suis donc porté à le croire dans tous les cas où je ne dispose pas par moi-même des éléments d’information suffisants, sous réserve, évidemment, de vérification.
Le silence de Debord et de l’I. S. à mon égard, comme à l’égard de la Vieille Taupe, me confirmait à la fois que l’I. S. ne s’en prenais pas à quelqu’un sans raison pour se cacher à elle-même ses propres problèmes, et que l’I. S. n’avait pas de raison de s’en prendre à moi. Je n’ai d’ailleurs jamais craint les reproches de l’I. S. ou de Debord. Justifiés, j’en aurais tenu compte. Injustifiés, ils auraient révélé où se trouvait l’angle mort de Debord, son point aveugle. La clôture de sa représentation. Ce qui aurait contribué au dépassement, par soi-même ou par d’autres.
Je ne méconnaissais pas le risque, évidemment majeur et humainement probable, qu’une attaque justifiée à mon égard, ne soit considérée par moi comme injustifiée. Et que mes réactions ne me conduisent de ce fait à rejoindre la foule de mes prédécesseurs sur la voie inexorable des poubelles de l’histoire. Mais l’interrogation est devenue académique. L’Internationale Situationniste est dissoute. Debord est mort. Je ne vois pas d’où pourrait provenir une voix autorisée. Et il n’existe aucune critique publique de Debord à l’égard de la Vieille Taupe… !
Jusqu’en 1979, ce silence, les ennemis de la Vieille Taupe pourraient être tentés de se l’expliquer comme étant l’effet d’une mansuétude à l’égard d’une quantité négligeable, compte tenu du rapport des forces respectives à partir de septembre 1967. Ou même comme une manifestation d’indifférence, sinon de mépris. C’est tout à fait possible. Il est vrai que la Vieille Taupe ne faisait d’ombre à personne. Mais le silence de Debord depuis 1979 (éclatement public de l’affaire Faurisson), c’est-à-dire pendant seize ans, est beaucoup plus difficilement explicable. Je ne me le suis d’ailleurs pas expliqué. Et je n’en ai découvert l’explication nulle part.
Car le silence improbable de Debord ne porte pas seulement sur la Vieille Taupe, mais également sur toute l’affaire dont la présence négative a dominé les médiats et l’ensemble de la société de toute la fin de ce siècle. Il porte enfin sur l’événement dont on nous dit qu’il a dominé l’histoire de ce siècle : Auschwitz et les chambres à gaz, au point d’être l’événement fondateur de la société “post-moderne” dans laquelle nous vivons. L’explication de ce silence ne peut résulter d’une impossible ignorance. Plus précisément Debord avait dans son entourage immédiat plusieurs révisionnistes plus ou moins conséquents. Au surplus, quand l’affaire Faurisson a éclaté, indépendamment de la Vieille Taupe, dans les médiats, excipant de notre ancienne rencontre à l’origine des éditions Champ Libre, je suis allé rencontrer Lebovici dans son immense bureau de la rue Marbeuf, pour lui proposer de rééditer Le Mensonge d’Ulysse du déporté résistant antifasciste Paul Rassinier. Il connaissait l’ouvrage qu’il croyait controuvé et dépassé mais il ne l’avait pas lu, et il avait ajouté foi à certaines calomnies qui avaient couru sur Rassinier. Mais il avait été sensible à mes explications. J’espérais à l’époque, par cette publication chez Champ Libre, introduire un peu de réflexion et de sagesse dans un débat devenu inéluctable. Lors de notre entretien, était assis à côté de son luxueux bureau, un personnage à cheveux blancs, devant lequel il m’avait invité à parler sans crainte, et que je n’ai identifié que beaucoup plus tard, en voyant apparaître son image dans un quelconque médiat. Il s’agissait de Jorge Semprun, qui n’a pas dit un mot pendant toute notre conversation. J’ai laissé à Lebovici une copie du Mensonge d’Ulysse et quelques documents, qu’il a lus. J’ai appris plus tard que le grand bourgeois stalinien espagnol avait utilisé tous les moyens en son pouvoir et d’abord le mensonge, pour dissuader Lebovici de réaliser cette édition qu’il avait effectivement envisagée. Trois ans plus tard, sortait chez Grasset, de Jorge Semprun, Quel beau dimanche ! dans lequel le grand bourgeois stalinien révélait pour le grand public, ad usum Delphini, en l’édulcorant, en minimisant, et en falsifiant l’interprétation, ce qu’avait révélé Rassinier sur la vie interne des camps et le rôle des staliniens, et qui ne pourrait plus longtemps rester complètement ignoré. Ce livre a donné lieu à une lettre de la Vieille Taupe à je ne sais plus quel journal littéraire dirigé par Maurice Nadeau, qui avait rendu compte du livre. Cette lettre, enfouie dans les archives de la Vieille Taupe, nul doute que la vieille taupe ne finisse par remettre la main dessus, lorsque les temps seront venus. Entre temps, Lebovici m’avait fait savoir qu’il ne lui était pas possible d’envisager la publication du Mensonge d’Ulysse aux éditions Champ Libre. Je l’ai donc réédité moi-même, en recréant La Vieille Taupe, sous la forme d’une maison d’édition, dans des conditions bien pires que celles qui avaient présidé à la création de la première librairie. Edité dans de telles conditions, Le Mensonge d’Ulysse ne risquait plus d’atteindre le grand public, mais son ersatz médiatique était lancé, et la carrière littéraire de déporté spectaculaire-marchand de l’ex-stalinien commençait.
Jusqu’en 1985, je n’ai pas exclu l’idée que Debord puisse attendre son heure. De toutes les personnes d’avec lesquelles la vie m’a séparé, Debord est absolument la seule dont il me soit parfois arrivé de regretter l’avis et les conseils, même et surtout lorsque je pouvais les craindre hostiles. C’est ainsi. Je n’ai jamais douté qu’il était valablement informé, ni supposé qu’il puisse être devenu incapable de décrypter dialectiquement les “informations” médiatiques concernant cette affaire. Je me suis donc abstenu de toute initiative visant à lui faire parvenir plus directement une information véridique, ou à solliciter une intervention.
Lorsque sont parus les Commentaires sur la société du spectacle, aux éditions Gérard Lebovici, je n’ai pas douté une seule seconde que les temps étaient venus… et que Debord avait exactement l’intelligence de la situation, y compris de la nécessité de dissimuler provisoirement sa pensée, ce qu’il indiquait d’ailleurs explicitement au début du texte. C’est donc tout naturellement que j’ai publié des extraits bien choisis de ce texte dans le numéro 5 des Annales d’histoire révisionniste, numéro particulièrement dense et explicitement implicite. Je ne doutais pas un instant que ces Commentaires dussent être suivis, dans l’esprit même de Debord, d’une élucidation progressive, hors de laquelle le texte resterait dénué de son sens. La publication de ces extraits-là dans ce numéro-là des Annales me semblait contribuer à cette élucidation en direction de ceux qui étaient le plus susceptibles de la comprendre et je ne doutais pas que Debord lui-même ne livre un jour prochain, les clefs du royaume. Cette publication me semblait appeler dans tous les cas, soit une approbation, qui pouvait être raisonnablement progressive et pouvait s’accommoder provisoirement d’un silence complice, soit un démenti brutal… qui n’est pas venu !
Non plus qu’aucun autre commentaire.
Mais de toute façon, le contenu en lui-même des extraits publiés par mes soins ne me paraît toujours pas pouvoir s’expliquer en dehors de l’hypothèse d’une référence implicite à l’affaire. Mieux. Le monde totalitaire qui est décrit dans ces extraits, en dehors de l’exemplification concrète par les linéaments de l’affaire vécue du côté des révisionnistes, relèverait d’une exagération paranoïaque. Tout au contraire. Il n’est pas une des propositions les plus extrêmes de Debord qui ne puissent être illustrées tout à fait concrètement par les révisionnistes, et uniquement par des révisionnistes, à partir du sort qui leur est fait. Et il n’est guère de ces propositions qui, en dehors du sort effectivement réservé au révisionnisme, n’apparaisse exagérée ou trop systématique.
Il ne m’est pourtant parvenu, de la part de Debord, aucune confirmation de cette hypothèse, sinon un silence de plus en plus assourdissant au fur et à mesure que passait le temps. Silence que même l’additif antirévisionniste à la loi sur la presse, dit loi Fabius-Gayssot, publié au J.O. du 14 juillet 1990 et promulgué par Rocard, n’a pas interrompu.
Tout au contraire, au lieu du signe de la confirmation de cette hypothèse que j’attendais, me sont parvenus bien plus tard, par l’intermédiaire de révisionnistes qui gravitaient dans l’entourage immédiat de Debord, les échos d’une indiscutable hostilité à mon égard, sans qu’aucun motif ne m’ait été rapporté, en dehors de l’expression catégorique de cette hostilité.
Dans ces circonstances, je ne peux que me perdre en conjectures sur l’interprétation qui doit être faite des passages des Commentaires sur la société du spectacle que j’avais publiés dans ce fameux n° 5 des Annales d’histoire révisionniste (le petit livre rouge), et que je republie ici pour permettre au lecteur d’en juger. Ces passages figuraient dans la rubrique : “Chroniques du temps présent”, sous le titre : “Extraits choisis”. Nous invitons le lecteur, afin de pouvoir juger du contexte, à se reporter au petit livre rouge lui-même, dans lequel rien n’avait été laissé au hasard.
Guy Debord (extraits choisis). Commentaires sur la société du spectacle, Editions Gérard Lebovici, Paris 1988
Le seul fait d’être désormais sans réplique a donné au faux une qualité toute nouvelle. C’est du même coup le vrai qui a cessé d’exister presque partout, ou dans le meilleur des cas s’est vu réduit à l’état d’une hypothèse qui ne peut jamais être démontrée. Le faux sans réplique a achevé de faire disparaître l’opinion publique, qui d’abord s’était trouvée incapable de se faire entendre ; puis, très vite par la suite, de seulement se former. Cela entraîne évidement d’importantes conséquences dans la politique, les sciences appliquées, la justice, la connaissance artistique.
(p. 22)
La première intention de la domination spectaculaire était de faire disparaître la connaissance historique en général ; et d’abord presque toutes les informations et tous les commentaires raisonnables sur le plus récent passé. Une si flagrante évidence n’a pas besoin d’être expliquée. Le spectacle organise avec maîtrise l’ignorance de ce qui advient et, tout de suite après, l’oubli de ce qui a pu quand même en être connu. Le plus important est le plus caché.
(p. 23)
Un pouvoir absolu supprime d’autant plus radicalement l’histoire qu’il a pour ce faire des intérêts ou des obligations plus impérieux, et surtout selon qu’il a trouvé de plus ou moins grandes facilités pratiques d’exécution. Ts’in Che Hoang Ti a fait brûler les livres, mais il n’a pas réussi à les faire disparaître tous. Staline avait poussé plus loin la réalisation d’un tel projet dans notre siècle mais, malgré les complicités de toutes sortes qu’il a pu trouver hors des frontières de son empire, il restait une vaste zone du monde inaccessible à sa police, où l’on riait de ses impostures. Le spectaculaire intégré a fait mieux, avec de très nouveaux procédés, et en opérant cette fois mondialement. L’ineptie qui se fait respecter partout, il n’est plus permis d’en rire ; en tout cas il est devenu impossible de faire savoir qu’on en rit.
Le domaine de l’histoire était le mémorable, la totalité des événements dont les conséquences se manifesteraient longtemps. C’était inséparablement la connaissance qui devrait durer, et aiderait à comprendre, au moins partiellement, ce qu’il adviendrait de nouveau : “une acquisition pour toujours”, dit Thucydide. Par là l’histoire était la mesure d’une nouveauté véritable ; et qui vend la nouveauté a tout intérêt à faire disparaître le moyen de la mesurer. Quand l’important se fait socialement reconnaître comme ce qui est instantané, et va l’être encore l’instant d’après, autre et même, et que remplacera toujours une autre importance instantanée, on peut aussi bien dire que le moyen employé garantit une sorte d’éternité de cette non-importance, qui parle si haut.
Le précieux avantage que le spectacle a retiré de cette mise hors-la-loi de l’histoire, d’avoir déjà condamné toute l’histoire récente à passer à la clandestinité, et d’avoir réussi à faire oublier très généralement l’esprit historique dans la société, c’est d’abord de couvrir sa propre histoire : le mouvement même de sa récente conquête du monde. Son pouvoir apparaît déjà familier, comme s’il avait depuis toujours été là. Tous les usurpateurs ont voulu faire oublier qu’ils viennent d’arriver.
Avec la destruction de l’histoire, c’est l’événement contemporain lui-même qui s’éloigne aussitôt dans une distance fabuleuse, parmi ses récits invérifiables, ses statistiques incontrôlables, ses explications invraisemblables et ses raisonnements intenables. A toutes les sottises qui sont avancées spectaculairement, il n’y a jamais que des médiatiques qui pourraient répondre, par quelques respectueuses rectifications ou remontrances, et encore en sont-ils avares car, outre leur extrême ignorance, leur solidarité, de métier et de coeur, avec l’autorité générale du spectacle, et avec la société qu’il exprime, leur fait un devoir, et aussi un plaisir, de ne jamais s’écarter de cette autorité, dont la majesté ne doit jamais être lésée. Il ne faut pas oublier que tout médiatique, et par salaire et par autres récompenses ou soultes, a toujours un maître, parfois plusieurs ; et que tout médiatique se sait remplaçable.
Tous les experts sont médiatiques-étatiques, et ne sont reconnus experts que par là. Tout expert sert son maître, car chacune des anciennes possibilités d’indépendance a été à peu près réduite à rien par les conditions d’organisation de la société présente. L’expert qui sert le mieux, c’est, bien sûr, l’expert qui ment. Ceux qui ont besoin de l’expert, ce sont, pour des motifs différents, le falsificateur et l’ignorant. Là où l’individu n’y reconnaît plus rien par lui-même, il sera formellement rassuré par l’expert. Il était auparavant normal qu’il y ait des experts de l’art des Etrusques ; et ils étaient toujours compétents, car l’art étrusque n’est pas sur le marché. Mais, par exemple, une époque qui trouve rentable de falsifier chimiquement nombre de vins célèbres ne pourra les vendre que si elle a formé des experts en vins qui entraîneront les caves à aimer leurs nouveaux parfums, plus reconnaissables.
(p. 24 à 26)
Un aspect de la disparition de toute connaissance historique objective se manifeste à propos de n’importe quelle réputation personnelle, qui est devenue malléable et rectifiable à volonté par ceux qui contrôlent toute l’information, celle que l’on recueille et aussi celle, bien différente, que l’on diffuse ; ils ont donc toute licence pour falsifier. Car une évidence historique dont on ne veut rien savoir dans le spectacle n’est plus une évidence. Là où personne n’a plus que la renommée qui lui a été attribuée comme une faveur par la bienveillance d’une Cour spectaculaire, la disgrâce peut suivre instantanément. Une notoriété anti-spectaculaire est devenue quelque chose d’extrêmement rare. Je suis moi-même l’un des derniers vivants a en posséder une ; à n’en avoir jamais eu d’autre. Mais c’est aussi devenu extraordinairement suspect. La société s’est officiellement proclamée spectaculaire. Être connu en dehors des relations spectaculaires, cela équivaut déjà à être connu comme ennemi de la société.
Il est permis de changer du tout au tout le passé de quelqu’un, de le modifier radicalement, de le recréer dans le style des procès de Moscou ; et sans qu’il soit même nécessaire de recourir aux lourdeurs d’un procès. On peut tuer à moindres frais. Les faux témoins, peut-être maladroits – mais quelle capacité de sentir cette maladresse pourrait-elle rester aux spectateurs qui seront témoins des exploits de ces faux témoins ? – et les faux documents, toujours excellents, ne peuvent manquer à ceux qui gouvernent le spectaculaire intégré, ou à leurs amis. Il n’est donc plus possible de croire, sur personne, rien de ce qui n’a pas été connu par soi-même, et directement. Mais, en fait, on n’a même plus très souvent besoin d’accuser faussement quelqu’un. Dès lors que l’on détient le mécanisme commandant la seule vérification sociale qui se fait pleinement et universellement reconnaître, on dit ce qu’on veut. Le mouvement de la démonstration spectaculaire se prouve simplement en marchant en rond : en revenant, en se répétant, en continuant d’affirmer sur l’unique terrain où réside désormais ce qui peut s’affirmer publiquement, et se faire croire, puisque c’est de cela seulement que tout le monde sera témoin. L’autorité spectaculaire peut également nier n’importe quoi, une fois, trois fois, et dire qu’elle n’en parlera plus, et parler d’autre chose ; sachant bien qu’elle ne risque plus aucune autre riposte sur son propre terrain, ni sur un autre. Car il n’existe plus d’agora, de communauté générale ; ni même de communautés restreintes à des corps intermédiaires ou à des institutions autonomes, à des salons ou des cafés, aux travail leurs d’une seule entreprise ; nulle place où le débat sur les vérités qui concernent ceux qui sont là puisse s’af franchir durablement de l’écrasante présence du discours médiatique, et des différentes forces organisées pour le relayer. Il n’existe plus maintenant de jugement, garanti relativement indépendant, de ceux qui constituaient le monde savant ; de ceux par exemple qui, autrefois, plaçaient leur fierté dans une capacité de vérification, permettant d’approcher ce qu’on appelait l’histoire impartiale des faits, de croire au moins qu’elle méritait d’être connue. Il n’y a même plus de vérité bibliographique incontestable, et les résumés informatisés des fichiers des bibliothèques nationales pourront en supprimer d’autant mieux les traces. On s’égarerait en pensant à ce que furent naguère des magistrats, des médecins, des historiens, et aux obligations impératives qu’ils se reconnaissaient, souvent, dans les limites de leurs compétences : les hommes ressemblent plus à leur temps qu’à leur père.
Ce dont le spectacle peut cesser de parler pendant trois jours est comme ce qui n’existe pas. Car il parle alors de quelque chose d’autre, et c’est donc cela qui, dès lors, en somme, existe. Les conséquences pratiques, on le voit, en sont immenses.
On croyait savoir que l’histoire était apparue, en Grèce, avec la démocratie. On peut vérifier qu’elle disparaît du monde avec elle.
(p. 27 à 29)
La société qui s’annonce démocratique, quand elle est parvenue au stade du spectaculaire intégré, semble être admise partout comme étant la réalisation d’une perfection fragile. De sorte qu’elle ne doit plus être exposée à des attaques, puisqu’elle est fragile ; et du reste n’est plus attaquable, puisque parfaite comme jamais société ne fut.
(p. 30)
Partout où règne le spectacle, les seules forces organisées sont celles qui veulent le spectacle. Aucune ne peut donc plus être ennemie de ce qui existe, ni transgresser l’omertà qui concerne tout. On en a fini avec cette inquiétante conception, qui avait dominé durant plus de deux cents ans, selon laquelle une société pouvait être critiquable et transformable, réformée ou révolutionnée. Et cela n’a pas été obtenu par l’apparition d’arguments nouveaux, mais tout simplement parce que les arguments sont devenus inutiles. A ce résultat, on mesurera, plutôt que le bonheur général, la force redoutable des réseaux de la tyrannie.
Jamais censure n’a été plus parfaite. Jamais l’opinion de ceux à qui l’on fait croire encore, dans quelques pays, qu’ils sont restés des citoyens libres, n’a été moins autorisée à se faire connaître, chaque fois qu’il s’agit d’un choix qui affectera leur vie réelle. Jamais il n’a été permis de leur mentir avec une si parfaite absence de conséquence. Le spectateur est seulement censé ignorer tout, ne mériter rien. Qui regarde toujours, pour savoir la suite, n’agira jamais : et tel doit bien être le spectateur.
(p. 31)
Sur le plan des moyens de la pensée des populations contemporaines, la première cause de la décadence tient clairement au fait que tout discours montré dans le spectacle ne laisse aucune place à la réponse ; et la logique ne s’était socialement formée que dans le dialogue. Mais aussi, quand s’est répandu le respect de ce qui parle dans le spectacle, qui est censé être important, riche, prestigieux, qui est l’autorité même, la tendance se répand aussi parmi les spectateurs de vouloir être aussi illogiques que le spectacle, pour afficher un reflet individuel de cette autorité. Enfin, la logique n’est pas facile, et personne n’a souhaité la leur enseigner. Aucun dro gué n’étudie la logique ; parce qu’il n’en a plus besoin, et parce qu’il n’en a plus la possibilité. Cette paresse du spectateur est aussi celle de n’importe quel cadre intellectuel, du spécialiste vite formé, qui essaiera dans tous les cas de cacher les étroites limites de ses connaissances par la répétition dogmatique de quelque argument d’autorité illogique.
(p. 38-39)
En janvier 1988, la Mafia colombienne de la drogue publiait un communiqué destiné à rectifier l’opinion du public sur sa prétendue existence. La plus grande exigence d’une Mafia, où qu’elle puisse être constituée, est naturellement d’établir qu’elle n’existe pas, ou qu’elle a été victime de calomnies peu scientifiques ; et c’est son premier point de ressemblance avec le capitalisme.
(p. 72)
La publication de ces extraits dans les Annales d’histoire révisionniste n’a donné lieu, je le répète, à aucun commentaire de la part de Debord !
Le dernier extrait, page 72 de l’original, est particulièrement intéressant… Un journal financier s’appelait, et s’appelle toujours, Le Capital. Le capitalisme n’a jamais dénié son existence propre. Tout au contraire, dès qu’il prend conscience de lui-même à travers les oeuvres de Smith et de Ricardo, loin de nier son existence, le capital se proclame naturel et éternel. Précisément, Debord et moi avions discuté sur ce point, et sur l’oeuvre de Ricardo. Mais cette phrase de Debord, littéralement et manifestement fausse prendrait tout son sens si on remplaçait le mot capitalisme par les mots qui désigneraient l’idéologie et les structures organisationnelles mono-ethniques, qui se prétendent représentatives de la “communauté” juive mais qui semblent avoir lié leur sort au développement du capitalisme., et qui sont actuellement largement impliquées dans son réarmement moral à l’aide de l’idéologie victimaire5 qui leur est propre. Cette substitution, et seule cette substitution, donnerait du sens à cette phrase et à celle qui la précède.
Monsieur Jean-Marie Le Pen, qui, lui, ne se proclame pas révolutionnaire, a été, et selon toute apparence il est toujours, poursuivi devant les tribunaux de la République par des membres d’une section du B’nai B’rith (Les fils de l’Alliance…) pour avoir évoqué imprudemment l’existence d’une “internationale juive” ! Le B’nai B’rith est, de son propre aveu, une puissante franc-maçonnerie internationale, exclusivement réservée aux Juifs !
Et maintenant, voici les deux premiers paragraphes des Commentaires…, que je n’avais pas reproduits dans le n° 5 des Annales :
Ces Commentaires sont assurés d’être promptement connus de cinquante ou soixante personnes ; autant dire beaucoup dans les jours que nous vivons, et quand ont traite de questions si graves. Mais aussi c’est parce que j’ai, dans certains milieux, la réputation d’être un connaisseur. Il faut également considérer que, de cette élite qui va s’y intéresser, la moitié, ou un nombre qui s’en approche de très près, est composée de gens qui s’emploient à maintenir le système de domination spectaculaire, et l’autre moitié de gens qui s’obstineront à faire tout le contraire. Ayant ainsi à tenir compte de lecteurs très attentifs et diversement influents, je ne peux évidemment parler en toute liberté. Je dois surtout prendre garde à ne pas instruire n’importe qui.
Le malheur des temps m’obligera donc à écrire, encore une fois, d’une façon nouvelle. Certains éléments seront volontairement omis ; et le plan devra rester assez peu clair. On pourra y rencontrer, comme la signature même de l’époque, quelques leurres. A condition d’intercaler çà et là plusieurs autres pages, le sens total peut apparaître : ainsi, bien souvent, des articles secrets ont été ajoutés à ce que des traités stipulaient ou vertement, et de même il arrive que des agents chimiques ne révèlent une part inconnue de leurs propriétés que lorsqu’ils se trouvent associés à d’autres. Il n’y aura d’ailleurs, dans ce bref ouvrage, que trop de choses qui seront, hélas, faciles à comprendre.
Debord demeurera l’un des écrivains de ce siècle dont les écrits n’auront pas été totalement vains. Le public retiendra de cet écrivain qu’il a fait de sa vie elle-même une œuvre d’art. Et d’un art peu banal, puisque cet art consista en la subversion de la société. Ce sera indiscutablement sa grandeur, même si cette inversion le sépare du mode d’être subversif du prolétariat. Ce sera aussi sa limite. Mais à notre époque, seule la bêtise et la veulerie sont sans limite. Il serait totalement absurde de reprocher à Debord ses limites, tant qu’il ne prétend pas imposer à quiconque, et au mouvement social, ses propres limites, et il n’existe pas d’apparence qu’il l’ait jamais fait. Il serait plus absurde encore de lui reprocher les limites de l’époque. Et c’est pourquoi je me suis toujours abstenu de toute critique à son égard et à l’égard de l’Internationale Situationniste… La seule critique qu’elle appelle, c’est de faire mieux, et non pas de dire mieux.
En dehors des relations que j’ai entretenues avec lui, personnelles et directes d’octobre 1960 à mai ou juin 1966, indirectes depuis, et sur lesquelles je crois avoir dit plus haut l’essentiel de ce qui mérite d’être retenu, j’ai eu avec Debord les relations d’un lecteur à un écrivain. Comme tout un chacun. Restera de lui les douze numéros d’Internationale Situationniste, œuvre collective dans laquelle sa part fut grande, indissociable de l’activité du groupe, le livre La Société du spectacle et les Commentaires sur… Ces textes sont indissolublement liés à une perspective et à une tentative de transformation révolutionnaire de la société, héritière du mouvement révolutionnaire du dix-neuvième siècle et de l’œuvre de Marx, qui en restera le symbole, en dépit des marxistes. Ces textes demeureront incompris et incompréhensibles en dehors de cette tradition. Et je n’ai aucun titre particulier ni aucun désir de commenter ces textes. Rien qui ne soit compréhensible pour qui veut comprendre. Et seuls ne comprennent pas ceux qui ont intérêt à ne pas comprendre. Aucune explication n’est susceptible de modifier la nature de leurs intérêts, donc d’améliorer leur compréhension. Il est d’autant moins souhaitable de leur fournir ces explications que les intérêts qu’ils servent ne sont pas les nôtres. Nous avons tout à craindre de l’amélioration de leur compréhension.
Je n’ai pas lu Panégyrique. C’est une bonne raison pour n’en rien dire. Je ne doute d’ailleurs pas que j’aurai, quelque jour, plaisir à le lire, ce livre.
Des Considérations sur l’assassinat de Gérard Lebovici, il y a peu à dire, sinon que l’on y parle beaucoup de Guy Debord, et que l’on n’y apprend rigoureusement rien sur Gérard Lebovici, en dehors de la réaffirmation de la réalité d’une amitié. Ce qui, personnellement, m’a légèrement surpris. J’ai dit mes rencontres avec le personnage. Je n’ai rigoureusement rien à lui reprocher. Je ne connais rigoureusement rien de lui, que ce que ces rencontres m’ont appris. Elles ne m’ont justement pas permis de trouver en lui la réalité d’une passion subversive ou révolutionnaire. L’emploi qu’il a fait des moyens dont il disposait ne milite pas en faveur de la réalité de cette passion. Il a certes financé les excellentes éditions Champ Libre, et il a financé Guy Debord…, mais eu égard à ses moyens, cela n’excédait pas l’entretien d’une danseuse pour un bourgeois plus classique. J’aurais mieux compris que Debord nous dise, bien que je ne partage pas ce point de vue, que l’argent nécessaire était bon à prendre là où il était. Si tel n’a pas été le cas, il reste à en prendre acte. A tout prendre, je préfère la réalité de cette amitié aux relations troubles que le contraire impliquerait, où la finalité prétendument subversive ne me paraît servir qu’à excuser de profitables compromissions. Mais que celui qui n’a jamais péché jette à Debord la première pierre. Contrairement à lui, je n’ai jamais proclamé ni pensé qu’il fût possible de vivre sans compromis. Je ne sais même pas ce que cela veut dire.
En l’absence de la moindre explication ou élucidation, le rapport que le très riche producteur de spectacles entretenait avec la subversion de la société du spectacle et la révolution prolétarienne restera très mystérieux, et ne permet pas de lever la suspicion d’une ambiguïté troublante qui justifie des interrogations légitimes.
Si l’on n’y apprend rien sur Lebovici et très peu sur Debord, les Commentaires… sont l’occasion d’une réjouissante revue de l’abjection journalistique contemporaine et de ses capacités d’invention sans limites. La description et l’illustration que nous fournit Debord méritent d’être retenues. Précisément, Debord est parvenu à imposer une certaine retenue à ces débordements crapuleux en portant plainte contre les plus abjects d’entre eux, et en obtenant satisfaction devant le tribunal. Puis il a eu la possibilité d’y répondre, par la publication, non confidentielle, des Commentaires…
Au même moment, Faurisson et les révisionnistes faisaient l’objet d’attaques autrement dangereuses, et les mêmes médiats crapuleux faisaient montre à leur égard d’une vindicte unanime qui ne l’était pas moins. Mais les révisionnistes se voyaient dénier par les tribunaux jusqu’au droit d’y répondre, au motif que leurs réponses, même quand elles ne portaient que sur des questions de faits vérifiables, portaient atteinte à l’ordre public, et même à l’ordre moral (Tribunal de Lyon). Et les révisionnistes n’eurent bientôt aucun moyen de répondre dans les médiats. Et même leurs réponses confidentielles se firent au risque de l’amende et de la prison.
Dans ce contexte, l’évocation par Debord de ses propres malheurs paraissait légèrement disproportionnée, et je me souviens avoir refermé l’excellent livre, où je venais aussi d’apprendre la ville de sa nouvelle résidence en pensant : « Il joue au Faurisson d’Arles ». On sait qu’Arles a donné son nom au célèbre saucisson qui y fut produit industriellement et permettait à un vaste public d’obtenir au rabais un produit satisfaisant et moins onéreux que les produits “pur porc” de la tradition charcutière artisanale.
Enfin est venu l’opuscule Cette mauvaise réputation ; hélas… ! C’est la première fois qu’un livre de Debord m’est tombé des mains. Non pas que Debord n’ait une fois de plus entièrement raison contre la plupart de ses critiques. Mais à croiser le fer avec de trop modestes adversaires, on s’expose à gaspiller son talent et à en perdre la maîtrise. Et quand bien même aurait-on estoqué tous les adversaires qui ont eu l’audace d’évoquer l’Internationale Situationniste et Guy Debord… La belle gloire ! Mais pour la première fois, il m’a semblé que Debord n’avait pas entièrement raison sur le sujet qu’il abordait. Les critiques qu’il réfute ne sont pas toutes du même niveau et l’amalgame qu’il en réalise n’est pas pertinent. Pour la seule d’entre ces critiques qu’il évoque et qu’il m’ait été donné de connaître directement, les extraits qu’il en cite ne sont pas judicieux et l’image qu’il en donne n’est pas compréhensive. Sa réfutation est donc illusoire.
Mais entre temps, Debord avait trouvé un nouvel éditeur. La Société du spectacle, les Commentaires…, et les Considérations…, avaient été réédités chez Gallimard alors que, aux termes d’un dossier intitulé “Correspondance avec un éditeur” publié dans le numéro 12 et dernier de l’I.S. et en réponse à une lettre plutôt bien tournée de Claude Gallimard, l’I.S. avait conclu : « On t’a dit que tu n’auras plus jamais un seul livre d’un situationniste. Voilà tout. Tu l’as dans le cul. Oublie-nous. »
Il n’en fallait pas plus pour qu’une foule d’alouettes péri-situationnistes croient tenir là la preuve de la trahison de Debord. Et pourtant il n’y avait plus d’I.S. et plus de situationnistes depuis douze ans, et même si le choix de son nouvel éditeur constituait un désaveu explicite de la position adoptée collectivement en 1969, je trouve que Debord a eu bien raison de ne pas contribuer plus longtemps à la mise en spectacle d’une radicalité qui avait perdu ses justifications et son fondement, et qui, dès l’époque était déjà artificielle. Il eût été plus utile de réfléchir aux causes qui permettaient l’ouverture d’esprit du célèbre éditeur à l’égard de l’I.S.. En règle générale, un auteur réellement subversif n’a pas besoin d’injurier un éventuel éditeur pour essuyer un refus. Gallimard acceptait sans censure d’éditer ces textes, il en devenait par le fait même un bien meilleur éditeur que tout autre, du fait de sa notoriété. Un point, c’est tout. Gallimard n’avait certes pas protesté contre la loi de censure publiée au J.O du 14 Juillet 1990, mais aucun éditeur n’a protesté…
Revenons-en donc à Cette mauvaise réputation… qui m’est tombée des mains. De même que la description de la société capitaliste et du mouvement de la valeur par Marx, séparée de la perspective du renversement de cette société, ne dérange personne, de même la description de la société du spectacle peut-elle ne relever que de la lucidité. Lucidité qu’on ne déniera pas à Guy Debord et qui est suffisamment rare pour suffire à assurer sa gloire, mais qui ne suffira certainement pas à transformer le monde. Ce qu’il savait. Et il a su, à son heure – c’est peut-être la principale leçon de l’I.S. – être impitoyable envers ceux qui ne savaient pas traduire en actes une prétendue opposition à la société, fort à la mode en ces temps-là. Mais en donnant à voir la persécution et la vindicte médiatique dont il était l’objet, tout en occultant la persécution infiniment plus grave, plus constante et plus systématique, il collaborait à la cohérence totalitaire du spectacle !
Cette mauvaise réputation qu’il revendiquait dans son dernier texte relevait du procédé. Elle est artificiellement entretenue. Debord ne s’est pas aperçu à temps qu’en fait, il n’avait plus mauvaise réputation. Cette “mauvaise réputation”, et l’anathème médiatique, d’autres que lui-même en étaient au même moment l’objet, et ils n’avaient aucun effort artificiel à faire pour en être victimes. Car la société du spectacle ne recherche guère la lucidité sur elle-même, mais elle sait cependant identifier ses ennemis.
Debord n’avait plus “mauvaise réputation…”
La société lui était reconnaissante d’avoir eu la sagesse de se refuser à apercevoir, ou à dire, le rôle central d’Auschwitz dans le spectacle. Il n’y a pas d’autre explication. Qu’on imagine un instant sa situation, et le sort qui aurait été le sien, s’il s’était avisé, non pas même de soutenir publiquement une opinion révisionniste, mais simplement d’appliquer à la commémoration holocaustique et au Shoah business les principes de sa critique du spectacle…
Il n’existe aucun texte de Debord, ni d’aucun situationniste historique, qui attaque ou critique la Vieille Taupe !
Il n’existe aucun texte de Debord, ni d’aucun situationniste historique, qui attaque ou critique Faurisson !
Il n’existe aucun texte de Debord, ni d’aucun situationniste historique, qui attaque ou critique le “révisionnisme” !
Mais il n’existe pas non plus la moindre critique ou protestation publique contre les persécutions dont la Vieille Taupe, Faurisson, et les révisionnistes, ont été victimes. Pas plus qu’il n’existe la plus petite trace de déférence holocaustique et de commémoration génocidaire dans aucun de ses écrits !
A ce jour, deux situationnistes historiques m’ont manifesté personnellement et discrètement leur sympathie.
Debord sera parvenu en cette fin de siècle à laisser derrière lui une oeuvre dont on commence à louer la lucidité, et cependant il n’aurait aperçu ni l’“Holocauste”, ni sa négation ! …en réalisant une prouesse peu banale dont l’équivalent eût été, aux XIIe, XIIIe ou XIVe siècles, de décrire le coeur social du pouvoir, en se refusant à apercevoir l’église catholique ! Il aura été le critique le plus profond de la société du spectacle sans apercevoir le rôle d’Auschwitz dans le règne de l’Eglise cathodique.
Une notoriété anti-spectaculaire est devenue quelque chose d’extrêmement rare. Je suis moi-même l’un des derniers vivants à en posséder une ; à n’en avoir jamais eu d’autre. Mais c’est aussi devenu extraordinairement suspect. La société s’est officiellement proclamée spectaculaire. Être connu en dehors des relations spectaculaires, cela équivaut déjà à être connu comme ennemi de la société.
(Commentaires sur …, page 28)
Cette phrase, seuls quelques révisionnistes, c’est-à-dire ceux d’entre eux qui jouissent d’une certaine notoriété – et la seule notoriété dont ait jamais joui un révisionniste est négative et anti-médiatique – pourraient, sans ridicule, la signer aujourd’hui.
-
Le premier lecteur de mon brouillon m’a fait remarquer que dans Ma Vie, Trotsky raconte une anecdote similaire, mais il la situe à Londres. Je ne sais pas si le récit concernant Paris est le produit d’une déformation par la rumeur ou résulte d’une tradition orale autonome qui circulait dans nos milieux, dont les anciens avaient connu Lénine et Trotsky. ↩
-
Qui, à l’époque, était agent électoral du Parti “Communiste” “Français”. ↩
-
Les médiats(sic). Voir page 136. ↩
-
Amadeo Bordiga, Dialogue avec les morts. ↩
-
Faut-il le préciser ? Des Juifs ont été victimes de persécutions. Rien n’est plus légitime que d’en prendre compte, et d’en rendre compte. Rien n’est plus légitime que la compassion et, dans la mesure du possible, la réparation, à l’égard des victimes. Je nomme “idéologie victimaire” le système de représentation unilatéral, apologétique et mythologique au travers duquel les organisations qui prétendent représenter les victimes juives, instrumentalisent à leur profit, et au profit de leurs projets politiques, les victimes réelles, deux fois victimes… ! ↩